
Renaud – Rouge Sang
Il y a des disques, comme ça, qui provoquent des cas de conscience inattendus.
Difficile de ne pas vouloir parler du nouvel album de Renaud après la belle
résurrection qu’était Boucan d’Enfer, mais en même temps le fiasco désolant
qu’est Rouge Sang donnerait plutôt envie de se taire et de passer
silencieusement son chemin. Si on avait déjà l’habitude de la pauvreté musicale
de l’univers de Renaud (des gros rocks de variétés ici, des petites mélodies au
piano là, un peu de folklore pour les chansons vaguement ethniques), on est
davantage surpris par le désert littéraire de textes parfois embarrassants (les
douloureux Bobos, le gâteux J’ai Retrouvé Mon Flingue, le vulgaire Leonard’s
Song). Pire, la majorité des chansons reposent sur des enchaînements de lieux
communs et de rimes primitives, le néant qui déborde de Elle est Facho, Nos
Vieux, Pas de Dimanches ou bien encore A la Teloche s’avère rapidement
exaspérant. Lorsque Renaud pastiche Souchon sur le bien nommé Sentimentale Mon
Cul, ce n’est plus de la gêne qui nous saisit mais une vague pitié. Le chanteur
se donne en spectacle de manière embarrassante, radotant des bêtises sur sa
nouvelle copine ou s’autoparodiant jusqu’à plus soif. La liste des griefs étant
interminable, je réalise que le silence est finalement la plus sage des
solutions. Oubliez l’existence du dernier Renaud, vous éviterez un gros coup de
blues. |

Be Your Own Pet - Be Your Own Pet
Ah, avoir 15 ans à nouveau… Et considérer que les chansons de 2 minutes menées
tambour battant, avec des guitares partout et une jeune et fraîche demoiselle
qui hurle par-dessus, et bien, il n’y a rien de mieux. En plus, elle dit des
gros mots, la demoiselle. C’est vous dire si l’album éponyme de Be Your Own Pet
peut aussi bien servir de madeleine proustienne que donner un énorme coup de
vieux à l’auditeur qui n’a plus 15 ans depuis longtemps. Bref, ça va vite, ça
crie (mais pas trop), ça toc-toc badaboum la batterie, ça fait des petits
larsens mignons avec les guitares et il y a même un morceau qui s’intitule Fuuuuuuuuun. Que demander de plus ? Dans le genre, c’est beau comme du Ramones
d’époque, un joyeux bordel léger et rigoureusement inoffensif. Bon, pour
l’auditeur ayant dépassé l’âge difficile de la puberté, c’est un peu
l’impression d’entendre 15 fois le même morceau, joué à des vitesses plus ou
moins différentes. Amusant, pour les réveils difficiles, ou comme cadeau à votre
petite cousine de 13 ans qui n’écoute que la Star Ac’.
|
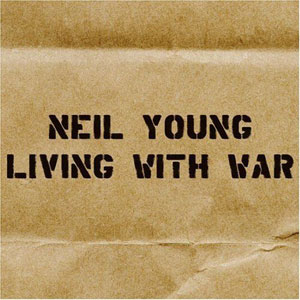
Neil Young – Living With War
Neil Young est un enfant des années 60. Élevé à la protestation et à la
contestation, il lui faut des polémiques et des drames pour que sa verve
musicale atteigne des sommets. De la chanson Southern Man (qui s’en prenait au
racisme ancré dans le Sud des Etats-Unis) à l’album Tonight’s The Night (qui
évoquait les ravages de la drogue dans son entourage) en passant par Sleeps With
Angels (autour du suicide de Kurt Cobain), l’artiste n’est jamais aussi inventif
et touchant que lorsqu’il évoque un thème tragique. On se souviendra donc aussi
de la tournée Weld du début des années 90, en pleine guerre du Golfe, où la rage
du musicien vibrait comme jamais. Depuis une décennie, Neil Young s’était peu à
peu trouvé à cours de sujets de révolte et délivrait des albums apaisés, peuplés
de chansons fleuves, parfois très belles, parfois ennuyeuses, mais l’approchant
toujours davantage de la retraite dorée qu’il avait bien mérité. Mais, à 60 ans
passés, le chanteur s’est trouvé un nouveau cheval de bataille à la hauteur de
sa vindicte : la politique désastreuse de George W. Bush Jr. Jamais depuis les
heures noires du gouvernement Nixon l’Amérique n’avait connu une telle Némésis
et comme au cinéma, quand le méchant est réussi, le reste suit.
Neil Young a donc enregistré son nouvel album en une semaine, avec un chœur plus
ou moins improvisé de 120 personnes, avec une production rustre rappelant ses
meilleurs disques des années 70. Le résultat déborde d’une sincérité brute,
d’une urgence bienvenue, Living With War est direct (on entend des fausses
notes, tout le monde n’est pas toujours en rythme), un peu naïf (des paroles un
peu simplistes mais efficaces) et d’une puissance réjouissante. Le cœur du
disque se nomme Let’s Impeach The President, hymne à la gloire de la destitution
de M. Bush Jr., ponctué par des déclarations consternantes du bonhomme et scandé
par un refrain irrésistible. Le « protest song » retrouve tout son lustre au fil
de chansons telles que After The Garden, Shock and Awe ou Flags of Freedoom.
Neil Young parle surtout de la guerre en Irak, avec des serrements dans la voix
qui rappellent à quel point le traumatisme de la génération sacrifiée du
Viet-Nam est encore présent à sa mémoire. Le mélange entre colère sans fard et
sagesse de vieux routard de l’existence donne à cet album un impact d’autant
plus salvateur. Le final sur la reprise de America The Beautiful s’avère
particulièrement émouvant, et même si le disque ne pourra sans doute s’apprécier
pleinement que dans le moment présent, sa force et son utilité le rendent
indispensable.
|

Asobi Seksu – Citrus
L’année dernière, j’écrivais en ces pages à peu près ceci : « un groupe de rock
actuel sur deux sonne comme un rejeton de My Bloody Valentine ». Dès les 17
secondes d’introduction de Citrus, cette affirmation est une nouvelle fois de
mise : mur de guitares qui font des vagues, production grandiloquente, maelstrom
sonore à l’horizon, tout est là. La chanson d’ouverture, Strawberries, confirme
largement l’impression première, la chanteuse japonaise a une petite voix qui
convient très bien à une imitation du groupe de Kevin Shields. Certes, Asobi
Seksu ne va pas se placer sur le terrain de l’originalité, mais plutôt sur celui
de l’efficacité en faisant dériver de manière fort bienvenue la déprime du genre
vers une pop bondissante et souvent purement réjouissante. Le final de Strawberries avec ces « na na na na » l’annonce, et c’est le très décomplexé New
Years qui le confirme, Asobi Seksu adapte les sucreries japonaises aux codes du
gros rock planant. On est déjà charmé, mais le juste merveilleux Thursday nous
achève, il y a de la mélodie, du panache, un lyrisme rêveur, tout ce qui
transforme une chanson aux oripeaux traditionnels en un petit trésor. Les
arrangements ont beau être surchargé, le batteur cogner comme un damné, le
groupe trouve toujours le petit détail qui vient faire respirer, qui fait
s’envoler.
Sur Strings la chanteuse Yuki Chikudate s’élance dans les aigus, flirtant avec
la rupture de ton et le crime lèse-tympans, elle s’en approche sans jamais
tomber dans le désagréable. Pink Cloud Tracer ressemble sans doute trop à ses
modèles avoués (My Bloody Valentine, donc, mais aussi Jesus & Mary Chain) et
c’est la longue progression hardcore de Red Sea qui vient donner un coup de
fouet à l’album. Après cette errance bruitiste, le groupe enchaîne avec la plus
évidente gâterie pop de l’album, le fantastique Goodbye, et nous voilà alors
plus proche de Blondie que de l’assaut sonore. Le très posé Lions and Tigers, le
bondissant Nefi+Girly et la jolie ballade Exotic Animals (qui s’épanche elle
aussi dans un final criard) concluent l’album. La dernière chanson, le très
court Mizu Asobi est à nouveau un miracle de légèreté énergique et primesautier.
Asobi Seksu réinvente avec Citrus le plaisir du désordre, la grâce du bruit et
redonne de la mélodie dans l’univers du discordant, avec pour résultat l’un des
disques de l’année. |

I’m From Barcelona
Let Me Introduce My Friends
Le classicisme musical n’a pas que des torts, à partir du moment où la petite
étincelle qui met le feu au disque est présente. L’énergie, qui fait une grande
partie de l’attrait de la pop, n’est pas en manque sur le premier album de I’m
From Barcelona (ils ne le sont pas, ils sont Suédois). Dès l’ouverture, sur la
cavalcade de Oversleeping, tout le potentiel du groupe nous saute aux oreilles,
il y a là tout ce que l’on aime, ça rebondit, ça part un peu dans tous les sens,
mais sans jamais quitter le droit chemin de la mélodie entêtante. Dès l’hymne We’re From Barcelona, tout est confirmé, le mot d’ordre sera : générosité. Une
chorale de feu de camp, des clappements de main, du ludisme, une grande
impression de bonheur, pas besoin de chercher plus loin le secret de la
réussite. La chanson suivante, merveille du disque, Treehouse, ne fonctionne que
sur une succession de gimmicks immédiatement inoubliables. La formule se répète
un peu dans la seconde moitié de l’album, mais les trois chansons de conclusion, Barcelona Loves You (adorable), le bizarre mais formidable The Saddest Lullaby et le morceau « caché » Untitled (interprété en suédois) affirment l’impression
générale. I’m From Barcelona donne sans compter et compose une bande son rêvée
des journées ensoleillées.
|

Midlake - The Trials of Van Occupanther
Des albums comme le Trials of Van Occupanther de Midlake, il me semble en
écouter une demi-douzaine par mois. Des disques propres, bien faits, avec juste
ce qu’il faut de guitares, de voix à la Thom Yorke, un peu de planant, un peu de
virulence (mais pas trop), bien écrits et bien équilibrés. La musique de Midlake
est ainsi fort plaisante, mais extrêmement classique, même les quelques
aspérités ne parviennent pas à tirer l’auditeur de son confort. Parfois, à trop
vouloir verser dans le lyrique tout public, le groupe en vient à flirter
dangereusement avec la soupe façon Coldplay (le charmant Head Home). Même
lorsque les grosses guitares sont de sortie, comme sur In This Camp, Midlake ne
dépasse jamais le cadre du mignon. Incapable de s’échapper d’une formule à
présent connue par cœur, le groupe offre un album doté de qualités indéniables
mais dont l’absence de génie et la prévisibilité ne peuvent que le rapprocher de
l’anecdotique.
|

The Pipettes – We Are The Pipettes
Année 2006 de notre ère, le voyage temporel fonctionne enfin, une courageuse
équipe de producteurs musicaux sont envoyés en 1964 pour sauver de la
disparition le plus grand « girl group » de l’histoire, les Shangri-Las, et
les ramener dans le présent. Malheureusement au cours du voyage de retour, des
mutations sont intervenues et les Shangri-Las du 21e siècle,
désormais surnommées les Pipettes, ont subi des changements, pas forcément
évidents aux premiers coups d’oeil et d’oreille, mais indéniables. Déjà, elles
ont abandonné leurs thèmes morbides pour une approche encore plus frontale de la
sexualité (One Night Stand, Dirty Mind, Sex) sans pour autant renier leur verve
(Your Kisses Are Wasted On Me, Why Did You Stay). Les Pipettes ont la vindicte
collé au corps et aucune intention de se laisser marcher sur les pieds. De là à
y entendre un renouveau du « girl power », marotte des années 90…
L’emballage aussi a un peu évolué. Le mur du son de l’époque s’est affiné avec
les techniques modernes, mais les échos et les déferlements de cordes sont
toujours de mise. En fait, la véritable différence d’avec les années 60
résiderait dans un subtil changement d’ambiance, tout est pareil qu’à l’époque
(ou presque), mais on sait que ce ne sont pas les Shangri-Las, on sait que
l’innocence est perdue depuis longtemps et que les Pipettes sont des demoiselles
de leur temps. Alors la fête est irrésistible (le monstrueux Pull Shapes, en
piste pour le titre de single de l’année), on est charmé par la personnalité des
filles (la chanson éponyme) et il y a même matière à s’émouvoir (Judy, la
conclusion toute simple de I Love You). Bref, la machine à voyager dans le temps
est parfaite, c’est aujourd’hui hier et l’on se délecte de la résurrection des
clappements de mains en chœur. |

Frank Black – Fast Man/Raider Man
C’est devenu annuel, comme Noël, le 11 novembre et les films de Woody Allen,
Frank Black sort son disque de country-rock. Mais comme le monsieur est
gourmand, en 2006, l’album sera double, sans commettre l’erreur du diptyque Black Letter Days/Devil’s Workshop (qui avait divisé les ventes par deux), et
donc en insérant les deux disques dans le même boîtier. On ne reviendra plus sur
les vieilles litanies selon lesquelles il fut un temps (désormais très lointain)
où Charles Thompson était le sommet de la créativité, tout cela n’a plus lieu
d’être depuis au moins une décennie. A présent, Frank Black est devenu un label
qualité en matière de rock’n’roll à l’ancienne, sans âge, un peu country,
presque folk par moment, avec du rockabilly ici et des solos de saxophone comme
chez Bruce Springsteen. Avouons-le, le songwriting du monsieur, associé à sa
voix toujours aussi belle, nous offrent de très grands moments. La première
moitié du premier disque de Fast Man/Raider Man est ainsi fort réjouissante,
avant de sombrer peu à peu dans le répétitif. Il devient ainsi inévitable
d’aborder l’œuvre par fragments, pour mieux apprécier la personnalité de chaque
morceau, certains d’entre eux tenant du petit chef-d’œuvre (If Your Poison Gets
You, Johnny Barleycorn, Elijah, Dirty Old Town, End of the Summer…).
27 chansons, bien sûr, c’est trop, beaucoup trop, surtout que le second disque
n’est pas du niveau du premier et que si on essaie de tout écouter d’affilé,
cela tient du masochisme et on passe à côté des perles, noyées dans la masse.
Frank Black pêche une nouvelle fois par complaisance, délitant son chef-d’œuvre
dans une précipitation et une quantité qui prouvent une nouvelle fois qu’il se
fait plaisir, mais qu’il se moque un peu du résultat final. Si Fast Man/Raider
Man se bonifie au fil des écoutes, il lui manque l’étrangeté, le souffle, bref
la flamme qui lui permettrait d’accrocher durablement l’auditeur. De la musique
infiniment respectable, bien fichue, mais poliment ennuyeuse, gentiment inutile. |

El Perro Del Mar - El Perro Del Mar
Sarah Assbring est la chanteuse la plus triste du monde. Sa voix semble charrier
des torrents de déprime, une résignation infinie devant les travers de
l'existence, un renoncement face à la cruauté de l'amour. On peut se dire alors
qu'avec un nom tel que El Perro Del Mar, ce disque est un grand moment de chants
hispanisants pleins de douleur a cappella et de tangos coupants, et il n'en est
pourtant rien. Sarah Assbring est suédoise, amie de Jens Lekman, et ne conçoit
la musique que sous la forme de la pop la plus légère dans ses oripeaux et la
plus acide dans son propos. Mais dès l'intro du premier morceau de l'album, on
comprend: ce tambour qui scande le rythme, c'est un peu une version ralentie,
dépouillée, du Be My Baby des Ronnettes. La voix surgit, fantomatique, comme une
confession au bord du suicide, ça sent la solitude et les coeurs brisés, mais
quand arrive le refrain ("She's gonna get some candy...") tout devient
gracieux, aérien, frais comme l’insouciance. C'est ici que réside toute la
beauté inestimable de ce disque: Sarah Assbring donne toujours l'impression de
chanter en ayant à la fois les larmes aux yeux et un délicat sourire aux lèvres.
À la deuxième chanson de l'album, le juste sublime God Knows, on se retrouve
encore plus clairement dans l'univers des "girls groups" des années 60, avec
cordes, saxophone, échos, choeurs et petit rythme onirique et sautillant. Sarah
Assbring redéfinit les contours de la mélancolie en parvenant à nous faire
croire qu'il est parfois très agréable d'être triste. Et c'est sans doute la
morale de El Perro Del Mar, en particulier lorsque la chanteuse nous affirme que "This loneliness ain't pretty no more" avant de s'élancer sur les "la la
la la la" du naïf et enthousiasmant It's All Good. La pop nordique, la plus pure
et la plus décomplexée du monde (avec la pop japonaise, certes) n'est jamais
aussi touchante que lorsqu'elle ajoute un peu de chagrin dans ses bulles de
Champagne.
Le second album de El Perro Del Mar est ainsi composé sur un équilibre d'une
fragilité rare, car on n'a jamais entendu la ligne "Come on baby, there's a
party going on" entonnée de manière aussi dépressive, Sarah Assbring
parvenant à tirer la plus grande noirceur des clichés les plus niais et à
enluminer les idées les plus ténèbreuses (comme avec le lancinant "All
the feelings you have for me, just like for a dog").
Et il suffit de juste une demi-heure pour transformer ce recueil à l'atmosphère
envoûtante, adorable et déchirante en un petit chef-d'oeuvre. |

Danielson – Ships
Voilà, le « buzz » est formel, le disque de 2006 c’est celui-ci. La preuve ?
Danielson est un pote de Sufjan Stevens (qui fait un brin de figuration sur Ships), un multi-instrumentiste comme le petit gars du Michigan, un brave garçon
un peu timbré qui fait de la pop comme on construit un grand 8. Bref, on est en
plein carnaval, en pleine fête foraine, dans un délire parfaitement maîtrisé
mais relativement imprévisible, qui fait se percuter plusieurs chansons en une
seule, quitte à les faire exploser de l’intérieur. Ecoutons donc l’hallucinant Bloodhook on the Half Shell, les ambiances se chevauchent gaillardement, ça
accélère, ça ralentit, on ne distingue plus vraiment la profusion d’instruments
trop divers pour être catalogués, c’est drôle et un peu inquiétant à la fois, ça
crie : « Chef-d’œuvre ! » pendant 5 minutes. Ships fera-t-il pour autant
l’unanimité ?
Non, parce qu’il y a un léger problème, Danielson a une voix fort particulière,
aigue, acide, qui n’hésite pas à en faire trop, et qui provoquera sans nul doute
des rejets aussi évidents que face au plus beau disque du monde, le Aeroplane
Over The Sea de Neutral Milk Hotel. Si on n’adhère pas au timbre du chanteur, Ships risque de dissimuler sa splendeur mélodique et sa passionnante profusion
d’idées toutes plus folles les unes que les autres. Mais qu’il est dommage de
s’arrêter ainsi aux portes de cet album qui ne cesse de surprendre et d’inoculer
d’excellents gimmicks. A ce niveau, l’euphorisant Did I Step On Your Trumpet pourrait bien devenir l’un des hymnes de 2006, et l’intro de Two Sitting Ducks est si bêtement drôle et entêtante qu’elle en devient jouissive.
Ce mélange entre complexité des chansons et un sens de l’humour assez percutant
(comme sur la conclusion hilarante de Five Stars and Two Thumbs Up) désamorcent
complètement les possibles accusations de prétention à l’encontre de Danielson.
Le bonhomme sait ainsi débuter un morceau dans le chaos quasi-total pour mieux
l’apaiser, le déconstruire et le transformer en une perle rock adulte et
tourmentée (Kids Pushing Kids) ou venir moucher Supergrass sur le terrain de
leur Road To Rouen (He Who Flattened Your Flame). On réalise au fil des écoutes
que Ships n’est pas un fourre-tout immature mais bien une pièce d’orfèvrerie
musicale, très accessible, mais qui ne révèle ses secrets qu’au fil de
nombreuses écoutes. |

Scott Walker – The Drift
Il est bien loin le temps où Scott Walker avec ses « faux » frères était un des
minets crooners les plus populaires des années 60. Elle est bien loin aussi
l’époque où le monsieur popularisait Jacques Brel auprès des anglo-saxons et
délivrait des albums élégants et juste un tout petit peu bizarres. Depuis son
« retour » en 95 avec le fondamental Tilt, Scott Walker a définitivement largué
les amarres et n’évolue plus qu’au sein de son petit monde à lui. Un univers
unique, un genre à lui tout seul, qui se résume à l’écoute de The Drift à une
tentative de renouveler les musiques de films d’horreur.
En effet, la « musique » présente sur cet album est un vaste montage de nappes
atmosphériques, de rythmes fantômes, de bruits blancs et d’incantations du
chanteur, qui déclame des textes abscons, tel un prêtre vaudou en pleine transe
mystique. L’écoute est rapidement aussi fascinante que souvent terrifiante, en
particulier lorsque l’on jurerait qu’une créature invisible et rigoureusement
maléfique tente de traverser la structure des enceintes pour s’extirper de la
« chanson » Psoriatic, ou qu’une voix grotesque, directement empruntée au black
métal, s’immisce dans la conclusion de The Escape. Le rejet peut être massif et
évident, et on se demande comment un fou furieux ayant dépassé l’âge de la
retraite peut trouver une force créatrice suffisamment puissante pour contenir
musicalement de tels démons. Dans son ensemble, l’album semble plus accessible
que Tilt, plus « rythmé », plus directement agressif, plus clair dans ses
intentions terroristes.
A la lecture de ces lignes, on peut évidement se demander quelle inconscience
peut nous pousser à nous infliger cette « pop concrète, atonale et hideuse »,
mais justement c’est parce que d’effets de surprise effroyables à de longues
atmosphères lancinantes chargées de menaces que l’on n’ose point nommer, The
Drift travaille l’auditeur au niveau de l’inconscient que l’on n’a cesse d’y
revenir. On est envoûté, vampirisé, on s’y noie, on s’y perd, des abîmes sans
équivalent dans la musique actuelle s’ouvrent sous nos oreilles, l’expérience
devient exaltante et dévoile une beauté malsaine digne des plus immenses œuvres
d’art. Et surtout, bien sûr, surtout, The Drift est le meilleur film d’épouvante
(sans images, mais qu’importe) de ces dernières années…
|

Neko Case - Fox Confessor Brings The Flood
La country est un genre qui, de notre côté de l'Atlantique, a tendance à faire
fuir l'auditeur avant même la première note. Considérée, souvent à juste titre,
comme le "musette" des États-Unis, la country-music évoque immanquablement
quelques cow-boys caricaturaux, à la voix nasillarde, aux banjos incontinents et
aux violons grinçants, ainsi que des hymnes de l'Ouest poussiéreux ou de la
mélancolie des rodéos péquenots. Mais se contenter des clichés, c'est évidemment
oublier que le genre, de Neil Young à Frank Black en passant par Johnny Cash,
aura offert des chefs-d'oeuvre inattendus, souvent échafaudés sur de subtils
mélanges et de fragiles alchimies, quand le rock et le folk viennent prêter main
forte à des archétypes fatigués. Certains éléments sont encore plus essentiels,
car la country est une musique "de proximité", qui se conçoit auprès du feu de
camp, dans un bar enfumé ou dans le réconfort d'une cabane isolée mais
rassurante. Dans ses plus belles interprétations, cette musique a besoin de
chaleur et de contact, et ne survit qu'à la force du charisme du chanteur, à
l'âme qui habite les morceaux, à la puissance ou à la délicatesse de ce qui est
conté. Le quatrième album de la chanteuse Neko Case regorge de toutes
ces qualités requises, et s'affirme comme l'une des plus grandes réussites
modernes du genre.
Neko Case est loin d'être une inconnue en ces lieux. En effet, elle apparaît sur
les albums studios des New Pornographers et elle a déjà transcendé certaines
perles du groupe telles que The Laws Have Changed, The Bones of an Idol, The
Bleeding Heart Show ou Stacked Crooked. Mais surtout, Neko Case, c'est une voix
inoubliable, tétanisante, quasi inhumaine, pouvant aussi bien plonger dans des
graves abyssaux que s'envoler dans des aigus cristallins, passer de la douceur à
des trémolos imitant naturellement les artifices du "vocodeur".
Ce qui trouble chez Neko Case c'est l'impression de puissance retenue qui habite
chacune de ses notes, une force qui ne s'exprime que rarement, avec d'autant
plus d'impact. La chaleur de son timbre, la maturité de sa sonorité et
l'élégance de sa diction en font sans doute la plus fascinante chanteuse de la
pop actuelle. Sur les 35 minutes de Fox Confessor Brings The Flood, la voix de
Neko Case ne cesse de surprendre, de révéler des qualités toujours plus
envoûtantes, idéalement servies par une production "cathédrale" qui enveloppe
l'auditeur et le laisse... sans voix.
Prenons par exemple la piste n°4, a Widow's Toast, une minute et trente secondes
quasi a capella, Neko Case s'y dévoile sans détour, mais son chant, dénudé,
n'est jamais vulnérable, au contraire, il domine, il surplombe l'auditeur dans
son omniprésence et sa simplicité. La musique présente sur Fox Confessor Brings
The Flood est toujours forgée dans les arrangements les plus classiques, qui
brillent par leur discrétion et leur dévotion aux standards du genre, et
pourtant ce sont les aspirations mélodiques et les circonvolutions parfois
désarçonnantes des compositions qui élèvent l'écrin de la voix au niveau de
cette dernière. Sur That Teenage Feeling, on navigue entre insouciance et
inquiétude lointaine, sur l'irrésistible Hold On, Hold On, Neko Case réinvente
l'épopée du western en même pas trois minutes et un solo de "steel guitar", sur
la chanson éponyme ténèbres et éclaircies se mettent au service d'une histoire
qui échappe totalement aux canons de la country, sur l'admirable Star Witness la
chanteuse s'approprie les codes des pires rengaines pour les plier sous sa voix,
et les accents les plus abruptes se font soyeux.
C'est bien à une nouvelle forme de volupté musicale que nous invite la
flamboyante rousse. Si la mélancolie est parfois palpable comme sur At Last, Fox
Confessor Brings The Flood est avant tout un disque heureux, ludique, jamais
étouffant ou complaisant. Pour preuve, le "tube de salles de billard", John Saw
That Number, qui d'un thème religieux et d'une déférence absolue aux codes de la
country parvient à éveiller un plaisir inédit. La conclusion sensuelle et
nerveuse de The Needle Has Landed semble directement issue de la BO de Kill Bill
tout en préservant l'aura de Neko Case, qui tout en donnant sa voix toute
entière au plaisir de ses auditeurs épargne son glamour et son mystère. Mieux
que n'importe quel autre artiste, l'américaine semble avoir trouvé la formule
pour faire entrer un genre désuet dans une nouvelle jeunesse, entre respect et
petites expérimentations. En jouant sur des paroles surréalistes et une imagerie
décalée, Neko Case offre avant tout un généreux recueil de chansons faussement
simple et la plus sublime démonstration de ses saisissantes prouesses vocales. |

Euros Childs – Chops
C’est avec intérêt et même un certain enthousiasme que l’on entame l’écoute du
premier album solo de Euros Childs, chanteur et leader des excellents Gorky’s
Zygotic Mynci, autrefois adorés en ces lieux pour leur chef-d’œuvre How I Long
to Feel That Summer in my Heart. On ne fait donc pas vraiment attention à la
petite introduction de moins d’une minute, Billy The Seagull, vague comptine
enregistrée en vitesse comme une démo, et on préfère se dire que l’enjoué Donkey
Island sera plus représentatif de l’ensemble de l’album. On se trompe. Car les
petits interludes vont en fait s’intercaler entre quasiment chaque chanson,
comme autant de « possibilités », et l’on doit se contenter de morceaux
inachevés, que l’on zappe rapidement tant leur intérêt se révèle extrêmement
restreint. Quitte à nous faire payer le prix d’un album, autant que ce soit pour
des chansons en bonne et due forme et pas seulement les idées de leurs
créateurs, vaguement jetées sur un magnétophone. Le disque ne faisant qu’une
demi-heure, il ne reste finalement que 25 minutes finalisées, et sur ces 25
minutes, huit sont occupées par un seul morceau, First Time I Saw, clef de voûte
imparfaite de ce Chops. On se retrouve avec à peine un Ep, où les quelques
perles se trouvent noyées dans ce remplissage incompréhensible. Il reste des
instants de grâce comme sur Circus Time et Surf Rage, mais rien qui ne vienne
justifier l’existence de ce disque honteusement anecdotique de la part d’un
compositeur habituellement si talentueux. |

AFX - Chosen Lords
Richard James, alias The Aphex Twin, alias AFX, alias une bonne dizaine d'autres
pseudonymes divers et variés, aura été l'un des précurseurs et surtout l'un des
plus grands artistes de la musique électronique des années 90. Après les grands
succès critiques et les succès relatifs vis-à-vis du public de son Richard D.
James Lp et deux singles mémorables (Come To Daddy et Windowlicker), il a peu à
peu abandonné le devant de la scène, en particulier après un double album, Drukqs, qui le révélait en pleine panne d'inspiration et tournant de plus en
plus en rond. Ces cinq dernières années, le trublion n'aura sorti qu'une poignée
de maxi-singles, dont une sélection est proposée sur ce Chosen Lords. Dès les
premiers instants de Fenix Funk, on se souvient de ce que l'on appréciait tant
chez Aphex Twin à l'époque de sa grandeur : sa faculté à organiser le plus vaste
des chaos rythmiques et sonores en un terrain de jeu ludique, déroutant, parfois
inquiétant, totalement imprévisible et hautement accrocheur. On retrouve Richard
James exactement là où il nous avait abandonné il y a plus d'une décennie, à
l'époque des Analog Bubblebath et I Care Because You Do, en pleine veine de
destruction des règles musicales. Expérimental, déjanté, insaisissable, son
travail sur les 11 singles "Analord" semble aussi obsolète tout en s'assumant
totalement ainsi. Etrangement, ce sont les prémisses de l'inévitable "revival"
de l'electronica des années 90 qui se font déjà entendre sur ces morceaux aux
sonorités datées mais à la verve et à la folie toujours aussi avant-gardistes.
En prenant son temps comme jamais auparavant dans sa carrière, Richard James a
recentré son inspiration, cultivant son petit jardin immédiatement
reconnaissable, délaissant une inaccessible reconnaissance du grand public pour
mieux déverser son trop plein d'idées dans des ébauches de fresques de cinq
minutes qui rebondissent dans tous les coins des enceintes, d'improbables
monstres musicaux titubants sous le poids d'une inventivité étourdissante.
|

The Fiery Furnaces - Bitter Tea
Après le très (trop) exigeant Rehearsing My
Choir, on attendait des Fiery Furnaces qu'ils reviennent à une musicalité plus
évidente, sans rien perdre de leur folie douce (voire furieuse). Matthew
Friedberger l'avait annoncé, Bitter Tea serait plus direct, carrément plus
"rock'n'roll" et à l'écoute du disque on se rend compte que le concept de rock
chez les Friedbergers est très éloigné de celui du commun des auditeurs. Si on se
retrouve assez loin de l'élitisme sonore de Rehearsing My Choir, ce nouvel album
n'en demeure pas moins totalement à part, avec des chansons très distinctes les
unes des autres, comme sur le chef-d'oeuvre Blueberry Boat, mais avec aussi, de
plus en plus, cette volonté de ne pas rester sur place plus d'une minute, et de
changer de style, d'ambiance, d'humeur, plusieurs fois au sein d'un même
morceau. En clair, si vous n'avez jamais accroché à l'univers des Fiery Furnaces,
il y a peu de chances que Bitter Tea vous fasse réviser votre jugement, même si,
comme nous allons le voir, la musique du duo ne cesse d'évoluer et se montre
parfois ici sous ses dehors les plus abordables.
Dès les premières mesures de In My Little
Thatched Hut, on se retrouve en terrain familier, électronique préhistorique,
instruments en liberté, et la voix, sublime, merveilleuse, d'Eleanor Friedberger
qui surnage. Mais dès que survient le premier break, guitare acoustique et échos
aériens, et bien... la musique change à nouveau, puis encore... De prime abord,
cela décontenance, on se perd, on ne sait où se poser, ici un piano, là des
pouêt-pouêts électriques, ailleurs des vagues d'on ne sait trop quoi, en 3
minutes les Fiery Furnaces ont déjà fait preuve de plus d'audace et de
créativité que sur l'intégralité du dernier album des Liars. Surgit alors ce qui
sera la grande figure du style de Bitter Tea : le chant inversé, ici pendant une
poignée de secondes, mais ce qui est aussi admirable chez le duo, c'est de
l'entendre chercher et trouver, quasi en direct, et créer, juste pour nous, de
véritables pièces d'orfèvres faites de bric et de broc. Le vindicatif I'm In No
Mood surgit alors, entre tango minimaliste et comptine, c'est ludique, mais déjà
poind un aspect inattendu, comme une part de noirceur, déjà présente sur Blueberry Boat mais qui semble ici vouloir prendre le devant de la scène. Par
ailleurs, ce second morceau, développant en son milieu ce "chant à l'envers"
qui trouvera plus loin son plein accomplissement, est l'une des chansons les
plus recommandables pour essayer de s'initier au monde des Furnaces...
C'est avec la chanson suivante, Darling
Black-Hearted Boy qu'une émotion inattendue fait son apparition, la voix d'Eleanor
n'ayant jamais été aussi mélancolique. Mais rien n'est simple dans une création
des Fiery Furnaces et la mélopée est interrompue par une mélodie électronique
aigue, aussi incongrue que comique, avant de replonger dans la noirceur de
profondes notes d'orgues. Une ballade triste chez les Friedbergers échappe à tous
les lieux communs, à tous les clichés, à toutes les routines, qu'on se souvienne
du tétanisant Spaniolated de Blueberry Boat. Le milieu du morceau est
entièrement "à l'envers" et dégage une douceur et une beauté que l'on n'aurait
jamais cru concevables, les Fiery Furnaces prouvant à nouveau qu'ils sont capables de tirer les plus
splendides résultats des expérimentations les plus saugrenues. Bitter Tea se poursuit avec la chanson éponyme où le
groupe n'a jamais autant sonné "comme une fête foraine", ou comme un jeu vidéo
particulièrement primesautier, passant de la folie électrique à la rythmique
bondissante, avant de s'élancer sur de conquérants passages martiaux aussi
insolites qu'efficaces. Nous sommes en pleine montagnes russes, car si les
morceaux de cet album sont plus courts que sur Blueberry Boat, ils semblent
aussi d'autant plus condensés, il est donc facile de se perdre en route, surtout
lors des premières écoutes.
Nouvelle ballade dissolue avec Teach Me
Sweetheart, petite histoire déchirante comme seule Eleanor Friedberg sait les
interpréter, couplets noyés dans des ondes électriques presque liquides,
refrains accrocheurs, la construction de la chanson est presque "classique"...
presque... Il n'empêche que le résultat est immédiatement touchant. Le duo nous
entraîne ensuite dans le slow le plus déstructuré que l'on puisse imaginer, Waiting To Know You, idéal pour emballer les androïdes dans les "boums" du 22e
siècle. A noter que cette sucrerie est ce que Bitter Tea proposera de plus
"normal", malgré un final gravement décalé... Vient ensuite ce qui pourrait bien
être le monument du disque, l'hallucinant (et halluciné) The Vietnamese
Telephone Ministry, atonal, minimal, quasi intégralement déroulé à l'envers,
traversé par des éclairs donnant l'impression d'écouter plusieurs stations de
radios simultanément. A priori, rien pour séduire l'auditeur, mais c'est la
passion et l'étrangeté de la voix d'Eleanor qui transcendent l'oeuvre.
D'hypnotique la chanson devient épidermique, puis déchirante dans sa dernière
partie, sans que l'on comprenne bien ce qui crée cette impression, et une simple
litanie de nombres de devenir l'instant musical le plus original et aussi le
plus troublant de ce début d'année.
Oh Sweet Woods semble donc nettement plus
classique de prime abord, surtout lorsque Matthew Friedberg s'inspire de la
rythmique de Billie Jean pour emballer ses troupes, entre deux passages de
guitare acoustique qui tournent en boucle comme un fauve en cage. Le
résultat est un génial "disco acoustique", avec les claps et les basses qui
remuent des hanches. Bien évidemment, rien n'est aussi simple et dans son final,
entre chant inversé et bruitages vicieux, Oh Sweet Woods nous aura déjà
abandonné dans ladite forêt sans nous laisser de petits cailloux pour retrouver
notre chemin... Off To Borneo est une cavalcade déjantée, forcément déjantée,
qui traite par l'hystérie musicale l'ennui évoqué dans les lamentations d'Eleanor,
le résultat s'avérant aussi jouissif qu'impossible à décrire en quelques mots.
La gouaille très directe du court Police Sweater Blood Vow est fort
désarçonnante tant on est ici auprès d'une chanson qui pourrait presque passer
pour traditionnelle. Mais Nevers nous remet immédiatement dans le petit monde
des Furnaces, Matthew et Eleanor se partageant le chant à raison d'un mot ou
d'un bout de phrase chacun, le résultat est aussi cocasse que bondissant et
séduisant, transformant l'expérimentation en une adorable frivolité.
La seule chanson pouvant être considérée comme
une "pièce montée" sur cet album serait Benton Harbor Blues, qui débute sur une
rythmique concassée et étouffée qu'on jurerait sortie d'un album de Tom Waits,
avant de s'élancer sur un thème qui nous suivra presque sans relâche jusqu'à la
fin du disque. La chanson se révèle très narrative, mais sans agressivité dans
les ruptures, presque douce, à part pour quelques inévitables coupures
oniriques qui conduisent toujours les Fiery Furnaces sur les berges du
surréalisme. Ici se trouve ce que le duo a produit de plus évidemment beau et
surtout d'attachant. Malheureusement pour les néophytes, Matthew Friedberger
n'est pas du genre à abaisser si facilement sa garde et Whiste Rhapsody risque
d'achever les oreilles les plus sensibles, car si les prémisses sont
rassurantes, en plein coeur du morceau surgit un affreux sifflement heureusement
fort bref. Peut-être est-ce là le genre de détails "de trop" qui maintiendra le
groupe loin du grand public et loin de beaucoup d'auditeurs ? L'album s'achève
alors sur une reprise du coeur de Benton Harbor Blues et sur une note apaisée,
légère, amicale, qui renforce l'immense affection que l'on ressent à chaque
nouvelle chanson des Fiery Furnaces.
Enfin, que je ressens, plus exactement, car
avec le temps j'ai bien réalisé à quel point une musique aussi... étonnante
(pour le moins) ne trouve pas facilement grâce auprès des conduits auditifs peu
enclins à s'émerveiller devant les expériences rigolotes, les mélanges
grandioses et la mélancolie ludique qui font le prix d'un disque tel que Bitter Tea. Le style des Fiery Furnaces est toujours aussi clairement reconnaissable,
et Bitter Tea est moins bouleversant (et sans doute moins définitif) que Blueberry Boat, il n'empêche que l'on demeure témoin d'une oeuvre bouillonnante,
toujours en quête, mais jamais absconse pour le seul plaisir de sa différence.
Chez Matthew et Eleanor, plus que jamais, ce qui compte c'est l'amusement, la
joie de bidouiller, de tout démonter pour reconstruire du jamais entendu. Avec Bitter Tea, ils nous offrent peut-être le plus accessible des disques difficiles
(ou l'inverse) et avant tout le nouveau chapitre d'une carrière musicale unique
en son genre.
|

The Knife - Silent Shout
C'est toujours quand on pense avoir tout écouté, tout entendu que l'on tombe sur
une musique qui réveille notre curiosité, qui titille nos sens, qui s'immisce
dans notre discothèque quotidienne sans forcément faire beaucoup de bruit mais
avec une flagrante efficacité. Ce début d'année 2006 fut très riche en disques
de grande qualité et en découvertes enthousiasmantes, le troisième album du duo
suédois de The Knife étant peut-être le plus électrisant du lot. Pourtant,
lorsque l'on expose le "concept" autour de Silent Shout, il y a de quoi rester
perplexe. Un disque d'electro dans son aspect le plus basique, voire le
plus daté, où ce qui compte avant tout est la manière dont les rythmiques
techno-disco vont s'amouracher des bruitages électroniques et de la voix
toujours déformée de la chanteuse Karin Dreijer Andersson. A priori, ça n'a rien de très engageant, même si,
précisons-le, comme The Fiery Furnaces, le duo de The Knife est familial, la
musique étant composée par Olof Dreijer, le frangin de la première citée. Et
oui, un tel détail peut être un gage de qualité, ou du moins intriguer davantage
l'auditeur "people".
Et ne l'épargnons point plus longtemps, notre lecteur/auditeur favori et
lançons-le au coeur de Silent Shout, par exemple directement sur la piste 4, We
Share Our Mother's Health. Des "bips" et des "blips" rebondissent dans les
enceintes avant de former une curieuse base rythmique qui s'épanche en une
irrésistible mélodie de "GameBoy" schizophrène. Lorsque la voix de Karin surgit,
on sait que chez The Knife on a depuis longtemps perdu de vue les bornes du
grotesque et que l'on oeuvre définitivement "ailleurs". A tel point que parfois
on pourra se croire face à une musique déjantée de film d'horreur très
conceptuel ou carrément dans une partouze de morts-vivants, comme sur le génial
et purement jubilatoire One Hit ("Oh oh oh oh, wooo wooo wooo wooo"). Ce qui
permet d'évoquer le plus grand paradoxe de Silent Shout, celui d'être un disque
plutôt sombre, voire glauque, tout en demeurant hautement et volontairement
léger et comique.
Le clip du premier single et chanson éponyme, Silent Shout rappelle les
expérimentations de Chris Cunningham pour Aphex Twin et c'est bien d'Aphex Twin
qu'il s'agit ici car l'on pense plus d'une fois à l'humour aussi sordide que
burlesque du créateur de Windowlicker. On oscille donc entre un premier degré
pleinement affirmé comme sur ce Silent Shout d'ouverture particulièrement
envoûtant, ou un second degré totalement inattendu, comme lorsque la belle
errance "ambient" de The Captain se drape d'accents japonisants incongrus. Sur
cet album, aucun morceau ne ressemble à celui qui l'a précédé, et la liberté de
ton de The Knife ne cesse de ravir. Le duo se permet tout et même franchement
n'importe quoi, de la berceuse aux dents aigues de Na Na Na à une chanson
presque normale telle que l'entêtant Marble House qui s'effondre doucement sur
l'un des refrains les plus accrocheurs de ce début d'année. On croisera même de
la sensualité perverse au détour d'un From Off To On et un final digne d'un
train fantôme où le frère et la soeur entament un duo aussi terrifiant que
touchant.
L'oeuvre de The Knife ne ressemble VRAIMENT à rien d'autre et risque de laisser
plus d'un auditeur pour le moins dubitatif. C'est pourtant sur Silent Shout que
l'on peut se régaler de la musique la plus bizarre, la plus créative mais aussi
peut-être la plus jouissive de ce début d'année ; une bande son idéale pour
danser, rire, se faire peur, s'amuser, s'interroger, s'abreuver de sensations
extraordinaires. |

Liars - Drum's Not Dead
C'est la grande sensation du moment, les Liars, sympathique groupe de trublions ayant débuté sa carrière par un album de punk-pop bondissant avant de virer
complètement de bord pour un second disque abstrait et bruitiste pas totalement
maîtrisé, nous reviennent avec un monument sonore qui ne ressemble (presque) à
rien et qui vient inonder nos enceintes par ses vagues électriques ombrageuses.
Le menu est ambitieux, le résultat n'en est pas moins tétanisant, car au-delà de
l'expérience auditive, Drum's Not Dead se présente sous la forme d'un
concept-album laissant la parole à deux personnages antagonistes et
complémentaires, le timoré et mélancolique "Mt. Heart Attack" et le vindicatif
et sûr de lui "Drum".
Dès
l'ouverture du disque (Be Quiet Mt. Heart Attack) on saisit l'ambiance. Des
accords lointains de guitare électrique comme canevas, avec quelques
bidouillages de production pour attirer l'oreille, on n'est pas très loin de,
comme toujours, My Bloody Valentine ou les Flaming Lips (nous y reviendrons).
Puis surgit la rythmique, l'élément clef de l'album, toujours très en avant,
parfois martiale, souvent tribale, les percussions veulent en découdre. La voix
quant à elle, bourrée d'échos, sera presque toujours distante et pourtant
enveloppante. Le crescendo de ce premier morceau enchaîne directement sur la
claque de Let's Not Wrestle Mt. Heart Attack, un choc sonore voisin du Riding To
Work sur le Zaireeka des Flaming Lips. Ici le son de guitare rappelle... un
digeridoo et le chant est assez similaire à ce que l'on a pu parfois croiser
chez Animal Collective, ce qui donne une bonne idée du maelstrom qui englobe
l'auditeur, un tsunami toujours transcendé par l'omniprésence des rythmes
sauvages. On est cloué sur son siège, et ce n'est que le début.
Sur
le morceau suivant, le personnage de Drum est introduit par de glorieuses
percussions et une atmosphère menaçante qui s'évanouit sur le très planant Drum
Get A Glimpse, dialogue entre Mt. Heart Attack et Drum, voisin musicalement
aussi bien de Animal Collective dans son usage des voix que des Flaming Lips
dans ses explosions de cymbales errantes. Les percussions tribales ressurgissent
sur It Fit When I Was a Kid, sorte de musique techno primitive, hypnotique et
inquiétante. L'étrange The Wrong Coat For You Mt. Heart Attack n'est pas sans
rappeler certaines expérimentations des premiers Siouxsie and the Banshees (A
Kiss In The Dreamhouse en particulier) et Hold You, Drum lorgne sur la splendeur
passée d'un Aphex Twin en plein Selected Ambient Works 2. Entre onirisme et
transe, les Liars créent un paysage sonore captivant, qui déroute et surprend
sans cesse.
Un
nouveau choc nous attend au tournant, après l'instrumental It's All Blooming Now
Mt Heart Attack, car Drum and the Uncomfortable Can est un formidable trip
abstrait, dont la longue introduction conquérante n'est que l'arbre qui cache la
forêt. Pas la peine de vous en faire la description, tentez donc l'écoute, vous
saurez très vite si cette musique vous parle ou vous révolte. Après un petit
interlude flottant, les Liars en finissent avec le personnage de Drum sur le
lancinant To Hold You, Drum, avant de se fendre d'une ballade de conclusion,
l'étrangement apaisé et angélique The Other Side of Mt. Heart Attack. Ainsi
s'achève Drum's Not Dead, l'album dont vous entendrez forcément parler en 2006,
à la fois élitiste et propre à apporter de nouvelles perspectives à un plus
large public. On se dit qu'une petite révolution ne demande qu'à surgir des
élucubrations des Liars, leur croyance en un rock en perpétuelle mutation
intrigue et séduit, car cette musique n'est jamais inaccessible ou inécoutable
(même si pour certains elle semblera facilement entrer dans les deux
catégories). Et on se dit avec une quasi certitude que les Liars n'en sont qu'au
balbutiement de leurs recherches et que la suite de leur carrière sera tout
aussi passionnante. |

Jens Lekman - Oh You're So Silent Jens
Jens Lekman est un romantique. Que dis-je ? Un Romantique, avec une belle et
grande majuscule, un écorché vif tout entier drapé dans la politesse du
désespoir. Parfois, Jens Lekman chante exactement comme Morrissey, les mêmes
intonations, la même emphase, le maniérisme un peu distant, tout en alignant des
paroles déchirantes, ironiques, élégamment déprimées ou franchement désespérées.
Car Jens Lekman n'a pas de petite amie et son Oh You're So Silent (compilation
de singles et autres morceaux égarés de son oeuvre) est une vaste lamentation
sur le sort des célibataires ultrasensibles. Il y a donc facilement de quoi se
moquer dans les textes de ses chansons, en particulier lorsque l'auteur
s'épanche dans le lyrisme adolescent ("If
you don't take my hand, I'll lose my mind completely, madness will finally
defeat me") ou dans la candeur la plus totale ("Oh
Julie, meet me by the vending machine. Oh Julie, I'm gonna buy you a wedding
ring.").
L'un des plus remarquables tours de force de cet album est donc de parvenir à
transformer des clichés du discours d'amoureux transis en de merveilleuses
chansons, d'une douceur, d'une élégance mélodique, d'une beauté à la fois
sophistiquée et vaporeuse, que l'on ne peut que succomber à leur créateur. Il
peut ainsi tout se permettre, le festif A Sweet Summer's Night On Hammer Hill,
des ballades aussi suaves que Sky Phenomenon ou la reprise du Someone To Share
My Life With des cultissimes Television Personalities (peut-être le plus discret
des plus grands groupes du monde). Lekman invente la machine à remonter le temps
parfaite avec l'extraordinaire Maple Leaves et nous revoilà dans les 60's
charmeuses ("She said it was all make believe. But I
thought she said maple leaves."). Plus tard on le
retrouve ludique (avec des accents de Will Oldham dans la voix) sur le vibrant
Pocketful Of Money ou dans le quasi silence éthéré du fragile Another Sweet
Summer's Night On Hammer Hill (qui va donner des frissons à certains d'entre
vous).
Notre dandy suédois ne semble pouvoir composer que des perles, vu que les cordes
de Rocky Dennis' Farewell Song ou la version celtico-folk de Julie sont aussi
des sommets admirables. Mais le chef-d'oeuvre du disque serait peut-être le
glorieux Black Cab, un récit de solitude dont le verbe coupant ("You don't
know anything, so don't ask me any questions. Just turn the music up and keep
your mouth shut") se trouve contre-balancé par la classe infinie de la
musique. Trop gracieux Oh You're So Silent Jens pourra paraître mièvre à
certaines oreilles, peu habituées à une telle affectation musicale.
Permettez-moi de plaindre ces conduits auditifs qui ne parviendront pas à
apprécier le lyrisme épidermique de Jens Lekman et son talent frappant pour
créer des bouquets de mélodies à faire se pâmer le plus endurci des coeurs. Dans
un monde idéal, ce disque mériterait le même succès que le Sufjan Stevens de
l'année passée, cela semble possible, on va croiser les doigts, doucement,
aimablement, le petit suédois nous fera tous fondre. |
Grandaddy - Just Like The Fambly Cat
Ceci est le dernier album de Grandaddy, tout autant le dernier en date que
l'ultime opus du groupe qui vient juste d'annoncer sa séparation. Difficile de
rester objectif, lorsque, comme moi, on a tant aimé la musique de Jason Lytle,
même si à l'écoute de ce disque on comprend aisément ce qui a pu motiver la
séparation de Grandaddy. En effet, Just Like The Fambly Cat incarne ce que l'on
craignait finalement depuis l'aérien Sumday : une stagnation définitive et une
exploitation jusqu'à épuisement des recettes qui ont fait tout le charme du
groupe.
L'introduction avec What Happened To The Fambly Cat est pourtant du meilleur
tonneau et laisse espérer le retour des grandes émotions qui submergeaient
l'insurpassé The Sophtware Slump, en particulier parce que l'enchaînement sur
l'énergie monstrueuse de Jeez Louise rappelle les grandes heures de The Crystal
Lake ou de Now It's On. Mais dès Summer It's Gone, on comprend le problème : on
connaît déjà tout cela par coeur. Le moindre break, le moindre effet
électronique décalé, le moindre riff, la moindre ondulation de la voix de Jason
Lytle. Bien sûr, le charme n'a pas totalement disparu, on ne devient pas du jour
au lendemain un has-been lorsque l'on a tant tutoyé les cieux. Mais si dès le
sixième morceau, le pourtant assez nerveux Rear View Mirror, on commence à
s'ennuyer, il y a de quoi s'inquiéter. Car l'album est de surcroît assez (trop
?) long et que la redite se ressent parfois d'une chanson à l'autre, comme
c'était déjà le cas sur le Ep Todd Zilla. Le remplissage n'est d'ailleurs jamais
loin non plus, comme avec le plombant mais redondant The Animal World ou
l'instrumental rigolo mais franchement inutile Skateboarding Saves Me Twice.
On
a ainsi parfois l'impression que Jason Lytle fait le grand déstockage avant
fermeture, ce qui renforce l'aspect dépressif d'un disque qui semble pourtant
nettement moins mélancolique que les trois albums précédents, comme le prouve le
petit interlude punk de 50%. Mais la fin de l'oeuvre s'embourbe très souvent, comme
avec les indigents Where I'm Anymore, Guide Down Denied ou Campershell Dreams.
Grandaddy a cependant de beaux restes et on tombera facilement amoureux du
ludique Elevate Myself et du sympathique Disconnecty. Enfin on appréciera que le
meilleur ait été gardé pour la conclusion, car This Is How It Always Starts et
la coda de Shangri-La sont les plus gracieux instants du disque. Même si là
encore l'impression de déjà connaître tout cela sur le bout du tympan est
omniprésente. Just Like The Fambly Cat apparaît donc comme un testament bancal,
enluminé de quelques vestiges des trésors d'antan, mais comme dépouillé de l'âme
qui faisait de Grandaddy l'un des groupes les plus essentiels de son époque. |

Girls Aloud - Chemistry
Alors, voilà, c'est une histoire incroyable et pourtant on me demande de me
pencher sur ce tissu de sornettes, d'aller vérifier par moi-même, de faire une
nouvelle fois don de ma personne pour le progrès de la recherche musicale, bref
de vous confirmer que, oui, non, vraiment, la Real TV ("télé réalité" in French)
aurait donné naissance à un bon groupe. Rien que de l'écrire, on frémit, on
s'indigne, on lutte de toute sa raison contre une possibilité aussi peu
envisageable. L'émission "Popstar" de nos voisins britanniques aurait permis la
formation du meilleur "girls group" depuis... euh... All Saints ? Les Spice
Girls ? Disons plutôt les Sugababes, le plus grand des produits sonores féminins
de ces dernières années. Bref. Girls Aloud, on me l'a dit : c'est bien.
A
priori, non, ce n'est pas bien, nous avons là cinq bimbos, pour certaines
vraiment sorties d'un catalogue de vente par correspondance quelconque, cinq
demoiselles réunies par l'amour de la musique, une flopée de producteurs sans
scrupules, un marketing titanesque et la "magie" de Star Academy du coin. La
réussite (commerciale) est à la clef, car Chemistry est déjà leur troisième
album, il doit donc y avoir un minimum d'efficacité derrière la chose, n'en
doutons point.
Cela débute d'ailleurs plutôt bien avec l'amusant Models qui nous fait revenir
une bonne décennie en arrière du temps où tout le monde "wannabe their lovers".
Ça continue encore mieux avec le très sympathique single Biology et le très
correct Wild Horses, mais dès que survient la grosse ballade bien gluante, See
The Day on commence à sortir de l'album. On a déjà entendu cela combien de fois
avant ? Les restes proposent pourtant quelques petites perles à l'image du
vindicatif Watch Me Go, le très rythmé Waiting, l'impressionnant Swinging London
Town et l'amusant Racy Lacey. Chemistry s'avère donc au final loin du
chef-d'oeuvre, et sans doute pas franchement impérissable, mais hautement
sympathique et définitivement d'un tout autre niveau que ce que la Real TV & co
a pu nous proposer jusqu'à présent, en France en particulier où l'on n'a jamais
croisé un tel degré d'exigences musicales pour vendre un produit aussi calibré. |

Boris - Pink
Que
se passe-t-il lorsque votre groupe de rock favori se prend les doigts dans la
prise du 220V ? Que peut-il arriver lorsque l'on joue de la guitare électrique
sous la pluie ? Pourquoi est-il déconseillé de frotter ladite guitare contre un
ampli de 25000 Watts ? Tout simplement parce que dans tous les cas le résultat
pourrait bien ressembler au nouvel album des quasi vétérans du métal
expérimental que sont les japonais du groupe Boris. Ne vous fiez pas au
patronyme presque mignon de leur Pink, on vous dira que c'est leur oeuvre la
plus abordable, mais tout est relatif... Si vous n'avez jamais goûté aux délices
des premiers opus d'Hüsker Dü ou aux errances les plus conceptuelles de Mayhem,
ce n'est même pas la peine de vous approcher de ce disque, le morceau
d'ouverture consistant en 7 minutes 30 secondes de larsens et autres vagues
électriques sur un bon gros rythme lancinant hérité de Black Sabbath.
Ensuite, l'Enfer (pour les fans des Smiths) ouvre ses portes. Et badaboum, et
badabang, on hésite entre "hardcore", "speed métal" et autres joyeusetés aux
noms pittoresques qui font la joie des experts en "thrash atmosphérique
symphonique". Certes, ici, rien de symphonique, mais juste un déchaînement
cathartique de riffs bourrins, de batterie épileptique et de solos de guitare
dont on ne sait s'il faut les prendre au premier ou au second degré. Le seul
élément sans doute immédiatement comique consistant en la voix, celle d'un
pauvre petit minet qui ne parvient que difficilement à s'extirper de ce fouillis
auditif et qui donne l'impression par instant d'entendre le chanteur de Green
Day pris au piège d'un savant fou adepte de la torture sonore.
Malgré quelques changements rythmiques comme sur le plus "planant" cinquième
morceau, qui pourrait presque évoquer certains instants inoubliables du Spiderland de Slint, Pink est un disque extrêmement répétitif et l'on est
rapidement en peine de distinguer qui est qui et où est quoi. Étrangement, des
plaisirs surgissent parfois, là où on les attend souvent le moins, comme sur le
toujours aussi violent morceau final où l'on devine une mélodie, et son
épanchement de conclusion n'est pas sans rappeler les véléités onanistes les
plus charmantes de Sonic Youth. Néanmoins, Pink est à réserver aux oreilles
averties (qui doivent en valoir au moins deux), car ses nuances se dissimulent
derrière un mur du son difficile à percer et une énergie relativement
étouffante. |

Belle and Sebastian - The Life Pursuit
Peu
de groupes actuels peuvent se vanter d'avoir une carrière d'une qualité aussi
constante que celle du groupe de Stuart Murdoch. En variant des détails sans
jamais perdre l'essentiel, Belle and Sebastian emballe la plus légère et la plus
belle des musiques "pop" depuis une décennie. Sous une très fausse simplicité et
des échos à présent de plus en plus lointains de grands anciens, tels que les
incontournables Smiths, le groupe ne s'est (quasiment) jamais arrêté en chemin
et se renouvelle sans cesse. Après la production spectaculaire de Trevor Horn
sur Dear Catastrophe Waitress, The Life Pursuit se fait plus humble dans son
écrin sonore, pour mieux se focaliser sur les mélodies et surtout sur les
textes, The Life Pursuit nous parlant de foi et de quêtes existentielles (voire
de pertes existentielles) avec autant de discrétion que de force.
Lorsque l'on écoute cet album pour les premières fois, on ne retient sans doute
que les thèmes accrocheurs, les refrains irrésistibles, les perles du calibre du
sublime Another Sunny Day qui ferait pâlir de jalousie aussi bien Lennon que
McCartney. Ces mélodies sont en fait là pour nous pousser à revenir auprès du
disque, l'écouter, le réécouter, de loin, puis de plus en plus près, jusqu'au
moment où l'on viendra se pencher sur les atmosphères, sur les textes, et où
l'on comprendra que Belle and Sebastian est bien plus qu'un divertissement
luxueux. The Life Pursuit déborde d'âme et il n'y a pas besoin d'être un
critique perspicace pour ressentir toute la délicatesse d'un Dress You Up (et
son solo de trompette juste divin), l'ironie pétillante de Sukie In The
Graveyard, le débordement bondissant de We Are The Sleepyheads, la perfection du
single Funny Little Frog, la grâce bancale de Act of the Apostle II et la
bienheureuse béatitude de For The Price of a Cup of Tea qui s'épanouit dans la
mélancolie insondable de Mornington Crescent.
On
pourra aisément affirmer que The Life Pursuit résonne comme le plus maîtrisé et
le plus admirable album de Belle and Sebastian depuis leur chef-d'oeuvre
fondateur If You're Feeling Sinister, comme l'apothéose provisoire d'un style
qui ne cesse de se métamorphoser tout en demeurant immédiatement familier,
inévitablement proche, entre enthousiasme d'une éternelle jeunesse et cicatrices
du temps qui passe. |
|
|