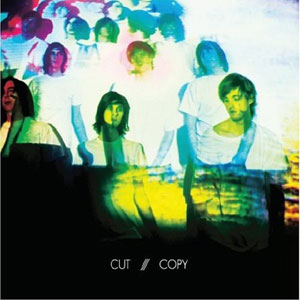
Cut copy – In ghost colours
L’ouverture de In ghost colours, l’assez formidable Feel the love emporte facilement les pieds sur la piste de danse. Les années 80, oui, en
force, toujours, mais sur les couplets, mazette, on est quelque part dans les
90, je vous assure, on dirait qu’on a un peu progressé sur la frise temporelle
de la régression. Bon, le refrain est irrécupérable, avec son vocoder et son
rythme poliment disco. Mais voilà, c’est irrésistible. Les 90’s sont là ! La
première chanson l’annonçait, le boum-boum conquérant de Out there on the ice le confirme. La voix est encore une décennie en arrière, la mélodie aussi, mais
il y a fusion, ça y est, on y est presque. Comme un inédit bizarre de New Order
et des Stranglers (période Féline), ça bouge et bien.
Poum poum tchak hourrah ! Tout n’est pas à la hauteur sur ce gourmand disque.
Autant de bip-bip festif finit par fatiguer l’oreille. Mais parfois Cut Copy
s’anime vers le pop rock qui sonne bien, comme sur Unforgettable season qui prend sa source chez Jesus & Mary Chain. Car il y a à boire et à manger sur
cet album qui en impose. Reprenez donc une bonne louche de dancefloor avec Hearts on fire qui se rie de la caricature et fonce direct dans tous les
travers pour se faire plaisir. Ca tombe bien, ça nous fait plaisir aussi. Donc,
oui, il faut le répéter, sur la durée, In ghost colours nous use et s’use
un peu. Ca clappe trop dans les mains, ça balance trop de Casio pour son propre
bien. A force de convoquer tout le monde, de Eurythmics à Michael Jackson en
passant par Daft Punk, on finit par succomber sous le poids des synthétiseurs
qui claquent. Mais malgré tout voilà une œuvre entraînante et passionnante,
probablement taillée pour marquer 2008.
|

El Perro del mar – From the
valley to the stars
Le nouvel album de Sarah Assbring ressemble à une miniature de porcelaine.
Encore plus que sur son (magnifique) premier disque, tout ici est fragile,
kitsch et gracieux. Si on voulait être méchant on dirait que c’est beau comme
une crèche, mais la demoiselle serait capable de prendre cela comme un
compliment. La preuve, la chanson Glory to the world et son pipeau
maladroit se parent des atours des chants de Noël. Sarah produit une imitation
assez troublante de Julee Cruise. Puis elle s’engage dans un minimalisme à la
fois primesautier et exigeant. Arrangements simples, mélodies évidentes,
production discrète, voix toujours tristounette. Le nouveau El Perro Del Mar
joue la fausse économie et la trompeuse simplicité. L’effet est saisissant, même
s’il faut du temps pour en apprécier la vraie richesse. Les écarts de conduite,
comme avec le spectorien et dépouillé (et donc parfaitement inattendu) Somebody’s baby, sont d’autant plus frappants. Sarah Assbring s’est
davantage plongée dans la mélancolie pour en rapporter des merveilles encore
plus étonnantes. Cette musique demeure incroyable. |

Fleet Foxes – Fleet Foxes
Animal Collective, encore et toujours, et tous ses innombrables dérivés plus ou
moins officiels (Panda Bear & co). Ils sont là, ils hantent les contours de la
musique populaire de notre temps. Pour le meilleur et pour le pire. Alors oui,
on reconnaît surtout les dépouilles gigotantes des Beatles et des Beach Boys,
avec la petite touche de folk qui fait bien sur la photographie. C’est beau,
c’est bien fait, et tout est baigné dans un écho qui donne l’impression de
l’espace, des montagnes et du grand air. Par moment on jurerait un soir d’été
dans les canyons américains. Les chœurs sont riches, les harmonies vocales
sophistiquées. C’est un premier album presque embarrassant à force de hululer
son bon goût et sa classe. Le côté cathédrale musicale pourra charmer ou
exaspérer. (Mal)heureusement, autant d’éclat finit par nous conquérir. |

Fuck Buttons - Street
Horrrsing
Tout commence avec la même douceur qu’un morceau perdu des Ambient Works d’Aphex Twin. De petites tonalités rêveuses qui semblent souligner le titre Sweet love for planet earth. Puis les nappes de synthétiseurs saturés
s’élèvent et s’empilent en vagues frissonnantes. Pour qui sonne le glas
électrique ? Délicatesse et âpreté se confrontent et s’aiment, le paysage évolue
lentement. Puis survient le « chant », un hurlement hardcore qui rugit au fond
du mixage. Incompréhensible et noyé dans le larsen, il scande en un contrepoint
brûlant. Ribs out fait intervenir les percussions tribales pour créer une
atmosphère sauvage, menaçante et gentiment mystique. Cœur fracassant de l’album, Okay, let’s talk about magic déverse en 10 minutes les torrents
électriques, les rythmes de transe et la fascination des rêves lovecraftiens.
Une ambiance très cinématographique se dégage alors, comme dans un film de
science-fiction post-apocalyptique et primitif.
Encore plus lancinant Race you to my bedroom fleurit comme une longue
coda au morceau précédent, avant de s’épanouir très lentement sur Spirit Rise et ses quelques notes de synthétiseur lointain. C’est sur une pulsation
technoïde que débute Bright tomorrow et ses harmonies viennent piocher
humblement chez Kraftwerk, mais le répit n’est qu’illusoire, les saturations et
le chant hurlé reviennent toujours au final. Le plein accomplissement sera
atteint dans le chaos de Colours move, feu étouffé en forme de braises
vivaces. Street Horrrsing est une toile de fond sonore mouvante et
schizophrène, mélange improbable de grâce électronique et de déchirements
hideux. La beauté totale vient naître en son sein. |

The Long Blondes - Couples
Lorsque Kate Jackson monte sur scène on se dit qu’elle incarne la parfaite
poupée rock. Elle n’est pas bien grande, elle n’est pas sublime, mais elle a la
classe. On le sait, elle est fan de Jarvis Cocker au point d’avoir souhaité
faire ses études à Sheffield (la ville de Jarvis et de Pulp). Elle a retenu des
leçons du Cocker et en impose sur scène avec trois fois rien et surtout une voix
à tomber par terre. Elle a l’air terriblement jeune, pourtant elle n’a qu’une
petite année de moins que votre serviteur. On lui donnerait 19 ans, bien qu’elle
ne cesse de chanter que cet âge est depuis longtemps révolu pour elle. Son
public, par contre, est en plein dedans. Pour certaines demoiselles, il s’agit
probablement de leur premier concert de rock, ce soir là, à la Maroquinerie de
Paris.
Et bon sang que les Long Blondes tapent dur. L’énergie sur scène est de la pure
power pop. Et les chansons complexes de Couples, ce deuxième album « risqué »,
n’en ressortent que grandies. Round The Hairpin, le cœur plein de
circonvolutions du disque, s’achève en plein Sonic Youth. Du beau bruit, qui
fait du bien aux oreilles. Les hymnes en puissance explosent grâce à l’organe de
Kate Jackson. Guilt, I Liked the Boys, Here Comes the
Serious Bit sont tous parfaits. Dans ces
instants, Couples n’a rien à envier à l’énergie primitive de Someone To Drive
You Home.

Ce second album est immédiatement frappant, mais plus long à s’apprivoiser. Il
n’y a plus seulement la qualité d’écriture, avec les refrains à 200 à l’heure.
Il y a une vraie beauté, déjà évidente dans les Weekend Without Make Up et autres You Could Have Both du premier opus. Century, dans sa progression, voisine avec Pulp. Too Clever by Half frôle le sublime quand les aigües de Kate
Jackson viennent imiter Debbie Harry sur un rythme de disco désabusé. Nostalgia ouvre de nouvelles portes au groupe, avec ses promesses de ballade
perdue. Enfin, I’m Going To Hell fusionne sensibilité et dynamisme.
Couples, c’est le fameux « album de transition », celui où un groupe essaie de
faire autre chose que ce qui a fait la réussite de leur premier effort. Sans
pour autant décevoir les fans. Sur ce point, pas sûr que les Long Blondes aient
totalement réussi leur coup. Durant le concert, une partie du public,
sensiblement la plus jeune, est restée un peu tétanisée. Il y a pourtant de la
fontaine de jouvence ici. Sans doute une part du secret de beauté de Kate
Jackson. La poupée rock, clinquante et brisée, trop jolie pour être parfaite,
d’autant plus séduisante. Exactement à l’image de sa musique. |

Sissy Wish - Beauties Never Die
Donc, voilà. Edwood a choisi le disque des 10 ans de The Web’s Worst Page. J’ai
pris le temps, j’ai écouté des dizaines de nouveaux albums. J’ai hésité à me
tourner vers le Portishead. Mais, avec toutes ses qualités sépulcrales, Third ne
pouvait pas incarner ce site. Il fallait donc une découverte récente, pop,
éclectique, élitiste et à la fois accessible, un peu piquante, attendrissante,
qui cache derrière son apparente évidence des trésors de complexités. La perle
rare, le truc improbable. C’est donc totalement par hasard que j'ai croisé Sissy
Wish.
J’ai écouté le dernier album de la norvégienne Siri Alberg, Beauties Never Die.
En long, en large, en boucle. Pendant des semaines il fut dans mes oreilles lors
de tous mes déplacements en métropolitain. Pour rythmer les allées du matin et
les retours du soir. Au début ce ne fut qu’un amour immodéré pour le single Dwts
(Do What They Say). Je restais bloqué sur lui. Facilement 8 jours. En négligeant
le reste du disque. Puis j’ai ouvert en grand le coffre magique.
Sur le coup : déception. Rien n’est aussi directement efficace que Dwts. C’est
logique, inévitable. Quand on pond, comme ça, hop, l’un des plus grands singles
de son temps, il est impossible d’être à la hauteur. Pourtant, même dans
l’instant de perplexité, je sens les choses immenses qui bouillonnent et qui
gambadent dans cet album lumineux et imprévisible. Il faut une semaine.
Peut-être un peu moins. Et j’entre en religion.

Sissy Wish est la Voie et la Voix, je serai son prophète. Autant que possible.
Ce ne sera pas facile. Il n’y aura que des infidèles. « Quoi les ruptures de
Float ? Même pas impressionné ! ». Je les entends d’ici, les remarques. « Le refrain tout fracturé de la chanson titre ? M’en fiche ! ». Je le sais
déjà, Beauties Never Die est un album d’investissement à long terme. « Ce
Yayaya chaloupé, avec ses chœurs en émulsion, c’est vilain ! ». Toi qui
penseras ça, pas la peine de revenir. La rupture est consommée. « Tokyo ? Une
des plus admirables chansons du monde ? Soyons sérieux ! Je reconnais bien
l’exagération cultivée en ces lieux ! ». Oui, mais non, Tokyo de Sissy Wish
te tamponne la gueule contre le mur de tes certitudes artistiques. Il t’envoie
dans les étoiles, avec son refrain qui te hurle son évidence, tout en cherchant
en permanence le contre-pied. Et elle en rajoute, la belle, elle te colle la
ligne de basse ultime, les chœurs là, des instruments partout.
« Bon, et qu’est-ce que tu vas nous trouver sur l’anodin Milk ? ». C’est la plus belle chanson de l’album. Un tout petit rythme clapotant et rien
que la voix de Siri Alberg, déjà c’est chouette, c’est merveilleux. Et là, bam,
à une minute, tout doucement, le refrain inconcevable, qui te fait tomber la
dentition sur le pavé. Une mélodie sublime qui s’élève, encore, encore, encore,
encore, qui ne s’arrête jamais. C’est tout petit, tout minuscule, d’une
complexité folle et d’une exécution d’un naturel absolu. Et quand on s’y attend
le moins, un rythme caraïbe surgit, mais sans choquer, car il avait toujours été
prévu là. C’est immense.

« Maintenant, tu ne peux plus nous en rajouter sur cet album, non ? ». Si, bien sûr, je peux. Les trois chansons suivantes sont les plus faibles, mais
chez Sissy Wish, « faible » veut dire chef-d’œuvre. Table 44 et ses bottes de 7
lieues ; Dependence qui claque comme sur le dancefloor de vos rêves ; Music on
Radio, une ballade toute folk, gracieusement débranchée, invitée surprise, le
tour de force qui ne paie pas de mine et qui semble nous dire combien Siri
Alberg peut tout chanter et tout faire. Le final se nomme Book et il incarne
tellement la conclusion parfaite d’un album pop que je ne sais même plus quoi en
dire. C’est festif, ludique, grandiose, mais jamais forcé, ça rend gaga, ça rend
heureux. Et si on s’y penche avec l’oreille du gars qui en a écouté d’autres, c’est
encore plus impressionnant. Le double effet Sissy Wish. Ambroisie pour les
tympans, mais doublé d’un cœur tout croquant, plein de saveurs rares.
Beauties Never Die est sorti en 2007 en Norvège. C’est le troisième album de
Sissy Wish. Il est pratiquement introuvable. Même sur le web. Le trésor est tel
qu’il s’offre l’ironie suprême de créer de la rareté à une époque où tout est
accessible en deux clics. Rare, précieux, un disque qui ne se donne qu’aux plus
ouverts, aux plus exigeants, aux plus passionnés mais aussi à celui qui en
croisera les notes en cherchant un raccourci qu’il ne trouvera sans doute
jamais. A part, ailleurs, Beauties Never Die ne sonne ni culte, ni intouchable.
C’est un disque ambitieux et généreux, qui crée son univers et qui ouvre toutes
les digues sans se soucier de ce qui peut advenir. Des albums de cette espèce,
on ne les répertorie même plus. On ne veut pas les mettre au zoo, ni les étudier
en laboratoire, on les laisse libres. Sissy Wish séduira, ou non. Beauté absolue
de chansons qui vivent au-delà de tout avis critique, de tout commentaire, de
tout commerce, de tout jugement.
Beauties Never Die de Sissy Wish est l’album qui clôt la première décennie
d’existence de The Web’s Worst Page. Et qui ouvre la suivante. Puisse son
« parrainage » annoncer des lendemains qui dansent. |

Portishead - Third
Il est rare de connaître de vivre des événements aussi marquants que la première
écoute du troisième album de Portishead. Si vous n’avez pas encore découvert ce
disque, je ne souhaite pas vous donner trop d’attente, et vous feriez mieux de
vous y aventurer avant de poursuivre ce texte. Je n’ai pas forcément de
bienveillance à l’égard des gloires des années 90, je suis le premier à débiner
sur les nombreux ratages de Massive Attack, Radiohead ou Bjork. Si j’ai adoré
les deux albums de Portishead, le groupe est peu à peu tombé dans mon
bienveillant oubli. Je n’attendais rien de ce nouveau disque, simplement nommé Third.
La surprise est d’autant plus intense, surtout qu’elle se dévoile
progressivement. La première chanson, Silence, se construit dans
l’exigence, mais résonne comme un souvenir des heures les plus emblématiques du
groupe. Le morceau suivant, Hunter, est sans doute ce qui ressemble le
plus à « l’ancien » Portishead, comme pour mieux rassurer les fans et les
désarmer sans en donner l’air. Quelques ruptures électroniques intriguent
néanmoins. Sur Nylon Smile, le minimalisme bâtit de hautes murailles
d’inquiétude. Mais la révolution intervient au milieu de The Rip.
Chanson magnifique, qui s’élève sur des arpèges de guitare acoustique, The
Rip enveloppe doucement la voix de Beth Gibbons. Apaisement trompeur. Au
milieu, des notes électroniques montent, comme surgit d’un Kraftwerk. Elles
viennent remplacer la guitare. La mélodie finale assume pleinement la
transition. Un nouveau groupe et une nouvelle musique sont nés.
On s’en doutait depuis les débuts, mais Portishead a toujours flirté avec les
éléments les plus industriels de la musique électronique. Third vient secouer
les repères et redistribuer les genres. En découle le génial Plastic,
avec son imitation de palles d’hélicoptère, ses hoquets rythmiques et ses
vibrations éminemment industrielles. Constat : Third s’écoute fort et de
préférence au casque. L’expérience est alors transcendante.
We Carry On, cœur bouillonnant de l’album, entremêle
une base rythmique, voisine des Oscillations des Silver Apples, avec la
voix habitée de la chanteuse. Une guitare acérée, que n’aurait pas reniée Trent
Reznor dans ses meilleures œuvres, débute le cisaillement. Les percussions se
font plus agressives, les guitares s’accumulent et entraînent la chanson dans
les abymes infernaux. Nous ne sommes plus dans le trip-hop, ni dans le rock,
encore moins dans un quelconque post-modernisme. Quelque chose de nouveau est en
train de se produire. En direct dans nos oreilles.
Le temps d’un interlude pour souffler (Deep Water) et surgit le monstre
de Third, l’écrasant Machine Gun. Probablement le morceau le plus intense
depuis qu’Aphex Twin a déposé les armes, ce mitraillage sensoriel donne le
vertige. La chanson suivante, Small, poursuit ces recherches en se
construisant à partir du quasi silence, avec d’enivrantes notes de violoncelles
qui s’épanchent dans une mer de bruitages qu’on jurerait issus de Planète
Interdite. Entre menace martiale et sonorités spatiales, les idées
s’imposent.
Magic Doors débute par un sifflement aigu, s’élance
sur des beats cassés et ne compte que sur la voix de Beth pour guider
l’auditeur. Conclusion idéale, Threads invoque les fantômes de
Portishead, en les rendant encore plus effrayants. Sublime dans ses ténèbres, la
chanson s’achève sur un son unique, extrêmement travaillé, qui incarne à lui
seul tout l’aspect terrifiant de la musique industrielle. Pour cette simple
conclusion, juste pour ce son, les années d’attente se justifient.
Third est probablement le meilleur album de Portishead, mais il va bien au-delà.
Il se présente comme la conclusion des années 2000 et comme l’annonciateur de la
décennie à venir. L’univers qu’il construit, les perspectives qu’il offre, la
musique qui en découle peuvent métamorphoser nos critères artistiques. Certes,
c’est une révolution plus discrète que celles de The Knife ou des Fiery
Furnaces, elle est aussi plus accessible. Et son âme est nettement plus
déprimée, car Third trace un portrait déchirant de notre avenir proche. Avec
tant de puissance que l’on ne peut s’empêcher de s’y plonger, fasciné et
bouleversé.
|

The Brunettes – Structure and
Cosmetics
C’est le grand disque pop de ce début d’année. Hop, comme ça, c’est plié, vous
pouvez l’écouter, et on passe à autre chose. Genre on va dire du mal, plutôt.
Tiens, du nouveau Cat Power, par exemple, qui n’est pas bien. Ou alors on va
reparler de Xiu Xiu, qui m’embête à sortir un disque formidable tous les ans.
Sur le cas de The Brunettes, on pourrait s’étendre, avec plein de petits
superlatifs. A quoi bon ? Avouons que ce n’est pas un album qui se révèle à la
première écoute. Super produit, jusqu’au gag (les effets stéréos sur le bien
nommé Stereo), dévoilant un paysage sonore très riche, Structure and
Comestics fait partie de cette catégorie de disques un peu trop clinquants pour
être honnêtes.
L’ouverture de Brunettes Against Bubblegum Youth est en ce sens
trompeuse, elle donne l’impression que l’on est dans le domaine de la
prétention, alors que pas du tout, c’est de l’artisanat, avec un cœur qui bat
dedans. Il y a donc des faiblesses dans l’ouvrage, des chansons un peu faciles,
presque du remplissage. Mais l’album fonctionne justement comme un tout, ce qui
fait toujours plaisir à écouter. Il y a du souffle et de l’ampleur, une vraie
volonté de créer une ambiance et une minie fresque pop.
Les grands moments se mettent en valeur au fil du temps. Au début on passe un
peu vite sur Obligatory Road Song, trompé par son titre parodique. Puis
on réalise qu’il s’agit d’une merveilleuse chanson. La musique des Brunettes se
révèle souvent charmante, comme sur le savoureux If You Were Alien, avec
le petit quelque chose qui accroche. Comme dit plus haut, la clef réside dans la
construction de l’album : de bonnes chansons, toutes reliées par la même
atmosphère. Cette constance s’accomplit justement dans le dernier morceau, qui
donne son titre au disque. Entre mélancolie et flottement, gorgée de bonnes
idées, cette perle conclut Structure and Cosmetics sur une note inoubliable.
|

Vampire Weekend – Vampire Weekend
Que faire d’un disque sympa ? Que faire d’une musique totalement insignifiante
mais pleinement assumée comme telle ? Lui rentrer dans le lard, comme il serait
tout à fait raisonnable de réagir ? Ou alors, pour une fois, aller, bientôt le
printemps, faire preuve d’indulgence et ouvrir les frontières ? Comme on est
quand même plutôt un chantre de l’expulsion artistique, manu militari, chaque
entrée en fraude est un événement. Petit laissez-passer donc pour Vampire
Weekend, qui échappe de justesse à la classification de « nouveaux Franz
Ferdinand », ce qui, en ces lieux, n’est guère flatteur.
Déjà, c’est léger, pas prétentieux pour deux sous. Certes, il y a des bouts de
rythmiques reggae dedans, et il y aurait matière à bastonnade. Mais on sait
depuis The Clash que le reggae avec de la pop, c’est très fréquentable. Chez
Vampire Weekend, la politique on ne connaît pas. La déconne, oui, ça, on compose
avec. Bref, c’est la fête. La fête propre sur elle, attention, du convenable, du
petit bourgeois, du bien comme il faut. Et cette musique, répétitive,
sympathiquement médiocre, totalement inoffensive, s’oublie à mesure qu’elle
s’écoute. Tout en s’adaptant parfaitement en fond sonore des soirées où il ne
faut offenser personne. Des soirées tristes, sans doute, mais il en faut
parfois. Pour nettoyer une chanson comme A-Punk, un petit coup de New
Day Rising d’Hüsker Dü et il n’y paraîtra plus.
|

Autechre – Quaristice
Survivants de l’heure de gloire de la musique électronique des années 90, le duo
d’Autechre aura toujours été d’une exigence confinant à l’austérité la plus
radicale. Leur dernier bébé, Quaristice, est à la fois leur disque le plus
abordable depuis Tri Repetae++ (de 1995, quand même) et une sorte de « best
of », si tant est que l’on puisse apposer un concept aussi éloigné de l’univers
d’Autechre. 20 morceaux en 73 minutes, les auteurs ont raccourci leurs
habituelles créations d’atmosphères. Il en résulte un disque plus exigeant, mais
aussi plus passionnant et relativement atypique. Le temps de s’habituer à une
idée, à un concept, voire à une mélodie (toujours rare), que l’on passe à autre
chose. Le résultat est écrasant et rappelle que l’electronica fut un temps un
genre à la créativité infinie.
|
Jens Lekman au Nouveau Casino
27/02/08
Quand il monte sur scène, on est tout de suite frappé par sa fragilité. Il a
l’air d’avoir 16 ans. Un peu gauche. Avec une chemise blanche où s’étale une
broderie de fleur rouge (probablement un coquelicot). Il est là, à 1m50. On voit
l’usure de ses chaussures. On l’entend claquer les semelles pour marquer le
rythme. Et on se demande comment il fait pour chanter sur la pointe des pieds.
Mais de ce corps, taillé pour le romantisme exacerbé, surgit une voix d’une
puissance et d’une maturité qui n’a rien à envier aux plus grands. Il peut donc
se permettre de chanter Shirin quasi a cappella, il n’a pas besoin
d’accompagnement. Jens Lekman est le Morrissey de notre génération. En version
hétéro.
Car le monsieur sait s’accompagner, à part un quasi clone à la gestion des
samples, il n’y a que des demoiselles dans son groupe. Et si l'on excepte la
très convaincante batteuse, on leur donne aussi à toutes 16 ans. On sera juste
surpris d’apprendre que la craquante violoncelliste, véritable cliché de la
blonde scandinave adorable, est en fait originaire de Detroit, Michigan.
Mais les surprises sont nombreuses chez Jens Lekman. De l’incident technique
(une basse récalcitrante) aux envolées percutantes, il se passe toujours quelque
chose. Si l’on prend en compte le fait que le monsieur a joué toutes ses
meilleures chansons (oui, oui, même Pocketful of Money et Julie),
on ne voit pas l’heure et demie passer. Car le bonhomme est généreux. Quand il
offre un rappel, ce n’est pas moins de cinq morceaux qui sont interprétés.
Il joue souvent seul, avec sa guitare, et surtout sa voix. Mais il cartonne en
groupe, poussant des hymnes comme Maple Leaves ou Sipping on the Sweet
Nectar vers des sommets pop renversants. Le moment clef est évidemment A
Postcard to Nina, transformée en récit tragi-comique de près de 10 minutes.
La quasi intégralité de Night Falls Over Kortedala est interprétée. Parfois en fragments (I’m Leaving You et It Was a Strange Time in my Life), souvent en pleine puissance (The
Opposite of Hallelujah, Your Arms Around Me…).
Excellent showman, qui évite en permanence le ridicule par un sens de l’ironie
salvateur, Jens Lekman magnétise l’attention. Il captive et émeut, conquérant le
public doucement mais sûrement. On le répète depuis bientôt trois ans, mais une
étoile est née. |

Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street
de Stephen Sondheim
Dans toute la filmographie de Tim Burton, on a longtemps considéré Ed Wood comme un mystère. Du moins à un niveau bien particulier. Il s’agissait en effet
de l’unique infidélité vis-à-vis de son alter
ego Danny Elfman. Prenant un peu de recul après la collaboration phare, mais
exigeante, de The Nightmare Before Christmas, le duo voguait chacun de son
côté. Burton engagea Howard Shore pour sa biographie d’Edward D. Wood Jr. et
celui-ci délivra une partition assez voisine de celle qu’écrira Elfman pour Mars Attacks… Quoiqu’il en soit, la séparation, très temporaire, n’empêcha pas
le film d’être une réussite.
Pas de quoi s’affoler de l’absence de Danny Elfman au générique de Sweeney Todd. Une excellente raison à ce fait, il s’agit de l’adaptation
d’une fameuse comédie musicale, souvent réputée comme la plus complexe à
interpréter du répertoire contemporain. L’ajustement des chansons pour le grand
écran s’effectue par le créateur lui-même : Stephen Sondheim. Mais si le compositeur
reprend l’essentiel de son œuvre, c’est évidemment sous l’éminente direction de
Burton. On plonge ainsi dans un univers plus sombre, moins kitsch, toujours
drôle mais moins burlesque que le spectacle de scène.
Première touche burtonienne : le rajeunissement des protagonistes. Sweeney Todd
n’est plus un baryton dans la cinquantaine, Mrs Lovett n’est plus Angela
Lansbury, Toby est enfin un enfant et non un adolescent… Certains thèmes sont
ainsi renforcés et plus touchants, en particulier la romance à sens unique entre
Todd et Mrs Lovett et le rapport maternel entre cette dernière et Toby. Le film
est d’autant plus cruel et parfois ambigu.
Ensuite Burton a tranché dans le comique. Mrs Lovett n’est plus seulement une
vieille folle amusante, Sweeney Todd est davantage enfermé dans ses accents
psychopathes. Pour se faire, exit la ballade de Sweeney Todd ainsi
que toute la conclusion. Dehors aussi les blagues les plus lourdes de A
Little Priest. Les ambiances se font plus oppressantes, à l’image des
décors et des costumes. Ce n’est plus un spectacle de cabaret, c’est une
tragi-comédie. Gore.
Les instants de grâce en sortent encore plus flamboyants. Et le chant un peu
amateur et fragile des deux acteurs principaux n’en est que plus juste. Pas de
lyrisme d’opéra, ou très peu. La seule véritable envolée est fort justement
réservée à l’unique partie chantée de la jolie Jayne Wisemer, l’interprète de
Johanna. Son Green Finch & Linnett Bird, pause lumineuse au milieu
des ombres, est à la fois excessif et d’une beauté indicible. Par ailleurs
Anthony (Jamie Campbell Bower) et Toby (Ed Sanders, bien parti pour les diverses
récompenses des professionnels) s’offrent aussi quelques moments
impressionnants.
D’autres chanteurs amateurs ont leurs instants de gloire. Il est aussi
amusant qu’assez touchant d’entendre Johnny Depp et Alan Rickman en duo sur Pretty Women, la chanson fonctionnant surtout avec les images qui
l’accompagnent. Le plus grand des imitateurs d’accents de notre époque, Sacha
Baron Cohen est forcément extraordinaire en Adolfo Pirelli. Son formidable
talent comique habitant chacune des lignes du texte.

Mais tout le monde retiendra Johnny Depp et Helena Bonham Carter, auxquels aucun
superlatif ne peut rendre justice. Depp est un Sweeney Todd intense, alliant
performance d’acteur permanente et nuances vocales étonnantes. Toute en acidité
et en rancœur, son interprétation peut, d’un instant à l’autre, passer de la
douceur menaçante à la violence crue. Toujours entre haine et tristesse, comme
sur No Place Like London, il s’approprie entièrement le
personnage. Gigantesque sur Epiphany (« No one’s in the chair !
Come on ! Come On ! Sweeney’s waiting ! I want you bleeders ! ») et au bord
de la rupture sur le sommet qu’est Johanna (où sa voix se mêle à
celle de Jamie Bower), Depp dévore tout autant l’image que la musique.
La grande surprise, et même la véritable révélation, est la Mrs Lovett d’Helena Bonham Carter, qui se livre à un jeu magnifique avec les mots et les harmonies. On retiendra tout autant sa manière de prononcer « shop » dans The Worst Pies In London que l’apothéose du discret Wait, où les lignes « I been thikin’ flowers, maybe daisies, to brighten up the room. Don’t you think some flowers, pretty daisies, might relieve the gloom » touchent au sublime. Son accent anglais, toujours exagéré avec parcimonie (le “foolish chatter” de Not While I’m Around ou le « Royal marine » de A Little Priest), fait ainsi des merveilles. Pleine d’humour (By The Sea) et de douceur mélancolique (ses interventions sur My Friends), l’actrice transcende chacune de ses apparitions.
La musique en elle-même possède une complexité gothique qui ne se révèle pas dès la première écoute. Mais elle grandit au fil du temps, jusqu’à s’accrocher définitivement par ses
précieuses mélodies (Johanna en particulier, mais tout autant The Worst Pies in London ou Not While I’m Around) et par la qualité des paroles. Car c’est la virtuosité du verbe qui frappe le plus. Rythmé, exigeant, parfait, le texte s’écoule sans heurts, tel une gerbe de sang issue d’une carotide fraîchement sectionnée.
Enfin, il n’est guère surprenant que les rares moments uniquement instrumentaux sonnent tout à fait elfmaniens, à l’image du générique d’ouverture et de ses orgues menaçantes. De même, la montée orchestrale, très douce et totalement déchirante, qui porte les dernières images du film. Un accompagnement idéal pour la résurrection de Tim Burton. |
|
|