|

Le Tombeau des Lucioles
de Isao Takahata
Le studio Ghibli en est encore à ses débuts lorsque Isao Takahata entreprend l'adaptation animée d'une nouvelle de Akiyuki Nosaka : la Tombe des lucioles. Après le succès commercial retentissant du Château dans le ciel, qui fondait définitivement Ghibli après la collaboration historique autour de Nausicaä, Miyazaki et Takahata mettent en oeuvre deux projets en parallèle. Ce sera Mon voisin Totoro pour l'un (un phénomène de société) et ce Tombeau des lucioles pour l'autre (succès plus discret mais entouré d'un culte jamais démenti). Le premier film de Takahata pour Ghibli incarne idéalement tout ce qui différencie cet auteur de Miyazaki dans l'ombre duquel on a un peu trop tendance à l'oublier. S'adressant à un public adulte, avec parfois des films difficiles d'une maturité surprenante (Omoide Poroporo ou Mes voisins les Yamada) ou détournant un sujet a priori tout public, pour délivrer un objet inclassable entre burlesque et mélancolie étouffante (Pompoko), Takahata aura plus d'une fois désarçonné mais aussi conquis les spectateurs occidentaux.
Le Tombeau des lucioles demeure toutefois le film le plus célèbre du réalisateur, à juste titre, tant la tragédie qu'il conte aura largement contribué à crédibiliser l'animation japonaise auprès de nombreux curieux et indécis. Difficile, en effet, à moins d'être un irrécupérable cynique, de ne pas avoir au moins la gorge serrée devant le calvaire de ces deux enfants, victimes d'un conflit qui s'achève en balayant les derniers vestiges d'innocence. C'est sur l'injustice fondamentale de ces destins que l'histoire insiste le plus, c'est une succession de malchances et de malentendus, de grandes et de petites lâchetés, et surtout c'est un terrible récit d'indifférence, Seita et Setsuko devenant les fantômes de la culpabilité de tout un peuple, comme le représente la formidable image finale de l'oeuvre, l'une des plus évocatrices et inoubliables du cinéma japonais.

Un des choix les plus courageux de Takahata est de ne pas hésiter, comme dans la nouvelle, à dévoiler la fin du récit dès les premiers instants du film. Pas de « suspens larmoyant », pas de mélodrame hollywoodien, mais bien la lente progression d'un drame inéluctable, renforçant ainsi à la fois le réalisme cru mais aussi la pudeur du Tombeau des lucioles. C'est donc un véritable tour de force que de parvenir à éviter les pièges de la sensiblerie sans pour autant tomber dans la froideur documentaire. D'une scène à l'autre, le réalisateur passe des détails effroyables de la guerre (les blessures de la mère étant peut-être ce que l'on a vu de plus insoutenable dans un film d'animation) à des scènes de poésie extrêmement légères (la ballade au bord de la mer, la récolte des lucioles), véritables respirations au sein du métrage, ces séquences s'achèvent cependant toute sur l'ombre de la mort, omniprésente, s'insinuant dans presque chaque image et chaque réplique du film.
Si le Tombeau des lucioles est un requiem, il n'en a que rarement l'emphase, et l'aspect très intimiste de l'histoire, qui ne s'éloigne jamais du point de vue du jeune Seita, évoque plutôt une veillée funèbre. La discrétion de la partition musicale, les nombreux silences, la pureté du trait et de l'animation, tout concourt à la beauté à la fois très simple et exceptionnelle de l'oeuvre. C'est la justesse de ton qui rend le film si bouleversant, Takahata évitant la trivialité alors même que le calvaire de la petite Setsuko (voisin de celui du fils du clochard de Dodes'kaden) aurait pu nous entraîner vers une complaisance sordide. Ce véritable état de grâce, qui marque l'apogée de la veine la plus adulte et réaliste du studio Ghibli, a peu à peu permis au Tombeau des lucioles de s'imposer comme l'un des plus grands classiques du cinéma japonais contemporain.
|

Monster
de Naoki Urazawa
Le mal est séduisant, a dit Baudelaire et de nombreux autres après lui depuis que l'humanité a pris conscience de ses tourments moraux. Le mal fascine, attire, charme, tout autant qu'il peut révolter ou dégoûter, et il suffit parfois d'un concours de circonstances, d'une faiblesse passagère ou d'un simple regard pour que les plus vaillants principes s'effondrent devant la beauté du Diable. La plus pure des âmes peut ainsi être corrompue sans même s'en rendre compte et c'est derrière le sublime que se cachent souvent les plus terribles ténèbres. Ces assertions métaphysiques sont au cur du formidable Monster, série animée de 74 épisodes, tirée d'un manga fleuve de Naoki Urasawa. Cette oeuvre unique n'entretient que bien peu de points communs avec le reste de la production animée japonaise. Tout en reprenant des schémas narratifs et stylistiques connus, elle bouscule les repères, transcende les genres et surprend le spectateur sans lui laisser le moindre répit.
Le lieu de l'action est déjà par lui-même extrêmement original : l'Allemagne de la réunification, entre la fin des années 80 et le milieu des années 90, à ce moment de l'Histoire, et en un endroit où tous les démons politiques et spirituels peuvent se croiser, face au désarroi d'un peuple (en particulier celui de l'Est) qui aura connu durant le 20e siècle toutes les horreurs de presque toutes les formes de dictatures. Le scénario de Monster ne trahit jamais cet ancrage très européen, et pour aider ses spectateurs asiatiques à entrer dans ce univers dépaysant, elle décrit la quête d'un japonais expatrié, le docteur Kenzo Tenma, neurochirurgien surdoué, dont l'existence va basculer de manière inattendue une nuit de 1986. Pensant accomplir le plus grand des biens (sauver la vie d'un enfant), il offre la renaissance au plus effroyable des « monstres ».

Mais les prémisses de Monster ne sont aucunement représentatives de la richesse de la série, qui ne cesse d'enchaîner les fausses pistes, les digressions et de prendre les chemins de traverse, sans jamais lasser ou perdre le spectateur. Le tour de force est à peine croyable, car nous débutons dans Urgences, pour rejoindre Les Experts avec une pointe d'inquiétante étrangeté qui sied à tant de séries policières, avant de nous diriger aux abords du Fugitif, tout en conservant des twists et autres cliffhangers à chaque fin d'épisode qui en ferait pâlir plus d'un, tout cela, bien entendu, au pays de Derrick
Monster serait-elle une série trop gourmande ? Trop ambitieuse ? Oh ! Vous n'avez encore rien vu, car si l'onirisme mystérieux et l'aspect décalé de ces anti-héros ordinaires auront déjà mis la puce à l'oreille de certains téléphages, dans l'épisode 15 (dernier de ce coffret), c'est une scène entière du Twin Peaks de David Lynch qui est citée. Un nain surgissant d'un rideau rouge en entamant une danse incongrue sur une musique des années 60, cela ne peut laisser aucun doute sur l'hommage et sur la très prétentieuse mais aussi très juste filiation que revendique Monster.
Difficile d'évoquer l'oeuvre sans révéler des éléments essentiels qui contribuent à l'aspect follement accrocheur et pour tout dire totalement fascinant de l'errance de Kenzo Tenma. Mais ce qui bouleverse l'esprit critique c'est de pouvoir enfin admirer une série télévisée qui parvient à allier des envolées sentimentales sincères (Tenma et le petit Dieter, par exemple) à une cruauté, voire une violence, jamais démenties (même chez Jack Bauer on n'est pas prêt de voir un enfant battu se faire braquer un fusil de chasse sur la tête pendant plusieurs minutes). On louera aussi l'impressionnant souci de réalisme qui nous montre (enfin !) comment le héros apprend à manier une arme alors qu'il n'en avait jamais touché une auparavant (car tout le monde n'est pas Bruce Willis, même dans un dessin animé
). De même, la psychologie, l'histoire, la vie de famille de chacun des protagonistes sont peu à peu passées au crible et c'est souvent un nouvel intervenant, la plupart du temps essentiel, qui nous est présenté à chaque épisode.
Monster nous fait ainsi tomber « amoureux » de personnages a priori fort antipathiques, que ce soit la petit crapule maladroite Heckel, la femme brisée et haineuse Eva ou le génial inspecteur Runge, plus proche de la machine que de l'être humain. Bien sûr il y a aussi, omniprésent mais presque toujours absent, cette incarnation du mal absolu, Johann, dont les origines et surtout le futur entraîneront sans nul doute la série vers des rives encore plus noires et déroutantes. Mais qu'il en soit ainsi, LA série du moment possède la beauté du démon et vous ne pourrez pas résister à son infini pouvoir de séduction
.

Deuxième partie
Le second coffret DVD de la série Monster nous replonge en trombe dans l'univers si prenant de Naoki Urasawa. Nous avions laissé le docteur Kenzo Tenma sur les traces de Johann et de pistes diverses qui l'ont conduit jusqu'à Munich, et au devant d'un acte terroriste mené par un groupuscule d'extrême droite. Tenma est rejoint dans sa lutte contre la progression de Johann et de son aura de chaos par la sur jumelle de ce dernier, Anna/Nina, prête à tout pour accomplir ce qu'elle avait raté dix ans auparavant : tuer son frère
Si l'on s'attarde donc pendant quelques épisodes sur cette intrigue parallèle et que Johann devient de plus en plus irréel par son omniprésente absence, la série se relance très haut lors de la confrontation entre Tenma et l'inspecteur Runge. Car si l'action se fait parfois rare dans Monster, la violence n'en a que plus d'intensité et chaque scène devient inoubliable.
Mais l'audace fondamentale de la narration de Monster, qui n'hésite parfois pas à dédier un épisode entier à un troisième couteau, apparaît de manière d'autant plus éclatante lors du brusque changement de perspective qui s'opère au milieu de ce second coffret. Nous quittons Tenma, Runge, Nina et tous les personnages que nous commencions à adorer pour découvrir une histoire presque entièrement différente. Les nouveaux protagonistes se nomment Hans Schuwald, Karl, Richard Brown ou bien encore le docteur Gillen. Leur lien avec l'intrigue principale ? Johann, bien sûr, qui va enfin s'exposer au grand jour et dévoiler des trésors de machiavélisme. La sophistication de la psychologie de chaque personnage ne cesse de surprendre et l'atmosphère est à la fois éthérée, souvent onirique, mais essentiellement oppressante, tout concourt à faire de Monster le thriller « total ».

L'empathie du spectateur pour un nombre sans cesse croissant de personnages et la capacité d'Urasawa à déjouer toutes les prévisions, donnent l'impression d'assister à une oeuvre d'une maîtrise inédite, d'une intelligence minutieuse qui ne laisse aucun détail au hasard. Monster devient alors vertigineux car l'on réalise peu à peu que Johann a pensé à tout et que rien ne pourra l'arrêter, qu'un Destin écrasant attend tous ceux qui entreront dans son plan, vaste projet d'une Apocalypse universelle ou intime. La série se relance sans trêve, chaque épisode s'achevant sur un « cliffhanger » affolant qui ne donne qu'une envie: se précipiter sur la suite. Et soyez prévenu, au terme du chapitre 30, dernier de ce coffret, on atteint un des sommets dans le domaine du rebondissement exaltant, le risque d'addiction est immense, après il sera beaucoup trop tard pour essayer d'arrêter, le piège sera déjà refermé
.

Troisième partie
Ce troisième coffret débute par le retour de Kenzo Tenma, que la série avait écarté au profit de la description des manipulations de Johann, auprès de Schuwald et de son entourage. Bien déterminé à abattre le « Monstre », Tenma prépare son piège, tandis que Johann ne cesse de déployer une cruauté sans limite pour accomplir ses ambitions. Il n'hésitera pas à s'en prendre aux plus influençables dans l'effrayant épisode Jeux d'enfants, où une vague de suicides touche les petits garçons de Munich. Mais même le Monstre a sa faiblesse, révélée dans le Héros sans nom, lorsque Johann va débuter son lent cheminement vers ses origines, au fur et à mesure que la mémoire va lui revenir. Abandonnant ce pourquoi il avait été « programmé », il disparaît à nouveau après la confrontation infernale du Diable dans les yeux. Ici se situe le tournant de la série qui prend alors la direction de la République Tchèque, en sondant encore plus profondément les fantômes les plus sordides du communisme.
Cette vaste étape de la série nous donne l'occasion de découvrir un personnage clef, le très émouvant Wolfgang Grimmer, survivant de l'orphelinat Kinderheim 511. La fin du coffret s'intéresse au jeune inspecteur Yan Suk, qui va se retrouver bien malgré lui mêlé à la quête de Johann et à l'un des plus impressionnants rebondissements de l'histoire. Car si Monster est définitivement une oeuvre qui sait prendre le temps de développer idéalement ses protagonistes et les ramifications de son scénario, il se passe énormément de choses et les ellipses se révèlent parfois déconcertantes, le spectateur devant lui-même reconstituer les pièces du puzzle. En ce sens aussi, l'oeuvre renvoie toujours au Twin Peaks de David Lynch, avec sa faculté à brouiller les pistes, à mélanger les genres et à créer une ambiance de paranoïa totale sans toutefois verser ici dans le Fantastique.

Si l'atmosphère de la série, entre menaces quasi métaphysiques (incarnées par le générique d'ouverture) et percées oniriques (avec pour preuve le générique de conclusion), flirte avec le surnaturel, jamais l'histoire ne cède à la facilité et se maintient dans un réalisme surprenant. Les événements se déroulent ainsi sur des mois, des années, en prouvant qu'une telle enquête ne peut pas se développer en quelques jours. Et si Johann apparaît et disparaît tel un fantôme, c'est sans doute parce qu'il incarne la mauvaise conscience de l'Europe (voire aussi celle du Japon), qui a laissé des régimes totalitaires détruire des vies et créer des « monstres » bien réels, avec l'aide d'expérimentations psychologiques ayant bien plus d'impact que n'importe quelles élucubrations de science-fiction.
Ce n'est pas le Mal qui s'exprime au travers de Johann, mais bien le néant de l'humanité, le Monstre peut ainsi se rendre « invisible », être partout et nulle part, nous sembler dans le même plan personnifier la beauté absolue et l'horreur la plus repoussante. La lutte de Tenma et de ses amis nous apparaît d'autant plus absurde et admirable, chaque nouvelle révélation, chaque montée de la violence, résonnent tout à la fois avec espoir et résignation. Monster est une expérience aussi passionnante que parfois éprouvante, où peuvent cohabiter l'angoisse et la tendresse, sans que jamais l'intérêt du spectateur ne faiblisse un seul instant.

Quatrième partie
Après la prise de conscience de Johann dans le troisième coffret, ce quatrième volume se concentre quasi intégralement sur la recherche des origines du « monstre ». Ainsi les héros, de plus en plus nombreux, vont tous se disperser et mener chacun leur enquête pour finalement se retrouver en ex-Tchécoslovaquie entre l'immeuble des « 3 grenouilles » et la tragique « Villa des roses ». Accumulant les fausses pistes et surtout les faux-semblants, la série de Naoki Urasawa verse dans une violence graphique et psychologique de plus en plus impressionnante. Dès le premier épisode de ce coffret, c'est le bienveillant Grimmer qui dévoile une double personnalité terrifiante. Le chapitre suivant sème le doute sur la santé mentale de Nina, et le crescendo se poursuit en particulier avec l'épisode 49, où Johann pousse un enfant au bord du suicide.
Peu avare en rebondissements, Monster n'hésitera pas à faire incarcérer son personnage principal (le plus en plus désabusé docteur Tenma) et à offrir à l'impassible inspecteur Runge une inquiétante progression vers la vérité (dont une scène inoubliable de visite à la Villa des roses où l'effroi surgit d'une simple porte entrouverte).
Comme à son habitude, le récit digresse souvent en s'attardant sur des personnages secondaires et en prenant parfois le temps de les développer sur plusieurs épisodes. Dans cette quatrième partie, le plus touchant d'entre eux serait sans doute le tueur à gages Martin, chargé d'éliminer Eva, et qui se retrouve au coeur des trois derniers chapitres du coffret. Certains antagonismes débutent leur résolution et tout se met en place pour la conclusion du récit, petite Apocalypse en devenir. Monster confirme son statut d'oeuvre à la densité scénaristique extraordinaire, dont le rythme ample et la profusion des protagonistes ne donnent que plus d'impact à ce tableau à la fois terrifiant et paradoxalement attachant des méandres de l'âme humaine.

Cinquième partie
La conclusion de la série fleuve Monster récompense tous les espoirs que nous lui avions offerts dès le début. Le développement psychologique des multiples protagonistes, riche de nuances et de faux-semblants, ne s'arrête pas et les certitudes que le spectateur pouvait se forger sont balayées jusqu'à l'ultime épisode. Nous pensions avoir saisi les clefs de l'histoire et nous voilà à nouveau bouleversés par des révélations qui remettent en question tout ce que les images et les suppositions des personnages nous laissaient croire. Monster se révèle être bien plus que la description d'un complot, ou même qu'un portrait effroyable de la cruauté humaine, c'est aussi une réflexion sur le pouvoir du récit et notamment sur l'interprétation des images. La plongée dans les souvenirs de Nina, la soeur du « monstre », est un puzzle qui nous fait naviguer de fausses pistes en interprétations mouvantes.
Lors de notre première approche de la série de Naoki Urasawa, nous la comparions à Twin Peaks, pour son ambiance et quelques clins d'oeil soigneusement distillés, mais à l'approche de la fin, le parallèle devient encore plus évident, tant Monster est aussi une oeuvre vertigineuse sur les masques, la duplicité et les apparences. Personne, à part le docteur Tenma, n'est ce qu'il semble être, à la manière des hiboux de David Lynch. Et dans le regard de Johann, les abysses dévoilent les pires horreurs de l'esprit humain. Sa simple présence suffit à déclencher l'Apocalypse promise, à l'échelle d'une petite ville, où les six derniers épisodes réunissent les héros. Le suspens, constante de la série, atteint son paroxysme, et la violence garde toute sa puissance et sa beauté. Car l'oeuvre magnifie l'atroce, rend la monstruosité fascinante, refuse toute les ficelles scénaristiques, détourne les attentes et se permet jusqu'à la dernière image de déjouer les codes du genre. En dire plus nous obligerait à révéler des points essentiels, et ce serait criminel. Cependant, on ne peut qu'encourager une nouvelle fois à tenter l'expérience d'une des séries les plus novatrices et audacieuses de son temps, chef-d'oeuvre d'écriture et de mise en scène. |

Patlabor
de Mamoru Oshii
Réalisé en 1989 par Mamoru Oshii, le premier long-métrage adapté de la franchise Patlabor (manga, multiples séries télévisées et autres produits dérivés) est bien loin d'être un simple produit de commande. Oshii l'avait déjà prouvé avec ses débuts sur les films Lamu (en particulier Beautiful Dreamer), il peut se fondre dans n'importe quel univers tout en imposant son style immédiatement reconnaissable. Les codes visuels et narratifs peuvent sembler inébranlables et les personnages, bien connus du grand public, intouchables, le réalisateur trouvera moyen de s'approprier le résultat au maximum. Tant et si bien que l'on se retrouve parfois loin, voire très loin de l'oeuvre d'origine, ce qui est particulièrement le cas sur les suites Patlabor 2 et Ghost in the shell Innocence.
Patlabor, premier du nom, est encore en grande partie fidèle au concept de Headgear (collectif de 5 mangakas et animateurs à l'origine de la série). On retrouve les protagonistes sous des incarnations familières, mais Oshii ne met pas longtemps pour corrompre ce terrain des plus balisés. Il fait des robots « Labors » les ennemis potentiels, décrit une apocalyptique machination terroriste et englobe le tout dans une atmosphère nostalgique où vient se greffer une enquête policière contemplative qui résumerait à elle seule toutes les obsessions stylistiques et thématiques du metteur en scène (mégalopole en décrépitude, errance d'êtres taciturnes, symboles à foison, doutes sur la réalité, musique onirique et angoissante de Kenji Kawaï).

Pourtant, dans ses prémisses, l'histoire de ce Patlabor semble suivre les règles d'or du film d'action de science-fiction à base de « méchas ». Et l'on s'attend à suivre d'imposants combats de robots, avec un maximum de destructions et un minimum de réflexion. Dans cette optique, Oshii offre une scène d'introduction vindicative, modèle de découpage, pour mieux prendre ensuite les chemins de traverse et s'attarder sur les questionnements (certes encore peu existentiels) des divers intervenants. Si les détails technologiques et autres circonvolutions du scénario sont bien présentes, Patlabor est, avec sa suite, le plus directement « humain » des films du metteur en scène. Outre quelques passages comiques, l'oeuvre prend le temps de rendre ses héros attachants et même de créer une certaine affection pour les Labors, renforçant ainsi notre implication lorsque survient la grande scène d'action finale, la plus décomplexée de la carrière d'Oshii.
Mais avant d'arriver à ce climax, le scénariste Kazunori Itô (Ghost in the shell, Avalon) cisèle un thriller aux détours inattendus, dont le « méchant » est une ombre aux proportions bibliques. Loin d'être un mégalomane caricatural, ce terroriste entraîne Patlabor sur les terres de la fable, et, déjà, vers la remise en cause du tout cybernétique et sur les possibles implications envers l'humanité. Si l'aspect métaphysique du scénario est moins développé que dans les films qui suivront, impossible de ne pas ressentir déjà le pessimisme d'Oshii, au détour d'une ligne de dialogue ou dans la beauté de ses images désenchantées. Si le second opus de Patlabor ira bien plus loin dans la mélancolie et le minimalisme spectaculaire, c'est peut-être avec cette première oeuvre que le réalisateur se sera dévoilé sous son jour le plus abordable, parvenant à ménager idéalement le divertissement et la réflexion, ses aspirations d'auteur et le plaisir immédiat du public.

Patlabor 2
de Mamoru Oshii
Oshii est un terroriste cinématographique, un spécialiste du détournement de concept et de la prise d’otage de personnages. Qu’on le lance dans des univers aussi balisés que ceux de Lamu ou de Ghost in the shell et il parvient à délivrer des œuvres contemplatives et mélancoliques là où l’humour et l’action devraient primer. Pour accomplir ses noirs dess(e)ins, le réalisateur commence par acquérir la confiance des auteurs et du public en délivrant des premières adaptations étonnantes mais encore suffisamment proches de l’original pour ne pas braquer les fans. Puis c’est l’escalade vers l’abstraction et l’austérité, des germes déjà largement présents dans les premiers opus.
Passer de Patlabor, dont l’enquête mélancolique s’oubliait dans un final pétaradant, à Patlabor 2, c’est effectuer un bond vers la quintessence du style d’Oshii : une trame ultra complexe de politique-fiction baignée dans du silence et des ombres. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe entre les différents ministères, la police, l’armée et le terroriste utopiste, mais les idées sont puissantes. Une société entière est prise de panique au sein d’un récit parfois étrangement évocateur (un missile détruit un pont lors d’une scène en apesanteur, des chars envahissent les rues dans un calme surréaliste). Oshii parvient à créer du mystère et de l’émotion avec trois fois rien et fait exister ses personnages animés avec une rare force. Poésie urbaine, solitude technologique, tout Ghost in the shell est déjà là, jusqu’à ce final anti-spectaculaire qui vient bouleverser le genre des « robots géants » en le faisant entrer dans l’âge adulte. Fondamental. |

Ghost Talker's Daydream
Sur le papier (et la jaquette), le concept de Ghost talker's Daydream a, à la fois, tout pour séduire le fan (forcément un peu déviant) d'animation japonaise et faire fuir le néophyte, qui trouvera là de quoi entretenir son aversion pour le genre. Le mélange très improbable entre Sixième sens et fantasmes d'otaku peut a priori amuser autant que laisser perplexe, mais il faut garder à l'esprit que le « fan-service » est omniprésent dans le monde de l'animé et du manga, et que même des oeuvres aussi respectables (voire intouchables) que Ghost in the shell (et le physique très généreux du major Motoko) ou que Appleseed (où tous les protagonistes féminins ont des mensurations surréalistes) n'échappent pas à des élans aussi triviaux que plaisants.
Dans le cas de Ghost talker's Daydream, les tendances SM de l'héroïne, Misaki, sont la source de quelques gags grivois et d'une poignée de plans tendancieux, mais n'interfèrent finalement que très peu dans le déroulement et l'ambiance de l'histoire. Certes, nous sommes face à un produit réservé aux plus de 16 ans, car, pour une fois, on nous montre ce qui est souvent dissimulé, en particulier quelques scènes « topless » qui ne laissent plus rien à l'imagination, et des préoccupations érotico-fétichistes d'une crudité inattendue (le grand drame de Misaki étant l'absence de pilosité intime
). Dans tous les cas, les digressions primesautières sont traitées avec beaucoup de légèreté, sans véritablement nuire à l'essence de la série, qui, elle, s'avère nettement plus sérieuse et dans la veine fantastique.

En effet, Ghost talker's Daydream se compose d'une série d'enquêtes paranormales où la faculté de Misaki de voir et de dialoguer avec les fantômes lui permet d'intervenir au sein de tragédies passées prêtes à intervenir dans le présent. Si les deux premiers épisodes servent d'introduction aux personnages et à leurs interactions (l'adjoint trouillard et maladroit de Misaki, le jeune fan obsédé qui la suit partout, la lycéenne lolita qui se découvre aussi médium
), c'est le diptyque Mad Skull et Cursed Water qui donne la meilleure idée du potentiel de cet univers. L'intrigue se fonde sur un terrifiant serial-killer d'enfants et sur des idées d'une rare violence, avec quelques scènes de possession assez effrayantes.
La réussite de ce double épisode ne peut que faire regretter davantage la très faible durée de cette série de seulement quatre OAV de 25 minutes chacun. Ce qui composerait un excellent pilote se révèle l'intégralité de ce que nous pourrons découvrir de Ghost talker, le DVD s'achevant quand on s'attendrait à ce qu'il débute. Tous les bons concepts, les promesses érotiques et la possibilité d'un univers fantastique réussi demeurent en suspens et le spectateur, conquit par les tenues de Misaki et par l'aspect très adulte du propos, ne peut être que frustré et c'est bien là un comble. |

Witch Hunter Robin
Le prolifique studio d’animation Sunrise possède un catalogue où les séries anodines cotoient les merveilles (de Cow-boy bebop à Nicky Larson en passant par Escaflowne). Witch hunter Robin, l’une de leurs plus récentes créations, fait heureusement partie de la seconde catégorie. La première partie de l’histoire se consacre à l’arrivée de Robin, jeune sorcière de son état, au sein du STN-J, service secret gouvernemental chargé de traquer et de neutraliser les dangeureux sorciers en liberté dans la société japonaise actuelle.
Le début du récit pose une certaine routine où chaque épisode met en scène un sorcier différent et où la caractérisation prime sur l’action. Peu à peu, le potentiel de l’œuvre se dévoile : « l’Usine » qui emprisonne les sorciers se révèle menaçante et le fait que Robin (et ses collègues) possèdent aussi des pouvoirs surnaturels fait basculer le récit vers une remise en question de ses prémisses.
Le beau character design et l’ambiance oppressante contribuent à l’intérêt de Witch hunter Robin. Mais c’est surtout le personnage principal, au développement lent mais intrigant (son pouvoir la rend myope, par exemple) qui séduit le plus.
Malheureusement, la deuxième partie de la série, si elle se concentre sur une histoire suivie, déçoit largement par ses enjeux médiocres et sa résolution extrêmement frustrante. |

Wolf's Rain
Si les prémisses de Wolf’s rain demeurent relativement classiques dans leur mélange d’univers post-apocalyptique, de mythologie européenne et de prophéties lyriques, la série parvient à dégager une indéniable personnalité dès ses premiers épisodes. Sur un rythme très soutenu, l’histoire présente ses principaux protagonistes avec intelligence et en respectant le mystère. Le monde décrit est fortement évocateur, avec ces loups pouvant prendre l’apparence des humains, cette quête d’un Eden aussi attirant qu’inquiétant, ces « Nobles » manipulateurs génétiques et ces vestiges de guerres terrifiantes.
Les amateurs d’animation reconnaîtront certains traits communs avec Last exile, mais ici en nettement mieux écrits et en beaucoup moins niais. Certes, on retrouve dans Wolf’s rain à peu près tout ce que l’on peut attendre du genre, mais en une version idéalement détaillée et distillée. Si la série s’avère très riche, elle prend le temps de développer ses personnages secondaires, un peu à la manière d’un Monster, sans que jamais les chemins de traverse ne paraissent trop artificiels ou laborieux.
Il faut ajouter une animation et un design de grande beauté, ainsi qu’une musique forcément intrigante et séduisante de Yoko Kanno, pour souligner à nouveau la superbe réussite que représente Wolf’s rain. |

.hack//SIGN
Les séries animées possèdent aussi leurs nanars et .hack//SIGN (prononcez comme vous le pouvez) en fait partie. Sur les bases d’un univers ambitieux mais au final d’une grande vacuité, l’histoire déroule une intrigue d’une pauvreté qui fait passer le néant pour de la contemplation. Il ne se passe rien et une poignée de personnages errent dans un monde désert. L’ennui inhérent aux premiers jeux multiplayers online devient le principe de .hack//SIGN. D’immenses tunnels de dialogues répétitifs donnent l’impression d’assister à des « chats », à peine animés, entre quelques geeks désoeuvrés.
Les tentatives poétiques ou vaguement mystiques tombent à plat, tant la « profondeur » de l’œuvre la fait immédiatement passer pour un Avalon du pauvre (c’est le même scénariste). Il faut ajouter à ce constat une musique insupportable et jamais en accord avec les scènes, ainsi qu’un character design des plus basiques qui donnent l’impression de regarder une série des années 80 (alors qu’elle date en fait de 2002). Laborieux, .hack//SIGN ne séduira sans doute que les accros indécrottables de World of Warcraft, qui seront peut-être eux-mêmes déçus de l’indigence du monde virtuel décrit ici. |

Sadamitsu le destructeur
Nouvelle oeuvre dirigée par Keichi (ou Koichi) Ohata, déjà connu pour son travail à divers niveaux sur Burst Angel, Blue Gender et certains dérivés des tentaculaires séries Gundam et Gunbuster, Sadamitsu le destructeur ne semble pas bien palpitant de prime abord. En particulier lorsque l'on est néophyte en matière d'animation japonaise, et que l'idée de voir un superhéros combattre des monstres pittoresques évoque davantage des relents de Dragon Ball que des réussites telles que Silent Möbius ou Blue Seed. Ce serait pourtant fort dommage de passer à côté de cette courte série (à peine 10 épisodes, le dernier étant composé pour moitié d'un résumé des événements précédents) qui, outre un visuel de haute tenue (par le Studio Deen déjà à l'oeuvre sur des incontournables tels que Kenshin le vagabond ou You're under arrest), propose un univers très attachant.
Dès le générique d'ouverture, on comprend la portée référentielle du projet. Un thème musical, emprunté presque note pour note à Ennio Morricone, nous place dans une atmosphère héroïque à mi-chemin entre le western et Kill Bill. L'imagerie et l'ambiance n'ont alors rien de bien original, la présentation des protagonistes obéissant aux clichés du genre. Sadamitsu et sa bande de potes « Les croque-morts », des enfants de choeur défendant, on s'en doute, la veuve et l'orphelin, flirtent d'ailleurs par instant avec la parodie ; et le langage cru n'est pas sans rappeler Samouraï Champloo (Sadamitsu étant par ailleurs antérieur à la série à succès de Shinichiro Watanabe). On sent les auteurs prêts à verser dans le burlesque pur, mais dès la conclusion du premier épisode et la « naissance » du personnage éponyme, un surprenant et assez subtil équilibre se crée. L'argument de base étant pour le moins fort basique : notre « Destructeur » doit renvoyer dans l'espace d'où ils n'auraient jamais dû sortir, quelque un million deux cent cinquante-deux mille cinq cent trois monstres repris de justice, atterris sur Terre on ne sait comment, mais il va bien falloir s'en débarrasser.
Les 5 épisodes suivants sont alors très jouissifs, en faisant intervenir un nouveau comparse haut en couleur (la « moto alien », Kulon, toujours prompte à interpeller le héros par des « aniki !! » tonitruants) et surtout un mystérieux « Vautour » dont les intentions mystérieuses et les liens avec Sadamitsu forment le coeur de la série. Mais ce qui captive le plus, ou du moins divertit sans trêve, c'est l'arrivée continue de nouveaux monstres (les « Ryukeitai », criminels spatiaux et très spéciaux) et la manière dont Sadamitsu va triompher de leurs vices et pouvoirs toujours plus inattendus. En ce sens, le sommet de l'oeuvre se situerait au niveau de l'épisode 4, où le « superhéros » irascible et maladroit fait face à deux aliens lubriques, amateurs de parfums de collégiennes et de sous-vêtements en dentelle. On se retrouve ici plus du côté de Lamu que du dépressif Blue Gender. Mais le charisme de Sadamitsu, la menace du Vautour, la nervosité de la mise en scène et l'excellente bande-son élèvent la série au-delà de la trivialité qui la guette.

Si on se dit que le concept pourrait vite tourner en rond et l'enchaînement des combats devenir très lassant, la série ne nous permet même pas de nous installer dans une routine plaisante et emballe son final lors de quatre derniers épisodes spectaculaires mais très expéditifs. Le scénario se précipite alors en évinçant à toute vitesse le mystère du Vautour et la belle relation entre Sadamitsu et sa camarade de classe Kamishiro. L'entrée en jeu d'une poignée de « supervilains » fait un peu figure de rustine susceptible d'assurer un dernier round apocalyptique comme le genre l'affectionne tant. D'où une impression de déjà-vu qui gâche la conclusion de l'histoire en laissant un goût d'inachevé. L'aspect fun de la première moitié de la série s'efface totalement au profit de belles scènes dramatiques malheureusement bien prévisibles et définitivement plus banales que le style précédemment adopté.
Néanmoins, Sadamitsu demeure une oeuvre distrayante, dont la liberté de ton, aussi bien dans la verve de ses protagonistes que dans le dynamisme de son esthétique, ravira les fans de GTO et de Samouraï Champloo. Pour l'amateur occasionnel, les extravagances de ce « loubard devenu justicier » proposent suffisamment de scènes d'action destructrices, de poses héroïques et de gags percutants pour assurer la qualité de ce divertissement très recommandable. |

Burst Angel
Lorsque l'on se penche sur la liste des créateurs de Burst Angel, qui va du réalisateur Keichi Ohata (Sadamitsu, Blue Gender
) au scénariste Fumuhiko Shimo (Full Metal Panic !) sous l'égide du studio Gonzo (Last Exile, Blue Submarine 6
), on se trouve en droit d'attendre une série de pur divertissement, légère et rythmée, au style soigné. Le résultat n'est qu'en infime partie à la hauteur de nos espérances. Car si Burst Angel est effectivement une superbe réussite visuelle, elle se révèle être le bel emballage d'un paquet tout vide.
Le soin apporté au graphisme, au character design, aux décors et à l'animation, avec une 3D mieux intégrée que dans l'ineffable Gantz du même studio, ne parvient à séduire que le temps de la scène d'introduction du premier épisode, grandiose combat de robots géants (« méchas ») dont on ne comprend ni les tenants ni les aboutissants mais qui donne ainsi le ton du reste de l'oeuvre : spectaculairement gratuite et d'un manque d'originalité qui frôle l'indigence. Tous les lieux communs de l'animation japonaise sont ainsi passés en revue dès le premier volume : méchas, démons, mutations, gangs, agences secrètes, complots gouvernementaux
Et bien sûr le concept de base de Burst Angel : quatre filles au passé trouble et aux formes généreuses, qui luttent contre les méchants avec humour et une dose de questionnements existentiels des plus basiques. Il y a la gamine pro de l'informatique, la plus âgée qui fait la morale, la sexy rigolote et la tête brûlée taciturne et probablement amoureuse de sa comparse délurée. Pour nous introduire dans ce petit monde, on suit l'arrivée du jeune cuisinier de l'équipe, unique présence masculine, et gentil candide qui va créer des tensions au sein du groupe.

Burst Angel accumule alors tous les traditionnels sous-entendus plus ou moins érotiques, de l'amour lesbien aux innombrables plans de poitrine surdimensionnée ou de petites culottes. Le sommet de la série, aussi bien au niveau du divertissement que de la facilité, étant les épisodes 5 et 6, qui se déroulent dans un pensionnat de jeunes filles, sur les bases d'un vague remake de Suspiria, permettant aux spectateurs érotomanes de se rincer l'oeil jusqu'à plus soif
Ces enfilades de stéréotypes pourraient avoir du charme, mais malheureusement la série souffre de plus gros problèmes, en particulier d'une construction maladroite qui fait s'enchaîner inévitablement un épisode de présentation de mission laborieux avant un second épisode centré sur l'action pétaradante mais ultra répétitive (quelques gunfights au ralentis et deux robots qui se tapent dessus). De surcroît, on se demande souvent à qui s'adresse vraiment Burst Angel, car l'humour est très enfantin et les scènes de violence très gores, les situations parfois vraiment sexy mais aussi incroyablement niaises (ah ! le frangin du vilain monstre dans l'épisode 4 !). Bref, Burst Angel bouffe effectivement à tous les râteliers, sans développer la moindre thématique un tant soit peu originale ni même un univers attachant. Les amateurs pourront quand même se pencher sur l'impressionnant visuel, mais leur intérêt risque de décliner avant même la fin de ce premier volume. |

Cat's Eye
Certains souvenirs d’enfance ne gagnent pas à être ravivés. C’est particulièrement le cas lorsque l’on revient auprès des séries d’animation qui nous ont marqué, voire traumatisé, quand nous étions petits. Car pour un Lady Oscar ou un Albator ayant relativement bien supportés le poids des ans, nombreux sont les programmes à avoir été définitivement abimés par le temps qui passe. Le cas de Cat’s eye est particulièrement sensible, tant cette série aura eu un impact des plus conséquents sur toute une génération. En effet, si vous étiez une petite fille, vous aviez ici votre propre version des Drôles de dames, avec ce qu’il faut d’action bien gentille, de suspens pas trop effrayant, de gadgets amusants et de romance un peu niaise. Et si vous étiez un petit garçon, il est fort probable que vous ayez connu certains de vos premiers émois érotiques devant la plastique très généreuse de ces trois donzelles dessinées, souvent prises dans des situations plus ou moins fortement évocatrices (douches, plages, kidnappings, multiples sous-entendus assez osés…).
Que reste-t-il de tous ces souvenirs émouvants 20 ans plus tard ? Malheureusement pas grand-chose, la série révélant immédiatement ses limites en rappelant son plus gros défaut : l’absence d’une véritable progression dramatique. A part un vague prétexte (la recherche du papa disparu au travers de la reconstitution de sa collection d’œuvres d’art) et des enjeux toujours identiques (les filles vont-elles se faire prendre, vont-elles réussir à voler l’objet convoité, Quentin va-t-il enfin dépasser sa trisomie latente et réaliser que Tam est une Cat’s eye ?), il ne se passe rigoureusement rien au sein des épisodes de la série. A quelques exceptions près, tous les chapitres n’entretiennent aucun lien avec ce qui a précédé, et tous pourraient en fait se situer n’importe où au sein de l’histoire (de surcroît il y a ni véritable pilote, ni conclusion).
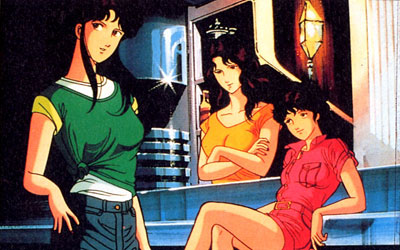
Il faut alors se tourner vers d’autres aspects, mais là encore on ne peut être que déçu. Le suspens est inexistant (les filles s’en sortent toujours et Quentin est aveugle jusqu’au bout), les intrigues sont extrêmement répétitives et généralement peu passionnantes, l’humour tourne toujours autour des humiliations des policiers, la mise en scène est très primaire (à part faire courir les demoiselles dans d’interminables couloirs, il n’y a pas beaucoup de dynamisme). Autre point qui possède un certain charme pervers, le côté ultra 80 de l’esthétique générale. Tenues d’aérobic, musique disco, couleurs flashy, féminisme bon enfant et technologie de l’époque, tout concourt à faire de Cat’s eye un instantané d’une décennie au goût souvent assez douteux.
Évidemment il faut conclure en évoquant les tenues légères et les poses suggestives qui ont très largement contribué à la popularité de la série et à son culte toujours vivace. S’il faut bien reconnaître qu’avec un regard adulte on est toujours très surpris par l’audace de certaines images (rien que le générique (malheureusement en japonais seulement) avec ses contorsions ambiguës) et que certaines situations ont un reste de saveur (Quentin se fait régulièrement draguer et manipuler par les trois filles en même temps), la médiocrité technique de l’ensemble ainsi qu’un character design plutôt grossier ne rend pas vraiment justice aux intentions des auteurs. Bien sûr, la nostalgie peut aider, mais ceux qui oseraient découvrir Cat’s eye aujourd’hui risquent de tomber des nues (sans jeu de mots trivial). |

Lady Oscar
Adaptation animée d’un manga fleuve (près de 2000 pages) Les Roses de Versailles de Riyoko Ikeda, ,dessiné au début des années 70, Lady Oscar demeure l’une des séries japonaises emblématiques des années 80. Phénomène de société au Japon, où il provoqua un grand intérêt pour la France, le récit hautement tragique de l’existence de Oscar François de Jarjayes possède tous les atouts des plus grandes œuvres romanesques. En effet, rarement petite et grande Histoire ont été si bien entremêlées, s’alimentant mutuellement et engendrant une intrigue, non seulement prenante par le sort réservé à ses protagonistes, mais aussi par la longue marche vers la Révolution Française. Quasi entièrement dénuée d’humour, très fidèle aux faits et aux personnages historiques, la série Lady Oscar n’hésite jamais à adopter un ton franchement adulte, plein de violence et de passion.
Elevée sous les apparats d’un fils militaire, Oscar permet aux auteurs de redonner leur place aux femmes au sein de cette époque tourmentée. Du point de vue de la plus haute noblesse (Marie-Antoinette est la figure majeure de la première partie du récit), Lady Oscar s’oriente peu à peu vers le sort et le triomphe du peuple. Evitant ainsi le manichéisme, le scénario essaie d’expliquer, voire de justifier, les actes de tous les partis, renforçant les aspects les plus douloureux du déroulement inéluctable de ces journées qui ont changé notre monde. Portée par le cours de l’Histoire, Oscar se révèle à elle-même et surtout accepte les élans de son cœur, le romantisme, omniprésent mais en aucun cas niais, étant l’une des forces de la série.

Jamais répétitif ou infantile, Lady Oscar surprend aussi par sa mise en scène de grande qualité, très lyrique et fréquemment figée en des crayonnés fixes de toute beauté. Si l’animation des personnages demeure généralement assez basique, le character design possède beaucoup de charme et l’ensemble est d’un dynamisme rare. La partition musicale réserve aussi quelques thèmes marquants et, mis à part une poignée d’anachronismes, se révèle en parfaite adéquation avec l’époque décrite. Outre Oscar et Marie-Antoinette, les seconds rôles sont tout aussi inoubliables, qu’ils soient nobles comme Axel de Fersen ou du peuple comme Rosalie et même les « méchants » sont exposés avec des nuances bienvenues (comme par exemple Jeanne de Valois ou la Comtesse de Polignac).
Si aucun d’entre eux n’échappera à un destin plus ou moins dramatique, c’est l’amour impossible entre Oscar et André Grandier, son frère de lait, qui forme le cœur de la série. En n’épargnant aucun détail du calvaire de ces deux êtres enflammés, le récit culmine sur une poignée d’épisodes bouleversants, parmi ce que l’animation japonaise a pu nous offrir de plus intense. Parcourue d’un bout à l’autre par une exaltation visuelle et narrative hors du commun, Lady Oscar étonne sans cesse par sa maturité et ses multiples qualités. Chronique historique d’une précieuse justesse, traversée d’un souffle romanesque unique, c’est aussi, sans doute, la série de notre enfance ayant le mieux supporté le poids des ans et méritant donc la plus immédiate et enthousiaste des redécouvertes. |

DearS
L'univers du manga (et de l'anime) sait toujours cultiver une grande part d'érotisme. Peu de séries aux prétentions comiques ne se conçoivent sans leur dose de sous-entendus égrillards ou d'ingénues généreuses. De Ranma 1/2 aux premiers Dragon Ball en passant par le plus récent Chobits, l'otaku trouvera toujours matière à titiller sa libido, parfois de manière raffinée mais le plus souvent grâce à des trivialités plus ou moins de bon goût. Ce quota est appelé « fan service » et se retrouve même dans les séries aux ambitions plus affirmées, à l'image du grossier Gantz qui n'est qu'un vaste réservoir à pornographie de bas étage. Fort heureusement, le DearS, créé par Peach-Pit, est très loin de tout cela et vient plutôt se ranger, aux côtés de certaines aventures de l'inoubliable Lamu, dans le domaine de la sucrerie intersidérale.
DearS se révèle être un vaste best of des fantasmes de l'animation japonaise, l'argument de base étant on ne peut plus révélateur : Takeya, un jeune lycéen, peu enclin à accueillir au Japon les créatures extra-terrestres nommées DearS (essentiellement de sublimes demoiselles aux formes inconcevables), rencontre l'une d'entre elles qui s'auto-proclame son esclave. C'est même la phrase d'accroche : « Je suis ton esclave
». Pas besoin de vous en dire plus, vous imaginez déjà les situations pittoresques qui peuvent découler de ces prémisses. Surtout que toute la série baigne dans une légèreté jamais démentie où le moindre second rôle ne pense qu'à ça (pour meilleur exemple, la prof d'anglais nymphomane qui fait traduire des récits érotiques en classe et ne cesse de harceler ses élèves déconfits). Mais nulle crainte à avoir, le mauvais goût est ici absorbé par un burlesque réjouissant, un rythme soutenu et surtout une excellente galerie de personnages très attachants.

DearS s'assume pleinement en tant que divertissement coquin, jouant la carte de la sensualité primesautière, de son générique d'ouverture humide à son générique de conclusion ultra dynamique (et à reprendre en chur) en passant par un « character design » primitif mais qui sait insister là où c'est nécessaire
Montrer sans montrer, aller très loin sans jamais tomber dans le X et surtout ne jamais se départir d'un humour omniprésent, comme l'incarne fort bien le recourt fréquent aux personnages « super deformed » (stylisation outrancière permettant d'exagérer les réactions des protagonistes, colère ou surprise en particulier, les fans du Collège Fou Fou Fou savent de quoi je parle). Si le scénario n'est qu'un charmant prétexte, il faut reconnaître que dès les 4 premiers épisodes de DearS on se laisse facilement séduire par la fraîcheur, la fantaisie et la volupté de ces opulentes aliens
Après une introduction tout à fait charmante, ce second volume de la série DearS se révèle relativement décevant. D'une part car il n'y a que trois épisodes proposés, et essentiellement parce qu'il ne se passe pas grand-chose de nouveau dans le monde des extra-terrestres sexy à part l'arrivée de la petite sur du personnage principal. L'histoire stagne en se focalisant sur des données déjà largement explicitées dans la première partie (Ren est un modèle différent des autres, les DearS sont des esclaves, etc
) et parce que les protagonistes n'évoluent pas d'un iota. Les hésitations du héros face à l'agressivité sensuelle de Ren (qui manque littéralement de le violer à la fin de l'épisode 5) tombent dans le surréalisme le plus total et on se demande bien si cela va nous mener quelque part ou si les créateurs de la série hésitent véritablement à franchir le pas d'un érotisme déjà omniprésent et véritable moteur (et intérêt) de l'oeuvre.

Car si DearS réserve quand même son lot de gags et de situations triviales, le manque de profondeur de l'ensemble commence à se faire sentir, et on se rend compte que nous sommes là à des années lumières d'un chef-d'oeuvre tel que Fruit Basket. Certes, les ambitions sont ici très inférieures, la série se voulant totalement légère, gentiment décérébrée et coquine mais point trop. Si les DearS demeurent séduisantes, leurs aventures persistent à manquer d'envergure et tombent peu à peu dans le répétitif. Fort dommage, l'imagerie et des thèmes sado-masochistes mélangés à un univers « kawaï » (donc ultra mignon) avec une bonne dose d'humour outrancier possédant un vrai potentiel (pour preuve les réjouissants génériques d'ouverture et de fin). Malheureusement ce n'est pas à la lumière de ces nouveaux épisodes que l'on pourra vraiment juger de la qualité d'ensemble de la série et il n'y a pas pour l'instant beaucoup plus à DearS...

Après un second volume décevant révélant une baisse certaine du rythme et de la folie de la série DearS, ce troisième DVD retrouve toute la verve qui avait pu nous séduire au début. Les épisodes 8 et 9, en développant les personnages de Myu et de Neneko, s'avèrent touchants, ce qui est finalement assez inattendu au sein d'une série aussi légère, voire délurée. Notre intérêt est relancé et se trouve largement récompensé avec le dixième épisode, bien nommé « C'est la boule dorée », entièrement situé dans une gigantesque maison de bains publics.
Très explicite dans l'érotisme, avec les plans et les gags les plus crus de la série, ce petit délire sans temps mort se révèle particulièrement drôle et décomplexé. Certes, ce n'est pas très fin, et pas forcément très original, les quiproquos sont bien connus et le fan-service est omniprésent. Mais c'est sans doute ce que l'on vient chercher auprès de DearS et nous ne sommes pas là pour parler métaphysique ou grands sentiments. La bonne humeur générale est attachante et l'on passe un bon moment. |
|
|
|