|

Avalon
de Mamoru Oshii
Quatrième vision d'Avalon. Et le film grandit de plus en plus en moi. Au début je me suis dit que c'était un long-métrage sublime, plein de mystères, prêt à devenir culte. Puis je me suis dit que c'était un chef-d'œuvre, peut-être plus fort encore que Ghost In The Shell. Et maintenant j'en suis sûr, Avalon est de la trempe de ces œuvres qui peuvent changer la vie des spectateurs et même toute l'histoire du cinéma. J'ai comparé avec enthousiasme Avalon et La Nuit du Chasseur, je me rends de plus en plus compte que ce "sacrilège" était parfaitement justifié. Le film d'Oshii dépasse tous les cadres d'un genre bien défini. Par ses aspects novateurs, aussi bien invisible (la retouche par ordinateur de pratiquement tous les plans du film) qu'omniprésent (le sujet traité, qui paraît encore très "abscons" pour la majorité des spectateurs), Avalon a tout de l'œuvre qui change le monde. L'incompréhension d'une partie de la critique (la plupart sont restés totalement "hors" du film) et du public (le grand public n'est toujours pas prêt pour Citizen Kane ou Andrei Rublev, c'est évident), ne fait que servir Avalon. Mais ce sont des considérations bien éloignées de ce que je ressens.
Ce que je ressens après cette nouvelle vision ? Une émotion torrentielle. J'ai pleuré devant le film, en fait j'ai pleuré pendant presque tout le dernier quart d'heure du métrage. Mon rythme cardiaque s'est accéléré, j'ai vécu le film de l'intérieur, plus intensément que toutes les fois précédentes. Chaque image d'Avalon me bouleverse, chaque idée me transforme, chaque note m'assassine. Et, attention je révèle un moment clef du film, quand Ash entre dans le monde en couleur de la Class Real, j'ai ressenti la même émotion que quand Dorothy ouvre la porte sur le monde de Oz. Même si en fait la comparaison la plus juste serait celle de la Zone de Stalker. Stalker, encore et toujours, auquel Avalon fait inévitablement penser, mais ce n'est pas bien important. Car Oshii raconte finalement un peu la même histoire que Tarkovski (la Zone est un monde plein de piège et de faux semblants, basée sur la répétition jamais vraiment identique et qui finit par exaucer le voeux de celui qui découvre la "chambre cachée"), mais avec d'autres moyens et un tout autre contexte (les jeux vidéos).
Avalon est un film qui capte comme aucun autre l'avenir le plus proche de notre monde. Ni Fight Club, ni évidemment le plus en plus pathétique Matrix, ni aucun autre film récent n'a su approcher à ce point l'essence du "21e siècle" (quoi que cela puisse vouloir dire). Ah et puis c'est la dernière fois que je veux voir associer les termes "Matrix" et "Oshii" ou "Avalon". C'est un peu comme si l'on comparait 2001 et Tomb Raider, Citizen Kane et Belphegor. Ces deux films n'ont absolument rien à voir. Lire pour cela l'interview d'Oshii dans le dernier Mad Movies. Il le dit lui-même : les frères Wachowski ont voulu faire un film léger et divertissant où on laisse son cerveau aux vestiaires ; lui a voulu raconter une errance métaphysique avec quelques effets spéciaux grandioses au service de son propos (et non l'inverse).
Quoi qu'en dise The Dude, la musique d'Avalon met autant de frissons dans tout le corps que celle de Ghost In The Shell. Et il n'y a pas tant de choses à ajouter, Avalon s'inspire à la fois de centaines de sources (des légendes arthuriennes au cinéma européen, de la culture "nerd" au RPG online, du cinéma muet au film noir hollywoodien), le grand film "somme" c'est celui-ci. Alors, oui, je suis désolé, mais tout le reste de la production cinématographique paraît bien fade à côté d'Avalon. Tiens, au fait, on disait de Ghosts Of Mars qu'il offrait à ses héros des postures mythiques jouissives. Certes, mais alors que dire des protagonistes d'Avalon ? Qui ne cesse d'un plan à un autre (et pas seulement dans le final) de resplendir comme les plus beaux icônes qui soient (oui, oui, icônes, au sens... tarkovskien...). Si le Legend of Zu de Tsui Hark est la surenchère ultime en matière de spectaculaire sur grand écran, Avalon va plus loin, tellement plus loin. Offrant à la fois du spectaculaire monstrueux (toutes les scènes d'action), du spectaculaire discret (tout le visuel et l'ambiance sonore du film), de l'intensité dramatique à s'évanouir, de la réflexion d'une actualité, d'une justesse et d'une profondeur terrifiantes...
Avalon grandit en moi à une telle vitesse que je commence à avoir peur. C'est déjà l'un de mes films favoris de ces dernières années. A ce rythme, dans un an il fera parti de mes films favoris de tous les temps. Et dans dix ? Je fais toujours preuve de tellement d'enthousiasme aveugle et lyrique pour tout ce qui me plaît que je ne sais plus comment vous faire vraiment comprendre ce que je ressens pour Avalon, combien j'aimerais vous convaincre d'aller le voir, de le revoir, de l'adorer, combien je voudrais écrire des pages entières parfaitement inutiles pour radoter toujours les mêmes choses. Mais zut ! Tant qu'il y aura encore des personnes pour remettre en doute l'importance de ce film, tant que tant de gens passeront à côté de l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma (je persiste et je signe) pour mieux se jeter dans les bras d'œuvres franchement insignifiantes mais plus "abordables" (ou du moins qui ne demandent pas de réfléchir beaucoup, ça fait mal à la tête de réfléchir beaucoup, et Avalon est un film qui fait mal à la fois à la tête et au cœur si on s'abandonne à lui, mais après on en sort différent, meilleur, guérit, plus humain, mais je m'emporte). Donc tant que le monde dormira loin du chef-d'œuvre de sagesse et de doute de Mamoru Oshii, il faudra des excités comme moi, pour hurler encore et encore : Avalon va changer votre monde, Avalon va changer le monde. Oshii a tout simplement ajouté sa contribution gigantesque aux Contes du Graal. Rien que cela. Et plus encore...
Comme la Divine Comédie est bien plus qu'un poème lyrique, comme De La Nature est bien plus qu'un traité de philosophie, comme Guernica est bien plus qu'une peinture, comme la Bible est bien plus qu'un livre, comme le Requiem de Mozart est bien plus que de la musique, comme From Hell est bien plus qu'un Comic, Avalon est bien plus que du cinéma. Il y avait une âme dans la coquille, maintenant il y a une âme dans le jeu vidéo. Il y a une âme dans ce film.

Legend of Zu
de Tsui Hark
Dans notre petit monde occidental il ne nous en faut pas beaucoup pour être impressionné. Regardez, ne lisez-vous pas ici ou là, n'entendez-vous pas ici ou là, que Star Wars est la plus grande saga de l'histoire du cinéma, que Le Seigneur des Anneaux par Peter Jackson est le plus beau film du monde, que le grand spectacle se nomme Spielberg, que le cinoche qui dégage c'est Michael Bay, Joel Silver & co et même que Matrix est un super film ? Sans ôter les qualités indéniables de certaines œuvres (enfin... pas Matrix quand même), on en connaît un, loin de notre univers, qui se poile doucement. Cet homme (euh... ce super-héros, pardon), vient d'une autre galaxie et ce n'est pas Capitaine Flam, il travaille 25 heures par jour, possède facilement 20 chefs-d'œuvre absolus dans sa filmographie (non ce n'est donc pas Kubrick), peut enchaîner 3 merveilles en un an (non ce n'est vraiment pas Kubrick) et il est l'heureux papa du plus grand film de tous les temps de l'histoire du cinéma de partout de l'univers entier pour toujours (The Lovers, si vous n'aviez pas suivi). Son nom n'est pas Personne, mais c'est bien Tsui Hark. L'homme qui filme plus vite que son ombre tout en produisant-dirigeant cinq projets parallèles en même temps. C'est objectivement le réalisateur le plus doué de notre époque et subjectivement le vrai géant actuel du 7e art.
On s'est beaucoup gaussé de son escapade aux USA (deux vandammeries très très drôles et pas si indignes que cela), le King Tsui n'était pas content. Il avait failli. Et un Dieu, et même un demi-Dieu, ne faillit jamais. Il s'était laissé tenté par les sirènes de l'occident. Et il avait refusé (inconsciemment sur Double Team et parfaitement consciemment sur Piège à Hong-Kong) de se laisser happer par l'uniformisation du "style HK" qui nous a donné des films aussi mignons que totalement vains (voire franchement nases) tels que Volte Face, Tigre et Dragon ou The One. La revanche de King Tsui (monsieur est susceptible comme tous les génies (et mesquin aussi, forcément)), allait être terrible. Et elle le fut au-delà de toutes les espérances. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas finie.
Tsui Hark revient à HK en claquant la porte derrière lui. Il rumine un peu. Et quand on lui annonce que Lucas reprend du sévices (service, pardon) et que Peter Jackson prépare LA saga que le cinéma occidental attend depuis toujours, il déploie ses ailes titanesques, fait retentir son rire démoniaque (en particulier à la vision de la Menace Fantoche), enfile sa vieille paire de lunettes noires et prépare la fessée déculottée que le cinéma mérite. Les rumeurs sont alors aberrantes : Zu 2, Black Mask 2, The Blade 2, etc... Tout est vrai. Des suites, certes, mais finalement Star Wars et le Seigneur des Anneaux c'est encore moins original. Et ce n'est pas que ça va faire mal, non, ça va être pire. L'Apocalypse maintenant, tout de suite, sans plus attendre. Enfin, si, il faut attendre, car l'occident ne veut pas d'une telle humiliation. Car Legend Of Zu écrase tout. Legend Of Zu de monsieur Hark, couplé au Avalon de monsieur Oshii, et tout s'effondre, tout s'écroule, plus rien n'existe, les tops de nerds sont chamboulés, personne ne veut comprendre, personne ne peut résister, tout est trop, et monsieur Tsui, oui, sans complexe, comme ça, en claquant des doigts (ou presque) vient de signer le film le plus "trop" de l'histoire du cinéma. Et pan. Et toc. Et zou ! (hum...) Et hop ! Etonnant, non ? Et bien non. C'est du Tsui Hark. Alors, forcément...
On va me dire que je suis bien brutal et conquérant dans ma présentation de Legend Of Zu, c'est vrai, mais ce film est une telle baffe. En son temps, le premier Zu était une réponse à Star Wars et il demeure un spectacle hallucinant, trop rapide, trop spectaculaire, trop fou, trop inhabituel, divertissant et épuisant. Le nouveau Zu, finalement c'est la même chose, mais en beaucoup plus. Beaucoup beaucoup plus. Time and Tide c'était la balle dans la tête pour bien rappeler au monde qui est le Patron. Legend Of Zu c'est le monument terrifiant qui sera plagié à qui mieux-mieux dans 10 ans. Les frères Wachowski sont encore en train d'essayer de comprendre et d'imiter les menus du DVD de Legend Of Zu, et c'est pas gagné.
Et donc ? Et bien Legend Of Zu c'est une fresque épique d'environ neuf heures, condensées en 1h40. Ca donne une certaine idée de la chose. Et visuellement ? Du sublime absolu qui explose dans tous les coins et qui va plus vite que la lumière. Malheureusement, CGI obligent, le tout baigne souvent dans un gris-bleu un peu tristounet. Mais parfois ce sont les roses et les oranges qui miroitent et là on en pleure de bonheur. Le casting est parfait, en particulier la toute belle Cecilia Cheung et une Zhang Ziyi quasi figurante, à laquelle Hark offre cependant un bref combat de sabre qui vaut à lui seul tous ceux de Tigre et Dragon. Sammo Hung en "maître gros sourcils" est tout aussi génial que Cecilia Cheung en Enigma et que Ekin Cheng en King Sky. La musique, très épique, colle parfaitement aux images, elle est "trop".
Mais un simple avis à l'emporte-pièce comme le mien est bien minuscule face à Legend Of Zu. Aux côtés de The Blade et de Green Snake, ce film prend logiquement sa place. Et après Time and Tide, il nous rassure définitivement sur la pêche de Tsui Hark. Il est toujours le meilleur, le plus fort, le plus dingue, le plus génial. Et ce n'est pas près de changer. On s'incline ! Et plus bas que cela ! Et vite ! Hop ! Hop ! J'en vois un là-bas qui n'a pas mis genou à terre ! Sûr qu'après avoir vu quatre fois d'affilées Legend Of Zu, il n'aura même plus la force de se relever. On pourrait parler de miracle en évoquant ce film, mais il n'en est rien, ce n'est pas un miracle, bon sang, c'est un film. Mais quel foutredieu de diantre de mazette de film !

Le Voyage de Chihiro
de Hayao Miyazaki
Oui, je pars avec au moins deux gros handicaps en évoquant Le Voyage de Chihiro. Tout d'abord, j'arrive quelque peu après la bataille. Tout le monde a déjà vu le film au moins une fois et tout le monde a donné son avis. Ensuite, et surtout, on commence à avoir l'habitude, du moins pour les plus fidèles d'entre vous, de voir Edwood s'enthousiasmer au-delà du raisonnable et d'une certaine façon "unifier" toutes les œuvres qu'il aime en un concept très réducteur par son emphase même, le concept de "plus grand film de tous les temps chef-d'œuvre absolu trop génial que l'on ne peut pas vivre sans". Alors, là, maintenant, quand j'arrive en vous annonçant que le Voyage de Chihiro est le meilleur film de Miyazaki qu'il m'ait été donné de voir (à égalité avec Totoro, quand même) et que c'est VRAIMENT un chef-d'œuvre, cela peut vous laisser de marbre. Surtout que vous avez déjà votre idée sur la question et que vous attendez au minimum que j'argumente un peu, voir, au mieux, que je vous explique des choses que vous n'avez pas aperçues dans ce "chef-d'œuvre".
J'ai de plus en plus de mal à parler de ce que j'aime. Ou du moins, j'ai de plus en plus tendance à simplifier mon propos. J'aime parce que cela me touche. Plus que jamais, j'aime ce qui me plaît. Alors je pourrais vous dire pourquoi, moi, aujourd'hui, j'aime à crever le dernier Miyazaki. En même temps j'aimerais vous convaincre et vous ouvrir les yeux encore plus grands qu'ils ne le sont déjà. Je vais donc vous dire, avec une argumentation pleine de failles, pourquoi le Voyage de Chihiro ne peut que changer votre vision du monde.
Comme le présente Miyazaki lui-même, le Voyage de Chihiro s'adresse en priorité aux petites filles de 10 ans. En poussant un peu on doit pouvoir aussi englober les petites filles de 8, 9, 11 et 12 ans. Pour ces petites filles, quels que soient leur pays, leur culture, leurs préoccupations, pour elles toutes, Le Voyage de Chihiro est peut-être le meilleur film de l'histoire du cinéma. Vous allez me dire, vous qui me lisez, que le meilleur film de tous les temps dédiés aux fillettes de 10 ans ne vous touche a priori pas particulièrement. Mais ce que vous n'imaginiez pas, c'était que l'inconscient et l'imaginaire des fillettes de 10 ans est en grande partie le même que le vôtre. Et ce qui les effraie, ce qui les rassure, ce qui les fait rire, ce qui les émeut, ce qui les fait rêver, ce qui les fait réfléchir, ce qui les fait espérer, tout cela est identique dans votre esprit, et aussi, j'ose le dire, même si le concept est galvaudé au-delà du raisonnable, identique dans votre cœur. La première force du Voyage de Chihiro c'est son universalité. Vous allez rire aux mêmes moments que les fillettes de 10 ans, vous allez pleurer avec elle, vous allez avoir peur avec elle. Si vous acceptez de vous abandonner à ce qu'il y a de plus intime en vous, vous allez découvrir que le Voyage de Chihiro parle tout simplement de ce qu'il y a de commun entre la fillette de 10 ans, le nerd de 20 ans, le papy de 70 ans, la femme active de 35 ans, le père de famille de 43 ans : l'humanité.
Mais ce n'est pas tout, car si cette universalité quasi inédite suffit de faire de Chihiro un grand film, elle est complétée par son inverse. C'est à dire un soucis du détail et de la référence hors norme. Profondément ancrée dans la culture japonaise, riche en personnages qui existent tous en quelques scènes, portée par un rythme exigeant, l'histoire du film ne cherche en aucun cas l'abstraction. Car les films "universels" sont souvent de grands films abstraits. Ils sont parfois universellement compréhensibles car pratiquement sans paroles (de 2001 à Tarkovski en passant par, forcément, Chaplin ou Lang), alors que le Voyage de Chihiro est une œuvre sur l'importance du "parler juste", du sens des mots, de la communication, de la valeur de l'identité. Le Voyage de Chihiro est un hymne à l'identité, à la mémoire, à la quête de soi, qu'elle soit boulimique ou introspective. C'est un hymne à la recherche de la stabilité, de l'amitié, de la famille, du travail, de la connaissance, de l'amour. Bien plus qu'un récit initiatique, le Voyage de Chihiro dépasse le cadre didactique pour nous murmurer de la philosophie comme si c'était une comptine. La fillette de 10 ans et l'universitaire de 45 ans se retrouvent alors, enfin, à égalité, face à ce débordement philosophique qui sait toucher à tous les niveaux, aussi bien par la parole que par l'image, par les symboles et par les silences.
C'est sans faire de bruit que Miyazaki installe une tension permanente, faite de surprises et de retournements de situation, où ce qui rassurait devient effrayant (la transformation des parents en cochons, le cannibalisme de Sans-Visage) et ce qui effrayait devient réconfortant (le vieux de la chaufferie, le Dieu "putride", le dragon blanc, la sœur jumelle de Yubaba...). Et on peut une nouvelle fois parler de suspens métaphysique qui conduit, dans un dernier quart d'heure totalement bouleversant, à la résolution de tous les conflits et de toutes les quêtes. Tout en réservant une nouvelle fois une fin entre joie et tristesse. Et l'histoire d'amour est une nouvelle fois une histoire de séparation et d'espoir. Comme les petites filles de Totoro vont attendre leur maman, comme Porco Rosso sera toujours attendu au rendez-vous des aviateurs, comme San et Ashitaka se promettent de se revoir, Chihiro et Haku vont vivre sans l'espoir de se retrouver. Un espoir d'enfance, qui peut que tous nous toucher, car tout le monde a eu un amour d'enfance, un amour d'enfance à l'image d'une rivière que l'on s'est promis de revenir visiter un jour. Mais dans Chihiro la rivière n'existe plus et le message écologiste de Miyazaki en est d'autant plus fort, bien plus fort que dans le trop grandiose Princesse Mononoke qui révèle encore plus ses allures d'œuvres froides et inachevées face à la réussite totale de Chihiro.
A la fois universel et doté d'une identité très affirmée, Le Voyage de Chihiro est un rêve d'œuvre d'art. Une œuvre qui réussit à la fois à toucher tout le monde, mais en donnant l'impression de nous parler directement comme à personne d'autre. Une œuvre qui réconcilie altruisme et égoïsme. Le Voyage de Chihiro est à la fois NOTRE conte à nous et le conte de TOUS. Car, peut-être comme personne avant lui, Miyazaki a choisit de considérer les enfants comme des adultes (Le Voyage de Chihiro est une œuvre violente, effrayante, complexe, mâture...) et de considérer les adultes comme des enfants (le Voyage de Chihiro est burlesque, mignon, sincère, rassurant). Et tout le monde trouvera son bonheur. De la petite fille qui va vibrer avec Chihiro, du petit garçon qui va se faire des histoires avec des dragons et des "Sans-Visage", de l'ado cinéphile qui va chercher les références aux autres films de Miyazaki (voir à Akira...), de l'adulte qui va retrouver ses traumatismes et ses émerveillements d'enfant à la personne âgée qui trouvera là l'occasion d'une nouvelle jeunesse.
Après, il paraîtra presque inutile d'insister sur les qualités formelles du film, elles sont essentielles et en même temps secondaires. Oui c'est une merveille visuelle et musicale (de nombreux thèmes discrets par l'indispensable Joe Hisaishi), et l'on peut dire que le fond et la forme sont sur un pied d'égalité. Mais il serait aussi criminel, ou du moins contradictoire, de faire de ce film un "objet". Le Voyage de Chihiro est tout autant un objet, que l'esprit humain est un objet. Certains ont transformé la personne en objet d'étude et ne se priveront donc pas de faire du film de Miyazaki un beau sujet de dissertations et de statistiques. Mais c'est tellement réducteur que l'on se sent presque insulté dans son intimité. Oui, il y a une sublime scène de train ; oui, il y a de l'humour fin et enfantin tout à la fois ; oui, il y a la plus belle chanson de générique de fin de l'histoire du cinéma (les paroles sont un chef-d'œuvre de poésie à elles-seules et toute la synthèse du film), mais le Voyage de Chihiro ne parvient pas à être disséqué, et l'essentiel ne fera toujours que nous échapper et plus nous réfléchissons, plus l'indicible s'évade de nos filets. Comme le Jack l'Eventreur poursuivit par le Alan Moore scénariste de From Hell (le Comic, hein, pas le film), le Voyage de Chihiro s'envole dès qu'on l'approche et sa magie peut être tout ou simplement rien. Le souffle du conte possède une infinité de raisons et pourtant ne sortira jamais du cadre de ces deux heures qui peuvent, et oui, et oui, changer le monde.
Le Voyage de Chihiro est une expérience personnelle, au sens le plus fort et le moins galvaudé de l'expression. Miyazaki a voulu que son film s'adresse directement à notre Moi, sans passer par la raison, sans passer par la réflexion. Miyazaki est plus que jamais le cinéaste du sentiment et de la sensation. Peur, rire, tristesse, joie, tous les sentiments humains, dans toute leur force, surgissent du Voyage de Chihiro. Et en conclusion, Miyazaki s'offre sa plus belle scène "aérienne", le résumé de sa carrière, le résumé de ce qu'il voulait nous dire. Et dans ces quelques instants qui touchent les étoiles, il nous offre l'essence de l'amour et du souvenir, de la reconnaissance et du plaisir, l'essence du rêve et d'une humanité qui n'en finit plus de se chercher. Cette humanité en quête de la main tendue, réconfortante et douce, qu'elle effleure et qu'elle quitte à regret pour poursuivre son voyage.

Le Seigneur des Anneaux - Les Deux Tours
de Peter Jackson
Entendons-nous bien dès le début, les Deux Tours est un spectacle fastueux que je trouve largement supérieur aux films de divertissement habituels. Maintenant nous pouvons nous jeter en paix au cœur de la bête. La première vision du film m'a paru assez interminable et m'a procuré de l'hilarité et une migraine. La deuxième vision m'a paru plus courte et m'a procuré plus d'émerveillement et une migraine. Le métrage est long, c'est le cas de le dire, trois grosses heures, et parfois rythmé à la truelle. On saluera le tact de Jackson qui a pris la peine de fractionner la bataille du gouffre de Helm, qui autrement aurait été un puissant casse-méninges, à côté duquel les films Dogmes auraient ressemblé à des épisodes du Renard.
Mais trêve de plaisanteries, si on ne peut être qu'heureux de la présence de certaines scènes, notamment un saisissant détour dans Osgiliath assiégée en toute fin de métrage, d'autres semblent ajoutées par complaisance ou pour surligner sans cesse les enjeux de l'histoire. Nous avons donc par exemple droit à un lourd monologue de Saroumane, ainsi qu'à une apparition surprise de la toujours drôle Galadriel (quelles mignonnes ptites zoreilles !). Même si on peut penser que la présence de Cate Blanchett a peut-être à voir avec des clauses contractuelles, les apparitions de Elrond et d'Arwen, contrairement au premier film, brillent par une grande beauté visuelle triste. Ainsi que par la présence d'un désormais mythique "flash forward" d'une splendeur esthétique écrasante.
Pour le reste les Deux Tours en film souffrent du même syndrome que les Deux Tours en livre : ce n'est pas très passionnant ce qui se passe en Rohan. Pour détendre un peu l'aspect très dramatique du film (on ne plaisante pas des masses pendant trois heures, croyez-moi), on peut résumer en disant qu'ils aiment beaucoup les chevaux. Cependant c'est à Gripoil que Jackson réserve une simili pub Royal Canin assez tordante. Par ailleurs, une grande partie des scènes à Edoras et avec Theoden ressemble à s'y méprendre au 13e Guerrier, que Jackson n'a pourtant pas vu (ah ? ah...). Le 13e Guerrier, auquel on pense forcément souvent et la comparaison se fait généralement en faveur du chef-d'oeuvre de McTiernan. A revoir impérativement après la séance des Deux Tours, donc.
Pour ce qui est de la création, ou du moins de l'adaptation des personnages, il y a peu de demie-mesure. On y croit ou on n'y croit pas. Commençons par ce qui fait rudement plaisir. Le véritable héros du roman est aussi le véritable héros du film. Je veux bien sûr de parler de maître Sam. Sean Astin nous offre une interprétation sobre, sensible, sympathique et humaine. Il est le Sam que l'on a toujours imaginé et vole, comme dans le livre, la vedette au très fade Frodon. Elijah Wood ne fait pas grand chose, mais n'est pas souvent dans le ton. Heureusement Frodon est de plus en plus absent à lui-même. Pour le meilleur, essentiellement lors d'un plan sublime face à un Nazgul. De toute façon, il n'y a que Sam et Gollum.
Gollum justement, l'autre performance folle du film est celle d'Andy Serkis dans la peau virtuelle de Smeagol. Tout à la fois drôle, inquiétant, repoussant, touchant, effrayant, fascinant, Gollum est à la hauteur des énormes attentes. L'autre "héros" du Seigneur des Anneaux est crédible, bien plus que la plupart des acteurs bien réels. Rien que pour lui, le film est à voir absolument.
Autre personnage essentiel, la divine Eowyn est l'excellente révélation de cet épisode. Interprétée avec sobriété par la toute belle Miranda Otto, elle fait oublier Arwen en à peine quelques plans. Avec une actrice au charisme pareil, la bataille du Retour du Roi risque d'être bouleversante. LE personnage féminin du roman est une réussite touchante à l'écran, pour l'instant, c'est un sans faute pour monsieur Jackson.
Autres personnages attendus au tournant, les Ents. Pas de suspens, là encore c'est brillant. Sylvebarbe est un mélange de bonhomie rassurante et de menace froide. Le fait que les Ents ressemblent autant à des arbres qu'à des marionnettes, flagrant hommage à Jim Henson, ne fait que renforcer l'affection immédiate qu'on leur porte. Indissociable des Ents dans les Deux Tours, Merry et Pippin préparent doucement leurs contributions essentielles au Retour du Roi.
Theoden, dont le temps de présence à l'écran en fait presque le héros du film, possède une belle prestance et s'offre les scènes les plus épiques et arthuriennes. Bravo. D'autres seconds couteaux, qui ont ou qui vont avoir leur importance, comme Eomer et Faramir, sont tout à fait crédibles. Quant à Brad Dourif en Grima, il n'a jamais eu l'air aussi traître et vicieux, ce qui est une réelle performance au vu du lourd passif de ce grand acteur méconnu.
Mais qu'en est-il des autres survivants de la Communauté ? Et bien là, ça commence à déconner. Gandalf, quasi absent de cette partie de l'histoire, est aussi absent du film. Sa transformation en Gandalf le Blanc donne lieu à un suspens inutile et peu efficace. De surcroît, comme Saroumane, Gandalf souffre du syndrome "plus blanc que blanc", ce qui fait vraiment trop "tache" au cœur d'un film par ailleurs très boueux, sale et méchant. Je sais, c'est fait exprès, mais on peut trouver cela choquant de toute façon.
Legolas ne cesse de faire des trucs de jeux vidéos. Parfois pour le meilleur, comme lors de l'attaque des loups d'Isengard. Et parfois pour le pire, lors d'une ridicule descente d'escalier en pseudo skateboard. Heureusement Jackson lui réserve quelques beaux échanges avec Aragorn.
Gimli, ahlala, Gimli. Là, ça ne va plus. Gimli est devenu le quasi unique ressort comique du métrage. Alors si certains gags sont hilarants, cela devient rapidement embarrassant. Gimli est le bouffon de service, ce qui est un choix discutable. Notons qu'on rigole franchement moins avec les Elfes. Injustice ?
Par contre, le choix peut-être le plus discutable des Deux Tours est d'avoir fait d'Aragorn le héros quasi totalitaire de l'histoire (au moins pour ce qui ne concerne par Frodon et Sam). Viggo Mortensen se donne à fond, c'est certain. il sait que tout sa carrière se joue en même temps que les batailles de l'anneau. Mais on y croit difficilement. Le personnage persiste à manquer d'ambiguïté et d'humanité. Aragorn devient l'effet spécial le moins crédible du film.
En parlant d'effets spéciaux, ceux-ci sont parfois assez problématiques. Encore une fois le métrage vu en salles est quasi uniformément baigné d'un gris métallique lassant. Bon, passe encore, cela donne le ton de l'histoire. Mais la transition entre scènes retouchées et scènes naturelles est parfois assez refroidissante. Voir pour cela la plupart des séquences de jour à Helm's Deep. Il y a dans l'ensemble une véritable inégalité des SPFX, ce qui provoque par instant une brutale sortie du film. Quant aux spectres des Marais des Morts, cette fois qu'on ne me ramène pas les hommages au cinéma muet comme pour Galadriel, ils ressemblent vraiment au premier fantôme de Ghostbusters. La scène est belle, par ailleurs.
Pour rester dans l'inégalité, parlons aussi de la musique, qui navigue entre un rapidement exaspérant thème pompier pour séquences épiques et de très jolies partitions pour Gollum, l'anneau ou les elfes. Quant à la chanson finale, après Enya, c'est l'assez renommée fausse Bjork, Emiliana Torrini qui s'y colle. Si le morceau est plus sombre et intéressant que la bluette d'Enya, il faudra dire à Emiliana de cesser d'essayer d'imiter à tout prix sa compatriote islandaise. Ce serait mentir que d'affirmer que cette Gollum's Song n'est pas touchante, bien au contraire. Elle offre un début de générique de fin parmi les plus sobres et émouvants de ces dernières années. Et avouons-le sans rougir, cette chanson m'a plus emballé que tout le Vespertine de qui vous savez. On est aussi prêt à parier que certains trouveront très "branché" de faire une telle chanson pour un blockbuster. Hum... Certes... Tant qu'on ne se tape ni Moby, ni Sigur Ros pour le Retour du Roi, ça va...
Et Peter Jackson dans tout cela ?? Sa mise en scène demeure dynamique et prenante, même si elle reste toujours moins brillante que dans Fantomes Contre Fantomes. Il est même parfois étrangement complaisant lorsqu'il ne cesse d'enchaîner les ralentis et les mouvements d'appareils circulaires par hélicoptère. Une fois, ça va, deux fois aussi, on peut même être encore plus indulgent. Mais au bout de dix fois, ouhlala. Ca finit par se voir. Et là, même si on sait que ces mouvement remplacent les descriptions interminables de Tolkien, et bien on sort du film. La musique n'aidant pas beaucoup en général.
Bon, ouf, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, notamment sur une très belle scène sans SPFX où Theoden se recueille sur la tombe de son fils. Mais aussi sur les grossiers inserts de visages de femmes et d'enfants apeurés, tout droit sortis de Xena. On pourrait aussi parler des tendances kitsch du film, qui ne dépareilleraient pas dans un John Boorman. Mais il faudrait aussi évoquer la dernière demie-heure, qui navigue entre le spectaculaire magique et le ridicule pas possible. Et oui, je pense bien sûr à ce gag incroyable à base de flamme olympique. C'est jouissif, mais stupide. Et on passe soudain d'une bataille épique à Sacré Graal. Enfin, c'est tellement drôle, qu'on peut pardonner. Notez quand même bien, que l'on se demande si le trébuchement final était intentionnel ou non, tant on voit nettement le cascadeur se prendre les pieds dans le décor. Il faudrait aussi s'attarder sur le talent infini de Jackson pour "ouvrir" ses scènes de batailles. Entre l'arrivée des loups d'Isengard, la lente avancée des Uruk-Hais vers Helm's Deep et surtout la marche déterminée des Ents au son de choeurs elfmaniens, quand Jackson veut, bon sang, il peut !
En tout cas, bravo monsieur Jackson, votre film est bien la créature monstrueuse que vous nous aviez promise. L'année prochaine sera sans nul doute celle de votre triomphe.

Austin Powers dans Goldmember
de Jay Roach
On
ne voit pas tous les jours un blockbuster plein aux as, entièrement dédié au
culte de la blague en-dessous de la ceinture. Goldmember est bien
fichu, pas ennuyeux, parfois surprenant, parfois à se pisser dessus de rire
(c'est de circonstances). Le film carbure aux références, et les cinéphages ne
seront pas déçus. Même ceux qui ne partagent pas la culture "bis" de Mike Myers
pourront tout à fait être sensibles à ce qui se passe dans le machin. En
général, l'essentiel ne vole pas très haut. Pour tout vous dire, c'est même le
degré zéro de la construction comique. Il faut voir comment Myers peut tenir 10
minutes sur un gag pas drôle tournant autour de parties génitales en or ou se
taper un monologue sur l'odeur immonde d'un pet de Fat Bastard. Malgré tout, le
film a de la classe et de l'énergie et un rythme enfin soutenu. Le générique de
début est déjà culte, et c'est vrai que le film s'effondre un peu dans
l'enchaînement. Heureusement, le "bestiaire" d'Austin Powers est
désormais suffisamment riche pour faire surnager le film à la seule force des
numéros d'acteur. Donc on s'amuse tout le temps ou presque et par moment, c'est
le nirvana du comique (très) vulgaire et (assez) méchant. Les meilleurs gags
tournent autour de Mini-Me, en particulier lors d'une visite médicale à rouler
sous son siège. On apprendra aussi plein de trucs très intéressants sur
l'anatomie masculine, en particulier toutes les manières que nous pouvons avoir
pour faire notre gros pipi.
D'un point de vue, plus, euh... profond... le film est un incroyable bordel de
complexes d'Oedipe. On le sait depuis Star Wars, le gag du "tu es
mon fils", "elle est ma sœur", etc... est toujours d'une efficacité brutale. Il
suffit de se rappeler le merveilleux Toy Story 2 pour en convenir.
Si depuis le premier Austin Powers la thématique était déjà
présente (dans la relation entre le Dr. Evil et Scot), dans ce Goldmember ça vire à la foire total et le final du film devient un grandiose cri d'amour au
son de l'inévitable Burt Bacharach. Bah merde alors, non seulement Austin
Powers c'est drôle et crado, mais en plus ça nous dit que tout ce dont
nous avons besoin c'est d'amour. Et de niquer, aussi. Quand même, faut pas
croire.
Mike Myers est un acteur comique génial, uniquement égalé à l'heure actuel par
Jim Carrey (qui est peut-être le meilleur acteur du monde, doit-on le rappeler
?). Les multiples guest-stars sont un bonheur de tous les instants (je vous
cacherais le nom de la plupart d'entre elles, parce que sinon, c'est quand même
moins drôle). Le film pourrait être encore plus drôle, il faut l'avouer, mais le
succès ne fléchissant pas, un Austin Powers 4 semble envisageable,
et vu que la série fait des bons dans la qualité à chaque suite, le prochain
film risque d'être insoutenable. En tout cas, malgré des lourdeurs vraiment trop
lourdes, l'essentiel des gags fait mouche (c'est encore une fois le cas de le
dire, mais si vous n'avez pas vu le film, vous ne pouvez pas comprendre). A
retenir en particulier, outre à peu près toutes les scènes avec Mini-Me, une
épastrouillante parodie de clip de rap (bien plus drôle que celle du 2) et
quelques incroyables performances de Myers en Dr. Evil. Au final, Goldmember est une comédie incroyablement débile, dégueulasse et
tordante, à qui je décerne facilement le prix du meilleur générique d'ouverture
de l'année 2002. |

de Steven Spielberg
Ca
? Le meilleur film de Spielberg ? Cela serait faire bien peu cas d'un metteur en
scène que l'on peut détester, mais dont on ne peut pas nier le talent. Minority Report n'est en aucun cas le meilleur film de Steven Spielberg.
Il se classerait plutôt dans la catégorie de ses réussites mineures, plus voisin
d'un Jurassic Park que d'Empire du Soleil. A vrai
dire, dans ses deux premières heures, Minority Report retrouve une
partie du plaisir des Indiana Jones (gags à base de globes
oculaires et de vomis à l'appui). Avant de se vautrer assez sévèrement lors d'un
inter-minable final de près d'une demie-heure bien embarrassante. Niveau mise en
scène pure et dure, les meilleurs instants sont des reprises des coups de
tonnerre du Soldat Ryan mais en version SF. Dans ses moments les
plus maladroits, Minority Report est un douteux ballet de
mouvements de caméra circulaires. Pour ce qui est du scénario, c'est du K. Dick,
certes, mais ce n'est pas Blade Runner. Spielberg a transformé
Dick en un thriller très classique qui n'offre que très peu "d'évasion", là où
le chef-d'œuvre de Scott ne cessait de nous ouvrir des portes vers des
questionnements infinis et des plaisirs esthétiques sans pareil.
On
sent Spielberg tenté par les chemins de traverse, on le sent envieux du trône de
Kubrick, on le sent plein d'entrain lorsqu'il s'agit de mélanger métaphysique et
scènes d'action bien spectaculaires. Mais il n'ose pas, il reste sur le quai. Et Minority Report est un film bien moins "mâture" que Duel ou que Les Dents de la Mer... Même si l'aspect mielleux est plus
ou moins passé à la trappe (sauf dans cette putain de dernière demie-heure), le
film n'est pas très méchant, du moins pas beaucoup plus que Les
Aventuriers de l'Arche Perdue (revoir les deux films et comparer) et
sans doute moins que Le Temple Maudit et Empire du Soleil.
Non, Minority Report est un bon divertissement, par moments
supérieurs à Jurassic Park et par moments inférieur
(principalement dans cette saleté de dernière demie-heure digne des pires Hollywood Nights). Le film a ses mérites (notamment quelques excellentes
idées, quelques bons coups de poing dans la gueule et surtout une flopée de gags
hilarants). Mais il reste bien lourd, bien laborieux et bien coincé. Et surtout
incroyablement prévisible. Ce qui, pour un thriller de ce niveau, est
particulièrement handicapant. Il faudra maintenant passer le test de la seconde
vision et donc de la mort du suspens, pour savoir si ce Spielberg survivra au
temps. Mauvais signe, une semaine après la vision, peu de scènes restent gravées
dans la mémoire (l'entrée des Spyders dans l'immeuble, le regard halluciné de la
Precog, quelques traits d'humour plus ou moins fins, une partie de la fameuse
poursuite, un peu de la scène d'ouverture, mais encore trop de la vilaine
dernière demie-heure...). En tout cas, c'est un très bon divertissement. Et
c'est bien là l'essentiel.
|

de Roman Polanski
Un
film respectable, admirable, un grand sujet, un metteur en scène qui abandonne
ses vilains penchants pour panser les blessures de son passé. Une Palme d'Or à
la clef. Tout est logique, sans accroc, simple, un peu fastidieux par moments,
un peu longuet aussi, et parfois lourdement mélo. Mais la musique est très
belle, Adrien Brody joue très bien, la mise en scène évite en grande partie le
tape-à-l'oeil tout en réservant son lot de coups d'éclat. Le vrai problème de ce
film est sans doute d'arriver après tous les autres chefs-d'oeuvre évoquants la
Shoah. Bref, même si ce récit d'un pianiste "chanceux" qui passe la guerre
caché, possède son originalité et des aspects humains splendides, il vient
s'inscrire sans faire de bruit dans la filmographie de Roman Polanski. Il y
trouve une place à part, mais il ne fera jamais oublier que le cinéaste est
avant tout l'auteur de Rosemary's Baby et de Chinatown.
|

de Mark Romanek
Robin Williams voulait nous rappeler qu'il est un bon acteur et qu'il a parfois
envie d'être autre chose que le Dr. Patch ou le super prof qui va vous apprendre
à apprécier la vraie vie qui est bien oui alors chouette ! C'est chose faite
avec ce Photo Obsession où son aspect de gentil monsieur tout le
monde un peu pataud donne au personnage principal ce qu'il faut de tristesse
banale mais touchante. Mark Romanek, l'excellent metteur en scène du plus beau
clip de NIN (Closer, certes un plagiat des travaux de Peter Witkin, mais
bon, quand même), se fend d'un joli premier film. Un premier film dont
l'histoire principale n'est qu'un prétexte pour accumuler les détails et les
plans chiadés. Cette histoire principale est d'ailleurs assez embarrassante,
tant sa morale n'est pas des plus claires ni des plus palpitantes. Par contre
Romanek offre un grand moment de mise en scène pure et dure, notamment lorsqu'il
crée du suspens avec rien du tout et simplement avec le rythme images-musique.
Au niveau du plaisir ressenti en salles, c'est du tout bon.
Même s'il ne reste
rien une fois la porte de sortie franchie. Photo Obsession (One
Hour Photo en VO, c'est quand même plus classe et ceux qui prononcent Photo Obsechione comme des cons l'ont dans l'os), est un thriller plus
raffiné que d'habitude, visuellement très intéressant, avec un Robin Williams
attachant et au top de son niveau, mais aussi avec comme principal défaut un
scénario quasiment inutile et qui tire sévèrement l'ensemble vers le bas. On
peut s'ennuyer un tantinet (surtout au milieu du métrage), on peut trouver
certaines scènes ratées, mais on appréciera ce coup d'essai. Espérons juste que
Romanek n'a pas tout dit dès ses débuts et que le succès du film lui permettra
de se lâcher un peu plus la prochaine (parce qu'il reste définitivement trop
coincé, le petit). Quant à Robin Williams, une cure chez Shyamalan semble la
seule voie vers la guérison totale.
|
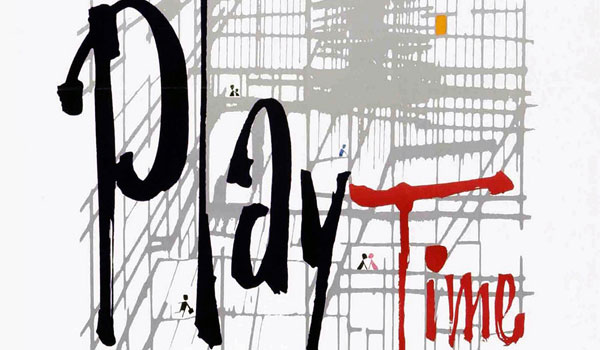
de Jacques Tati
Je
le dis ailleurs sur ce site, mais Jacques Tati
est toujours le meilleur metteur en scène à avoir foulé le sol français. La
ressortie de Play Time dans sa version intégrale restaurée (le
film est désormais en DTS) grâce à monsieur Deschamps (et aussi à Vivendi (!!!),
à GAN, à Arte, et à une flopée d'autres) est l'événement cinématographique de
l'année, loin devant un quelconque blockbuster. L'occasion de redécouvrir sur
grand écran que Play Time n'est pas seulement l'un des films les
plus novateurs, délicats et finalement beaux de l'histoire du cinéma, mais qu'il
est bien LE plus grand film français de tous les temps. Oui, je sais, c'est
excessif, cela ne veut pas dire grand chose, mais c'est la stricte vérité. En
salles, Play Time retrouve sa véritable dimension. Et les scènes
ajoutées avaient bien été coupées en dépit du bon sens. Par exemple, on ne
comprenait jamais comment Hulot passait de l'immeuble des bureaux à l'exposition
commerciale. Et bien maintenant on a droit à la transition dans un mouvement de
caméra entre portes transparentes (et un gag supplémentaire relatif aux
fauteuils qui font "pfffrout !", plus forts que les chevaliers qui disent "Ni
!"). De même, la séquence (franchement expérimentale) des appartements avec
fenêtre géante donnant sur la rue, d'une beauté sublime qui retrouve le génie
créatif des films muets, retrouve sa pleine durée. Elle atteint ainsi une
dimension quasi métaphysique qu'elle n'effleurait qu'à peine dans le montage
traditionnel. L'interaction entre les deux appartements y est décuplées et le
jeu sur la durée en devient kubrickien.
La
seconde moitié du film est restée la même, avec le plus grand moment de comédie
chorégraphiée de l'histoire du cinéma : le Royal Garden. On assiste à un
véritable ballet, où tous les détails agissent les uns par rapport aux autres.
Jamais l'image et la bande son n'ont été à ce point entrelacés (sauf chez Lynch,
par exemple, l'héritier avoué du cinéma de Tati). Et ce n'est qu'à la toute fin
du film que l'on retrouve un ajout bouleversant. Car la touriste américaine
entre avec Hulot dans le magasin, juste le temps de lui poser la main sur
l'épaule... Play Time apparaît alors comme le film synthèse de
l'œuvre de Tati et remplace Mon Oncle dans mon cœur. Le
chef-d'œuvre de Jacques Tati a fait peau neuve, et, avec le Voyage de
Chihiro et sans doute Avalon, c'est pour l'instant le seul film sorti en
salles cette année qu'il était IMPERATIF d'aller voir plusieurs fois. Play
Time meilleur film de l'année 2002 ? Sans le moindre doute !
|

de Alex de la
Iglesia
Le
nouveau film de Alex de la Iglesia est une véritable déception. Personnellement,
de la Iglesia, je suis fan depuis Action Mutante et Le Jour
de la Bête, deux perles de série B qui annonçaient le renouveau du
cinéma espagnol populaire. Mais petit à petit, après Perdita Durango et Mort de Rire (est-ce bien le titre français ?), on a compris
que le petit Alex avait trouvé le filon et se contentait de refaire toujours le
même film en changeant un tout petit peu le contexte. En gros : les personnages
principaux ne cessent de se tirer dans les pattes pour une raison ou pour une
autre. Chez de la Iglesia, tout le monde (ou presque) est logé à la même
enseigne, tout le monde est pourri, mesquin, violent, souvent bête et méchant.
Très méchant, même, si on se souvient de Action Mutante, premier
film coup de génie qui reste le meilleur du metteur en scène. Mes Chers
Voisins, c'est encore Action Mutante, mais en version
bourgeoise, peinarde, vieille, lourdaude. Pour essayer d'insuffler un peu
d'originalité dans son cinéma qui bat de l'aile, De La Iglesia rend "hommage" à
Hitchcock (et presque inévitablement aussi à De Palma). Non, mais là, ce n'est
plus de l'hommage, c'est carrément de la parodie plan par plan. Du générique du
début aux cadrages dans l'immeuble en passant par le final, tout n'est que
références à un film de Hitchcock ou à un autre. Les meilleurs moments sont
d'ailleurs ceux qui s'éloignent un peu de cette fixette, ou du moins qui
parviennent à trouver un gag vraiment percutant pour des situations mille fois
parodiées par le passé.
Alors bien sûr, tout le monde vous parlera de Charlie, le nerd Star Wars,
véritable héros du film et source de la moitié des gags à lui tout seul. Et oui, Mes Chers Voisins est ENCORE un film de nerd pour les nerds ! Quant au
"retour" de Carmen Maura, il est certes courageux et percutant, mais bon, ça
sent quand même l'ex-star qui a du mal à payer ses impôts. Saluons quand même sa
performance très très "physique". Quant au gag parodiant Matrix,
c'est celui qui a fait le plus rire dans la salle. Notamment les sales cons de
nerds pseudo cinéphiles qui étaient juste devant moi. Bah merde les mecs ! Faut
arrêter avec les sauts d'un immeuble à l'autre ! N'oubliez pas que le saut
d'immeuble est source de l'une des plus fortes scènes d'ouverture d'un film (Vertigo,
pour vous rappeler les évidences) et aussi source de l'une des plus puissantes
scènes de l'histoire du cinéma (Blade Runner ? Vous vous souvenez
au moins du chef-d'œuvre de Scott qui renvoie toujours, 20 ans plus tard, tous
les films hollywoodiens d'aujourd'hui pleurer chez leur mère. Comparez ! Qui est
le plus beau et le plus intense ? Matrix, le Seigneur des
Anneaux, Spider-Man ou bien toujours et encore Blade
Runner ? C'est tellement réjouissant d'enfoncer les portes ouvertes...).
Bon, où en étais-je ? Et bien Mes Chers Voisins est un film
sympathique, vite vu, vite oublié, à part pour sa jolie fin. Voilà, voilà.
|

de Guillermo Del
Toro
Blade 2, c'est le genre de film qu'on aimerait adorer. Le genre de
clef de voûte du cinéma de pur divertissement, pour laquelle on aimerait sauter
sur les gens dans la rue en leur hurlant : "aaaaaah Blade 2, c'est
trop bien !!!". On voudrait y perdre toute retenue, oublier que l'on est avant
tout fan de Tarkovski et de Miyazaki, pour se dire que bon sang merde alors
foutredieu, Blade 2 c'est le plus grand film du monde. Le genre de
sensation que l'on ressent après avoir vu ou revu AlienS, Die Hard 1 & 3, Predator, Darkman, Batman, Sleepy Hollow, A Toute Epreuve, The
Frighteners... Pouvoir suspendre son jugement au profit d'un plaisir
simple, visuel, auditif, sensible, mais vraiment purement sensible ; entre le
cri des tripes et la décharge masculine de testostérones en rut.
Si
cela fait quelques temps que j'attends LE film hollywoodien qui me procurerait à
nouveau d'aussi grandioses élans (Pitch Black et le premier Blade, n'étant pas loin d'avoir réussi le tour de force), je misais
beaucoup sur Blade 2. Beaucoup ? Tout, oui ! On nous annonçait la
claque du début du millénaire. Le nouveau film qui allait changer le cinéma
hollywoodien. Pour preuve, voici un exemple des plus amusants. Après avoir vu Blade 2, les frangins Wachowski sont retournés améliorer leurs
séquences d'action de Matrix 2 & 3. Comme ils avaient à l'époque
re-tourné leurs scènes du premier opus après avoir vu Blade (Matrix en mieux, ne l'oublions pas !). Alors ? Alors vous allez attendre pour savoir si Blade 2 est aussi bien que l'on a voulu le dire. Si vous avez vu
le film, vous connaissez déjà la réponse. Mais brisons un peu du suspens. Non, Blade 2 n'est pas aussi bien que Time and Tide et
que Legend Of Zu, mais Tsui Hark ne filme pas les super-héros, il
EST un super-héros. Poursuivons.

A
priori, Blade 2 n'a rien d'un chef-d'œuvre. Il n'invente aucune
situation originale, il ne fait que reprendre un cahier des charges parfois
grotesquement prévisible (mais pourquoi faut-il TOUJOURS une scène de rave
pleine de musique à chier ???). Del Toro reprend aussi bon nombre d'idées du
premier Blade, et pas seulement au niveau du scénario, non, la
mise en scène se permet parfois des plans directement repris du premier épisode. Blade 2 n'est pas AlienS, ni Die Hard.
Le scénario, bien ficelé, malin, efficace, n'est pas un monument de
chorégraphie, ni même de rythme (bien qu'à ce niveau, Blade 2 soit
très largement supérieur au premier film). On n'est pas chez McTiernan, ici rien
n'est aussi parfait que la première heure de Die Hard 3 ou que la
dernière demie-heure de Predator. Pour Del Toro, ce qui compte, et
c'est tant mieux, c'est de jouer la surenchère. En ce moment tout le monde fait
de la surenchère, vous allez me dire. Oui, mais chez Del Toro, la surenchère a
de la classe.

Car
ce type a une vraie vision de mise en scène, qui n'arrive pas encore à
s'exprimer pleinement dans Blade 2. La plus flagrante, et sans
doute la meilleure, des preuves, c'est sa faculté à filmer les scènes d'action
de manière originale. Oh crotte, ça y est, le mot est lâché ! Blade 2 est original ! Et je viens juste de vous dire le contraire ! Oui, il y a de
l'originalité dans Blade 2, mais pas suffisamment pour en faire
une date clef (quoique...). Le véritable choc, c'est que ce grand type (ou gros
type, oui, je sais) de Del Toro, nous filme des combats en plans de longue durée
! Des plans LONGS ! Des putains de plans LONGS ! Enfin ! On n'est plus dans
cette bouillie foutraque à la X-Men, à la Michael Bay, à la
Bruckheimer. Del Toro se dit : "le seul génie au monde qui peut maîtriser le
montage bourrin en en faisant un art à part entière, c'est Tsui Hark. J'ai vu Zu 2, j'en suis sorti tellement malade et abasourdi que j'ai décidé
de ne pas chercher à bêtement surenchérir (ce qui relève de l'impossibilité
physique)." Et Del Toro (qui n'a sans doute pas vraiment pensé ça, ne lui faites
pas dire mes conneries à ce pauvre homme), quelle que fut sa motivation
(européenne, asiatique, comics, nerd, je ne sais pas....), a eu diablement
raison. Même s'il reste du montage fatigant dans Blade 2 (qui tape
qui ? où ? comment ? pourquoi ? ça bouge mais kidoncou ?), on peut voir des
combats et des gun-fights en comprenant quelque chose à ce qui se passe à
l'écran. On nous dit que le montage qui charcle, ça fait jeu vidéo. Mais non !
Dans les jeux vidéos on comprend toujours ce qui se passe, on voit ! C'est le
but ! Sinon, la gestion de la caméra est nulle et le jeu est injouable. C'est
pareil au cinéma ! Au cinéma c'est même pire, car le spectateur ne peut pas
appuyer sur un bouton pour recentrer la caméra ou la faire tourner. Non, c'est
au metteur en scène de... mettre en scène. Et Del Toro met en scène ! Et de
quelle manière ! Lorsqu'il parvient dans la boîte de nuit à gérer bien cinq (5
!) situations à suspens en même temps, sans que l'on y perde une seule seconde
son latin ! Hum, ça sent le grand film, non ? Attendons encore un peu...

Rien que pour cela, Blade 2 est déjà un film estimable. Si je vous
dis ensuite que ces scènes d'action sont peut-être les plus spectaculaires
jamais filmées dans un film occidental (oui, je précise bien : occidental). Si
je vous dis que les effets numériques sont là, mais pas du tout omniprésents et
d'une discrétion souvent agréable (ce n'est ni Matrix, ni The One). Que Del Toro n'abuse pas du ralenti et de toute la clique de
ses dérivés (bullet time & co). Que l'enchaînement de ces séquences est bluffant
(on a presque la sensation que cela ne s'arrête jamais, mais bon ce n'est pas
Versus quand même). Vous pouvez penser que nous tenons LE film jouissif que nous
espérions et que Carpenter avait ébauché l'année dernière avec son Ghosts
Of Mars.
Oui, sans doute, oui. De plus : Wesley Snipes est Blade. Définitivement. Le rôle
d'une carrière. D'une carrière dédiée à la série B (voire Z). Il ne fait rien,
ne joue pas, il se contente d'être classe, à la fois ridicule et grandiose.
Comme tous ces super-héros que l'on aime. Le reste du casting est une brochette
délicieuse de seconds rôles adorables. Kris Kristoferson est de retour, en
pleine forme et atteint ici une certaine apothéose de son rôle de "vieux
baroudeur bougon au grand cœur". Chez les vampires, outre un viking du 13e
Guerrier, on retrouvera l'inégalable Ron Perlman, acteur génial s'il en
est, qui sera bientôt Hellboy, une nouvelle fois pour Del Toro
(c'est peu dire si on espère que ce film sera LE chef-d'œuvre qu'il se doit
d'être). L'inévitable touche féminine au milieu de ce monde de brutes, est
campée par un sosie gothique de Laeticia Casta. Leonor Varela est trop
"parfaite" pour être vraiment attachante. Nyssa, possède deux inévitables
fonctions : exciter la libido de tout le monde dans sa combinaisons en cuir puis
dans la belle armure noire et brillante du BloodPack, et apporter une touche
délicate à un final prévisible mais joliment filmé.

Et
Del Toro se prend pour Cronenberg. On le savait depuis Cronos et d'autant plus
depuis Mimic (que le gars Cronenberg avait défendu, malgré la
quasi nullité du film, c'est vous dire !), Del Toro est une fusion entre le
réalisateur du Festin Nu et le Brian Yuzna de Society. Il lui faut
des mutations crades, des autopsies guignolesques, il faut que cela suinte, que
cela bave, que cela soit tout aussi cartoonesque que totalement réaliste. A ce
titre, le mode de nutrition des Reapers est une merveille du genre. C'est beurk.
Vraiment beurk. Bien sûr on pensera à Frissons et à Rage de Cronenberg (le virus qui se transmet par la bouche et au moyen d'une entité
organique quasi indépendante à la forme phallique très prononcée), mais on n'a
pas le temps de trop réfléchir à tout cela. Del Toro a déjà enchaîné sur une
autre scène diablement maligne et toujours visuellement très maîtrisée.

Le
film n'est jamais sérieux. Ce n'est qu'une succession de punchlines stupides et
d'insultes pittoresques. Ne manquez pas la VF si vous en avez l'occasion !
"Daywalker" est traduit par "Diurnambule" (ça ne s'invente pas !). Fous rires
garantis ! La musique fait n'importe quoi (ah l'avancée du Bloodpack avec un
gros rap à fond la caisse) mais finalement s'en sort plutôt bien (le mix entre
techno et rap privilégie l'identité Black du film et c'est fort bien venu).
D'ailleurs en parlant d'identité Black, il est clair que Del Toro a bien compris
la porté iconique que pouvait avoir Blade. C'est le super-héros black !
Shadowman a trop attendu pour faire son apparition à l'écran. Wesley Snipes est
le Batman noir, le Spider-Man élevé au Ice Cube et à Marvin Gaye. D'ailleurs
Blade est cool comme Shaft et il n'est à n'en point douter LE Shaft ou le Jim
Brown de notre époque. Shaft tapait du dealers, aujourd'hui c'est la métaphore
qui prime, mais Blade fighte du vampires et du manipulateur génétique. Del Toro
fait œuvre à la fois nostalgique et novatrice. Et encore une fois je suis pris à
mon propre piège, car oui, Blade 2 est un film novateur.
Face à ce film, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous restez sur le palier
et vous considérez cet empilement de clichés et de poses comme un machin pour
djeunz sans cervelle. Soit vous vous réjouissez de ce pur film de poseur qui ne
se prend jamais au sérieux et qui ne veut vous transmettre qu'une seule chose :
un plaisir de gosse. Un plaisir d'ado crétin, oui, mais pas en nivelant vers le
bas. Non, un plaisir d'ado crétin qui ne vous prend pas pour un con. Un plaisir
d'ado crétin qui soigne son look, qui s'amuse avec vous, au lieu de se moquer de
vous. Sincère Blade 2 ? Infiniment ! Del Toro sait qu'il fait de
la série B et il fait cela comme s'il faisait de l'art. Le type a tout compris
et il est peut-être de la trempe des plus grands. Si Hellboy tient
ses promesses, Del Toro ira rejoindre McTiernan, Burton et autres Sam Raimi, là
haut, tout là-haut dans les étoiles des metteurs en scène qui savent se faire
plaisir, nous faire plaisir, avec sincérité, avec fun, avec du talent, avec des
idées, avec, et oui, un coeur. Il y a du John Carpenter dans cet homme là ! Le
cinoche du samedi soir est un art. Blade 2 en est l'un des
chefs-d'œuvre. |
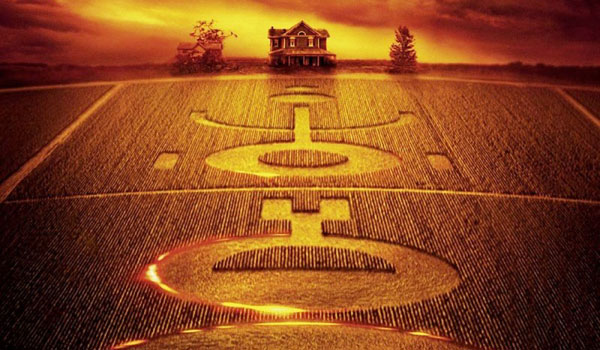
Signes
de M. Night
Shyamalan
Doucement mais sûrement, Shyamalan poursuit son petit bonhomme de chemin. Si Incassable marquait une avancée gigantesque par rapport au gentil 6e Sens, il est vrai que Signes n'est pas une telle
révolution. Cependant, dans ses aspects de blockbuster plus abordable que le
film précédent, Signes parvient à maintenir un tel degré
d'exigences et d'efficacité que c'est une nouvelle fois un film exceptionnel. Signes est un bonheur de construction dramatique implacable, un
instant jouissif de spectacle et aussi un horrible thriller d'épouvante. Certes,
on pourra reprocher à Shyamalan de ne pas aller jusqu'au bout des questions que
pose son film et, s'il a le mérite de nuancer son propos, il choisit
malheureusement trop clairement une réponse dans les dernières minutes du film.
Heureusement pour nous et pour lui, ce choix final n'a rien de la lourdeur
incroyable de l'interminable fin du dernier Spielberg. D'ailleurs, on peut noter
qu'à peu près tous les niveaux, Signes est supérieur à Minority Report ; et ainsi l'élève dépasse le maître.
Le
début du film laisse parfois un peu perplexe. Comme à son habitude, Shyamalan
dramatise à outrances le moindre petit événement, la moindre réplique, le
moindre geste. Aidé en cela par l'inévitable musique de James Newton Howard, il
transforme des plans d'une banalité confondante en apothéose wagnérienne (le
plan d'un verre d'eau à moitié vide devient le final de Tristan & Isolde, ce
genre de choses...). Mais l'on est bien forcé d'avouer que sur un spectateur
partagé entre cynisme et premier degré absolu comme moi, cela fonctionne
parfaitement. On entre dans le film doucement et sûrement, aidé en cela par un
nombre assez conséquent de gags bien lourds mais d'une évidence comique qui
permet au film de sortir de son sérieux étouffant. La machine est lancée, vous
ne pourrez plus vous échapper.
Bien. Et si ceux qui n'ont
pas encore vu cette perle arrêtaient de me lire à partir d'ici et courraient
dans le cinéma le plus proche ? Hein ? Allez, allez, hop hop !

Ce
qui fait la force du scénario de Signes c'est son aspect
implacable, inévitable, sa fatalité qui n'est pas sans rappeler celle du Simetierre de Stephen King. Dès le début on sait que les E.T. ne sont
pas venus en paix et l'on sait que cela va faire mal. Même si, et c'est aussi là
une grande qualité du film, on ne voit rien de l'invasion planétaire, on vit la
catastrophe au plus près. Car, oui, si une telle chose devait se produire, après
tout, nous aussi nous ne verrions rien, rien de plus que notre propre terreur,
barricadés dans un quelconque abri de fortune, l'inévitable cave de la
Nuit des Morts-Vivants. Et c'est dans sa seconde moitié que le film vire
au pur film d'horreur. L'instant clef se situant lors de la scène résolument
terrifiante de l'apparition de l'Alien sur la vidéo d'anniversaire. Vous allez
entendre dire par de nombreuses personnes que Signes c'est "trop
nase", mais croyez-moi, j'étais dans une grande salle pleine à craquer, et à cet
instant tout le monde a eu peur. TOUT LE MONDE. Et pas seulement les filles.
Alors bien sûr, juste après, cela s'est mis à rire, et l'on a commencé à
entendre les remarques du style : "ouah c'est un mec dans un costume ! c'est
trop mal fait ! il est trop ridicule !". D'une part ce n'est pas un monsieur
dans un costume, c'est bien une image de synthèse, et d'autre part il n'est pas
du tout "trop mal fait". Shyamalan, conscient que la vision d'un E.T. est
toujours ou presque source de ridicule a conjoint la méthode Alien et la méthode Predator : monstre humanoïde beurk + méchanceté brutale +
invisibilité = maxi trouille. De la démarche du E.T. à son physique, des
instants où ils apparaissent (en général à peine une main) au final (dont je ne
parlerais pas du tout, parce que sinon vous ne vous ferez pas avoir), tout est
fait pour vous rappeler vos terreurs d'enfants. Car, et je reprends ce que l'on
m'a dit fort justement, Signes est un extraordinaire film pour
enfants. Un film d'épouvante pour mômes comme on n'en fait plus depuis Poltergeist, Gremlins et même S.O.S. Fantômes.
Par contre, si vous y emmenez votre petite soeur ou votre petit dernier, c'est à
vos risques et périls. Signes, c'est du concentré de traumatismes.

Mel
Gibson est bien sympathique dans un rôle relativement ambigu, mais c'est Joaquin
Phoenix qui confirme le mieux tous les espoirs que l'on pouvait placer en lui.
En se fondant totalement dans ce rôle de gentil plouc un peu limité, il est à la
fois drôle, physique et touchant, définitivement un acteur à suivre. La mise en
scène de Shyamalan est sans doute un peu plus discrète que dans ses films
précédents, mais elle se réserve quelques morceaux de bravoure d'une efficacité
renversante (gag !). La musique de Newton Howard est toujours aussi envahissante
mais elle donne un rythme sauvage aux scènes de suspens. La photographie de Tak
Fujimoto est comme à l'habitude d'une réelle splendeur dans la fausse sobriété.
Même si Signes reste un film de divertissement américain,
Shyamalan prend le temps et le soin de développer un discours relativement fin
et riche en ouvertures. Il faut l'avouer, le 11 septembre et la paranoïa
guerrière des USA donnent à Signes un goût assez amer, mais, au
final, c'est du Moyen-Orient que viendra (très ironiquement) la solution pour
repousser les envahisseurs hors du monde. Non, cette fois les américains n'ont
pas sauvé la Terre, et la bonne famille éprouvée de papa Gibson a juste réussi à
survivre. Et c'est en cela que Signes est peut-être un grand film.
Dans son conte terrifiant d'une simple histoire de survie, un huis-clos vécu au
plus près de gens simples, avec des croyances et des préoccupations simples.
Au
final, Shyamalan privilégie la subjectivité, ce qui est à la fois enthousiasmant
et très problématique. Signes peut aussi bien justifier une belle
vision philosophique de notre monde que n'importe quel fanatisme autarcique. Au
spectateur de tirer ses propres conclusions, car le film n'impose rien et son
final où "tout fait sens" est avant tout un monument de suspens "fun". Pour nous
autres, doués d'un peu de recul, Signes ne semble présenter que
les risques de quelques cauchemars bien mérités ; mais pour le spectateur
américain dopé au "In God We Trust", le dernier Shyamalan est une arme. Signes est peut-être une épée sublime, que l'on ne cesse d'admirer mais
dont il ne faut pas oublier qu'elle peut aussi tuer. Et dans ses ambiguïtés, Signes devient plus qu'un génial divertissement. Mais sans aller trop
loin, au simple premier degré du spectateur qui veut passer une heure quarante
scotché à son siège et ne pas sortir de la salle en ayant déjà tout oublié de ce
que l'on vient de lui raconter, Signes est une sacrée réussite et
l'un des films les plus intéressants de l'année. Et c'est aussi le plus
flippant. Moins définitif qu'Incassable, mais déjà un classique.
|

Spider-Man
de Sam Raimi
Peut-on tout pardonner à nos idoles ? Peut-on pardonner à Burton de n'avoir
délivré qu'un bon film avec sa Planète des Singes (l'aspect
bestial et l'ambiance sont grandioses, mais le reste est basique) ? Peut-on
pardonner à Peter Jackson d'avoir fait du Seigneur des Anneaux une
publicité pour le livre de Tolkien et de ne pas avoir osé faire un film, son
film ?? Peut-on pardonner à l'équipe de Squaresoft d'avoir fait du film Final Fantasy un "actioner" hollywoodien avare en pauses poétiques ?
Peut-on pardonner à John Carpenter de faire avec Ghosts Of Mars une série Z jouissive mais vraiment très Z ? Peut-on pardonner à McTiernan de
conceptualiser son remake de Rollerball au point que l'on ne sait
plus si c'est du 1er ou du 25687e degré ? Peut-on et doit-on pardonner Sam
Raimi, roi des fans de Comics, auteur des plus grands Comics live de l'histoire
du cinéma (Evil Dead 1, 2 et même 3, Darkman bien sûr, mais aussi Mort Ou Vif, et surtout, et l'on a tendance à
l'oublier, Mort Sur Le Grill), d'avoir fait avec son Spider-Man une œuvre sincère mais dénuée de la moindre magie. Sam Raimi,
comme la majorité des cas cités précédemment, a mis en scène un bon film, mais
pas un grand film, et encore moins un chef-d'œuvre. Les temps sont durs pour les
héros !

Car Spider-Man avait beaucoup pour réussir. Un grand metteur en scène,
un Comics parmi les meilleurs et les plus cultes, une équipe solide, un budget
hollywoodien... Le projet traînait depuis des siècles dans les tiroirs des
grands studios, et après avoir longuement été le joujou de James Cameron (comme la Planète des Singes, tiens donc !), le petit monde des fans de
Comics ne fut rassuré que lorsque le nom de Sam Raimi fut définitivement attaché
au projet. Sam Raimi, pour le cinéphage, c'est monsieur Evil Dead,
mais c'est aussi monsieur Darkman. Et Darkman, c'est
LE Comic live par excellence. Alors Spider-Man ne pouvait être
qu'une réussite. Et on retrouvera dans Spider-Man beaucoup de
choses déjà vues dans Darkman, des plans entiers par endroit !
Voire tout le final (en plus spectaculaire, certes, mais c'est quasi exactement
les mêmes séquences). Raimi prend le temps de changer l'immeuble en construction
par un pont ; mais le héros qui fuit la femme qu'il aime pour accomplir son
destin de super-héros, en déclamant une tirade qui s'achève par "I am
truc-Man !", hum, hum... On ne pourra pas reprocher à Raimi de réutiliser
ses coups de génie, bien sûr, surtout sur un projet aussi exigeant, mais là où
le bas blesse, c'est que cela fonctionne toujours moins bien que dans Darkman.
Peter Parker a beau être un héros torturé, il ne tient pas un seul round face à
la tragédie du Darkman (et ne parlons pas de Batman, il est même moins touchant
que le Clark Kent des deux premiers Superman). Ses préoccupations d'adolescent
mal dans sa peau font échos à celles des X-Men, mais comme dans le film de Bryan
Singer, elles sont bien platement agencées. Darkman, comme Batman, est un héros
adulte, Spider-Man est un héros adolescent, bien loin de la maturité, et son
traumatisme essentiel (la mort de son oncle, par sa faute de surcroît), pourrait
faire de lui un personnage tragique. Malheureusement, cet élément clef n'est pas
du tout mis en valeur dans le film. C'est même une ficelle de scénario plus
qu'un véritable centre émotionnel. Toutes les interactions entre les principaux
personnages se veulent complexes, elles sont à peine ébauchées.

La
romance, par exemple, est d'une platitude proche du soap opera. Et elle n'est
pas aidée dans son émotion par le jeu étonnamment fort limité de Kirsten Dunst
(transparente, potiche à la Kim Basinger du premier Batman, le
"syndrome laitue" a encore frappé). Par contre, Tobey McGuire s'en sort fort
bien, avec un rôle qui risque de le poursuivre très longtemps. Le méchant ne
manque pas de charisme, il se veut grotesque, il l'est, mais pas du tout à la
manière burtonienne. On le voudrait écho du Joker ou du Pingouin, ce n'est qu'un
dessin animé. Il n'est ni effrayant, ni émouvant, ni inquiétant, ni surprenant.
Quand un film de super-héros faillit sur son méchant, cela sent la débâcle.
Burton l'avait compris, lui qui a toujours préféré les adversaires de Batman à
Batman lui-même. Raimi veut faire de Peter Parker, LE point pivot de tout le
film. Et cela est louable. Mais Parker n'a pas l'envergure nécessaire. Et l'on
souhaite que la suite (les suites !) rattrapent ces faiblesses. Après tout, le
premier Batman n'est qu'une broutille en comparaison de Batman Returns. Quant au baiser sous la pluie, il est presque déplacé
dans toute cette histoire de frigidité masculine et de mortification
adolescente.
La
mise en scène de Raimi est noyée par les SPFX. Les dernières marques de
reconnaissance du grand bonhomme sont les plans empruntés à ses précédents
films. On le reconnaîtra aussi dans la brutalité de certaines scènes. En
particulier la confrontation finale entre le Goblin et Spider-Man, qui
rappellera grandement... la fin de Predator (on y perd son
latin...). Agressif, le film l'est assez souvent. Chose assez étonnante pour une
œuvre très grand public. Comme si Hollywood permettait plus de choses aux
blockbusters sûrs de leur succès (cf la violence du Seigneur des Anneaux),
tout en poursuivant sa politique du "délit de sale gueule" en coupant
systématiquement les ambitions des auteurs qu'elle méprise (Burton, McTiernan,
Carpenter...). Sam Raimi bouffé par le système sur certains points, c'est
indéniable. Mais la passion du fan subsiste et il est difficile de remettre en
cause la sincérité de son Spider-Man. Mais de là à le trouver
supérieur à la Planète des Singes de Burton, je n'y vois que de
l'hypocrisie en branches. Le Goblin est-il plus charismatique que Thade ?
Kirsten Dunst plus passionnante que Ari ? Et les seconds rôles plus développés
?? Non.

Alors, oui, c'est Spider-Man sur grand écran. Et c'est le fantasme
de beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Les fans de Peter Parker y trouveront
leur compte, comme avec X-Men ou avec le Seigneur des
Anneaux. Mais juste leur compte. Pas plus. Certains seront sans doute
déçus. Pour les autres : là encore ils se trouveront face à une belle enluminure
qui les tient soigneusement à l'écart de la grande fête. Spider-Man suppose une nouvelle fois que l'on sache déjà de quoi il en retourne avant
d'entrer dans la salle. Que l'on en sache suffisamment, sans en savoir trop.
Comme si l'émotion de la mort de l'oncle Ben se trouvait dans le Comics et non
dans le film, comme pour la mort de Boromir, comme pour les errances de Serval.
Là où Burton créait de l'émotion chez une Selina Kyle ou un Pingouin, Raimi
laisse l'émotion sur le papier. On peut saluer la démarche (le film s'efface
devant sa source), comme on peut la regretter fortement (on renonce à faire une
œuvre nouvelle et ambitieuse).

Le
film possède ses forces, notamment visuellement. On a parfois l'impression
d'être Spider-Man en train de filer d'un gratte-ciel à l'autre. Mais l'on ne
ressent rien, ou si peu. Et pour les quelques vraies idées (le sixième sens
d'anticipation de Peter Parker en bullet-time, la scène de catch très drôle
("hey ! it's not my name !"), quelques moments vraiment intenses), c'est la
tiédeur qui domine. Pour exemple la partition de Danny Elfman, qui recycle
toutes ses anciennes et surtout récentes bonnes idées (les chœurs de Sleepy Hollow, l'électronique de la Planète des Singes),
sans créer de thèmes forts ou de surprises. Elfman n'est novateur que chez
Burton, ou alors quand on ne l'attend pas du tout (la partition de Freeway !). Et il n'y a même pas un thème aussi immédiatement évocateur que celui de... Darkman (déjà de Elfman, qui est abonné à tous les "man",
forcément). Spider-Man est un bon film, un film de fan, une bonne
adaptation, très fidèle, trop fidèle. Ce n'est malheureusement, en fait, même
pas une adaptation, mais juste une mise en image. Et encore une fois, j'en viens
à demander s'il faut préférer une mise en image à une véritable adaptation
(aussi discutable soit-elle), comme le sont la Planète des Singes et Rollerball ? Chaque œuvre à ses mérites et ses défauts. Avec Spider-Man, le bon moment est garanti. Mais le grand frisson est
encore bien loin. Alors pourquoi ne pas retourner voir Blade 2 ?
|

L'Attaque des Clones
de George Lucas
J'en attendais le pire, et, sans être tombé en extase devant le plus grand film du monde, j'en ai eu le meilleur. Après le "beurk beurk cra cra beurk" Episode 1, plombé par tous les défauts possibles (mise en scène de téléfilm, laideur visuelle, acteurs nuls, histoire stupide, rythme inexistant, humour pas drôle, enjeux dramatiques limités, magie absente, n'en jetez plus !), cet Episode 2 pouvait être envisagé, au mieux, comme la version "ado rebelle" de l'épopée Star Wars, au pire, comme un clou supplémentaire dans le cercueil de Dark Vador (qui n'en a pas, de cercueil, vu qu'il est incinéré, mais là n'est pas la question).
Anakin, après avoir été un chiard horrible ("Ani !"), allait faire sa crise d'adolescence. Et c'est ce qu'il fait. De chiard horrible, le futur Dark Vador devient un teenager tête à claques (campé à merveilles par l'insupportable Hayden Christensen), qui ne demande que des coups de genoux dans la mâchoire dès qu'il apparaît à l'écran. Il est en guerre contre l'autorité (il se dispute sans cesse avec ce pauvre Obi-Wan, pourtant franchement sympathique grâce à une interprétation enfin un peu éveillée de Ewan McGregor), il se laisse tromper par ses sens (et tombe dans les bras de la pédophile Natalie Portman, qui joue toujours comme une laitue), il se laisse abuser par la colère (parce que sa maman meurt dans ses bras, en plus c'est triste, tout ça), manipuler par Palpatine (de plus en plus présent et effrayant). On se demande même à la fin s'il ne va pas rouler une pelle à Christopher Lee et donner un coup de pied mesquin à Yoda. Tout cela pour dire que la puberté est un âge difficile.
Fort heureusement il n'y a pas que cela dans l'Attaque des Clones, il y a avant tout et surtout du spectacle, de grands moments et enfin un véritable esprit de "rebondissements", cet esprit qui fait toujours de l'Empire Contre-Attaque le meilleur Star Wars. Le drame est de retour, les méchants ont enfin du charisme, les visuels sont enfin souvent beaux, les scènes d'action sont bien menées (jusqu'à l'apocalyptique dernière demie-heure). Si le rythme est toujours aussi mal fichu et les scènes intimes aussi ridicules (ou peu s'en faut), le divertissement est réussi.
Que retient-on ? Un début de film qui louche fortement du côté de Blade Runner. Une poursuite en voitures volantes pleine de surenchère, et c'est très jouissif. Un bar intergalactique qui fera jouer la nostalgie (et encore penser à Blade Runner, décidément). Des visuels parfois proches du sublime. Une planète aquatique dévorée par une incessante tempête, théâtre d'un beau combat entre Jango Fett et Obi-Wan. Une poursuite au milieu des astéroïdes bien moins impressionnante que celle de l'Empire Contre-Attaque (en grande partie à cause de la musique et de l'aspect plus jeu vidéo que Space Opera, enfin, par moment on retrouve les mêmes frissons que lorsque l'on essaie de traverser la gare du Nord à l'heure de pointe...). Une dernière demie-heure fantastique avec : Gladiator version Star Wars et des monstres rigolos, un épastrouillant combat entre les Jedis et les droïdes qui vaut à lui seul le déplacement, une guerre des clones totalement surréaliste (avec zooms façon "reportage de guerre, le Vietnam comme si vous y étiez"), un combat final contre Dokoo (Christopher Lee toujours aussi drôle) qui veut par moment égaler les combats entre Luke et Dark Vador (et qui ne s'en approche même pas). Et bien sûr l'intervention de Yoda, la scène la plus culte du film. Ouf.
A côté de l'aspect "fun", il y a une belle présence du Mal, avec ce sentiment d'inéluctable qui accompagne chaque instant clef. Les clones qui sauvent la République vont la mener à sa perte. Donner les pleins pouvoirs à Palpatine, c'est ouvrir toutes les portes à Darth Sidious. Anakin penche vers le côté obscur mais personne n'en prend suffisamment conscience, lui-même fait plus confiance à Palpatine qu'au pauvre Obi-Wan. Les Jedis sont en plein déclins, aveuglés et affaiblis. Tout le monde va mourir ou presque. La plus belle image du film reste celle de ces bataillons de clones prenant place à bord des fameux croiseurs du futur Empire, sous l'œil d'un Palpatine plus shakespearien que jamais. L'Episode 3 sera peut-être un très grand film, ou alors une terrible douche froide. Pour l'instant, il s'agit de profiter au mieux de ce que nous offre un Lucas plus généreux que jamais et ne pas chercher trop loin, sous peine de déception sévère.
George Lucas n'est pas un grand metteur en scène. Le premier Star Wars était figé, la direction d'acteurs d'American Graffiti consistait en de l'improvisation, son absence de 20 ans des plateaux avaient mené à l'incroyable échec de la Menace Fantôme. Aujourd'hui, soit Lucas a enfin appris à maîtriser les nouvelles techniques cinématographiques, soit il a vraiment laissé son équipe faire bon nombre de choix à sa place. Quoi qu'il en soit, l'Attaque des Clones est le film le plus maîtrisé de Lucas, peut-être son meilleur. Un grand divertissement qui ne demande aucune analyse (les aspects soit-disant psychanalytiques sont à mourir de rire), aucune arrière-pensée. Si j'avais 12 ans, je vous dirais peut-être que c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, moi, vieux, fatigué, antédiluvien routard du cinématographe, je peux vous dire que l'Attaque des Clones est un excellent moment à passer dans une salle obscure. Alors, bon, que demander de plus en attendant Blade 2 et Spider-Man ? L'Attaque des Clones est aussi très respectueux de l'univers de la première Trilogie (à part quelques incohérences ici ou là) et il nous permet de nous rappeler à quel point l'Empire Contre-Attaque est l'un des chefs-d'œuvre du cinéma hollywoodien contemporain, souvent imité, rarement égalé.
|
|
|